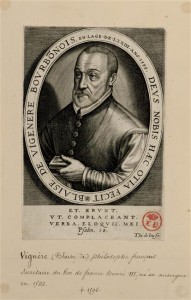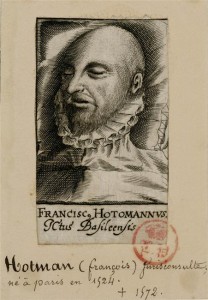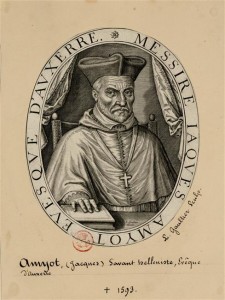CR Chorea : Art et pouvoir – séance du 3 décembre 2011
Nous commençons la séance par un tour de table.
Sont présents Adeline Lionetto-Hesters, Anne Debrosse, Aude Plagnard, Aurélia Tamburini, Diane Robin, Fanny Oudin, Francesco Montorsi, Geoffrey Lopez, Isabelle Haquet, Ivana Velimirac, Léa Lebourg-Leportier, Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Mathieu Mercier, Nicolas Kiès, Paule Desmoulière, Paul-Victor Desarbres, Stanislas Pays.
Marie Goupil-Lucas-Fontaine : “La musique à la cour des derniers Valois”
Marie Goupil ouvre cette séance consacrée aux Valois avec une communication intitulée “La musique à la cour des derniers Valois : un art et une science au service d’une “royauté de l’harmonie””. Marie est doctorante en histoire moderne sous la direction de Denis Crouzet, à l’université Paris-Sorbonne. Sa thèse s’intitule “Musique, politique et religion sous les derniers Valois.”
Sur les musiciens à proprement parler, elle renvoie ceux qui seraient intéressés à l’ouvrage d’Isabelle Handy qui figure dans la bibliographie en tête de son exemplier, Musiciens au temps des derniers Valois. Cet ouvrage, paru chez Champion en 2002, traite la question à partir du minutier central des notaires. Elle ne parlera pas non plus des théories de la musique au plan technique, car ce serait un travail de musicologue, mais s’intéressera aux théories politiques qui partent de la musique. Elle n’est d’ailleurs pas convaincue que les musiciens soient portés à théoriser leur art et son rapport aux pouvoirs.
La musique est une discipline complexe, considérée de différentes façons et utilisée dans des buts différents : elle a un aspect multiforme. D’une certaine façon, la royauté se pense de manière musicale. L’expression “Royauté de l’harmonie” fait référence à l’ouvrage de Denis Crouzet sur La nuit de la saint Barthélémy, un rêve perdu de la Renaissance (également dans la bibliographie). Elle traduit une tendance néoplatonicienne à imaginer une société idéale et, chez les derniers Valois, une volonté plus étonnante de concrétiser ces réflexions dans la pratique du pouvoir. Les Valois ne sont pas les premiers à utiliser cette pensée depuis Pythagore. Au Moyen Âge, le thème de la musique des sphères est souvent réactualisé mais les Valois ont la particularité d’y croire très profondément et de le mettre en pratique dans une politique festive élaborée qui n’a pas seulement pour but de souligner leur grandeur. Il est possible de comparer Charles IX et Henri III avec Louis XIV, l’autre monarque français qui a eu une politique musicale très active, alliée à une instrumentalisation de cet art et à une pensée politique sous-jacente, mais l’investissement des souverains dans cette politique a été différent. Ainsi, si l’on met en parallèle la fondation de l'”Académie de poésie et de musique” de Charles IX et son contexte politico-religieux, on peut s’étonner que le roi puisse y avoir cru au point de s’y investir dans une académie dont le but est de servir les arts et le verbe. En fait, la réflexion néoplatonicienne sur la musique apparaît comme un moyen de contourner l’opposition entre protestants et catholiques. L'”Académie de poésie et de musique” contourne la réflexion du concile de Trente qui place aussi la musique au sein du catholicisme. On a affaire à deux réflexions antinomiques, l’une profane et l’autre religieuse, sur un même sujet, en même temps et pour les mêmes raisons.
Marie ne traitera pas, aujourd’hui, le pan proprement religieux de cette réflexion. Elle va d’abord s’intéresser aux origines de cette idée d’instrumentalisation de la musique et aux réflexions qui président à la création de l’académie de musique, puis à la place de la musique à la cour des Valois, pour comprendre comment s’élabore une réflexion par et pour la musique.
La musique a une place importante à la cour des Valois à la fois comme divertissement et dans le cadre de la liturgie. Ils héritent des pratiques de François Ier, et à travers lui de celles de Louis XII et Anne de Bretagne, qui ont réformé, en les multipliant les effectifs des instrumentistes et des chantres de la chapelle de plain-chant. François Ier a également attiré quelques grandes figures musicales du XVIe siècle à sa cour, et a développé des relations musicales à l’échelle internationale, à travers un échange de chantres et de musiciens avec de grand souverains comme le pape Léon X ou Henri VIII d’Angleterre. C’est la première étape de l’élaboration d’une véritable politique musicale poursuivie par Henri II et Catherine de Médicis. Henri II est lui-même connu comme musicien : il est chanteur, guitariste, danseur. C’est ce couple qui développe la pratique de la danse à la cour de France.
Catherine joue notamment un rôle très important dans l’éducation musicale de ses fils : elle leur transmet la tradition musicale des Valois et la tradition artistique qu’elle tient des Médicis, fait venir des musiciens et des chorégraphes d’Italie, chorégraphie elle-même des ballets. Les fêtes de la cour des Valois sont donc, à travers elle, inspirées de l’Italie, qui fait référence en matière de raffinement. L’intérêt pour le ballet est d’ailleurs nourri des influences antiques : dans un esprit humaniste, les artistes travaillent à la résurrection du ballet antique pour en retrouver les effets. L’éducation musicale de ses fils est théorisée par la reine mère comme l’apprentissage d’un mode de gouvernement. Nous savons que Charles IX et Henri III sont tous deux danseurs, chantres, et luthistes. Nous ne disposons toutefois pas de sources pléthoriques, et il n’est donc pas possible de mener une analyse en profondeur de leur pratique musicale. L’éducation musicale de Charles IX et Henri III prend pour modèle l’homme de cour, avec une insistance sur le divertissement comme outil politique. Mais la musique fait aussi partie du savoir qui fonde la capacité à gouverner : à travers elle, le roi est pensé comme “initié” aux secrets de l’univers, ce qui lui permet de s’affirmer face aux exigences catholiques.
À la cour, la musique est omniprésente quotidiennement tant dans sa fonction religieuse, que dans sa fonction divertissante. Les derniers Valois inaugurent également un véritable cérémonial autour de la personne du roi : la musique est présente partout et dans toutes les occasions, mais surtout dans la fête comme lieu de magnificence et comme lieu d’approfondissement des réflexions néo-platoniciennes. La musique est utilisée pour apaiser les tensions politiques et religieuses. Elle ne se conçoit pas sans la danse et la chorégraphie, les décors. Les fêtes sont un moyen de propagande et contribuent à une définition quasi cultuelle de la fonction royale, comme le montre l’exemple des noces du duc de Joyeuse, qui mettent en scène un triomphe solaire pour célébrer la puissance d’Henri III. Cela est visible dans la perception de la fête par les étrangers, sensibles à la reprise incessante de chansons qui ont la paix pour sujet, de manière presque incantatoire. La concordia triumphans (cf. l’ouvrage de Margaret Mc Gowan, Concordia triumphans : l’ordre rétabli au moyen de la fête, mentionné dans la bibliographie) apparaît ainsi comme une des formes structurales les plus durables de la fête. Les applications pratiques flattent et mettent en valeur le Prince. La Musique est donc comprise au sein d’un ensemble de disciplines qui créent cette concordia triumphans.
Au sein des disciplines qui constituent la fête, la musique a cependant une spécificité, car elle n’est pas encore tout à fait détachée de sa conception médiévale. À l’origine, la musique n’est pas pensée comme divertissement, mais comme discipline scientifique qui relève duQuadrivium. Cette conception héritée de l’Antiquité reste vivante au Moyen Âge à travers Boèce et saint Augustin. La musique est une science qui a pour objet le nombre, donc la structure du monde, mais aussi l’homme avec ce mélange de rationnel et d’irrationnel que constituent l’union des parties de l’âme et du corps : cette conception est à la source de la dimension éthique de la musique, d’une conception pacificatrice de la musique. La conception de la fête s’enracine donc de manière réfléchie dans les théories antiques, reprises par les philosophes humanistes puis par l’entourage des Valois. Cela mène à des réalisations artistiques et institutionnelles et à une vie de cour originales, qui ne sont pas sans rappeler ce qui se passe au même moment en Italie. A ce titre, il est nécessaire de passer par quelques considérations sur les influences italiennes qui président aux réflexions françaises sur la musique et la politique, car les échanges entre les cours italiennes et française sont très nombreux. Cependant, les sources qui permettent de traiter le thème de la musique et du pouvoir en Italie ne sont pas toujours comparables : les source italiennes sur la question sont en fait sans équivalent pour la France, par leur nature et par leur nombre. Ainsi, Florence Alazard appuie son étude Art vocal, art de gouverner : la musique, le prince et la cité en Italie à la fin du XVIe siècle (bibliographie), sur les dédicaces de partitions aux princes et sur les traités d’harmonie (notamment de Galilei et Zarlino) qui paraissent au même moment. Ce type de sources n’existe pas pour la France de façon aussi accessible, d’une part en raison d’un exercice différent du mécénat par les Valois, d’autre part parce que les guerres de religion ont bouleversé les circuits de l’édition et de la publication, ainsi que la conservation de ce qui a été publié.
Dans les traités d’harmonie étudiés par Florence Alazard, la musique agit différemment de la rhétorique : elle ne relève pas seulement de la persuasion, mais agit violemment sur les hommes en les arrachant à eux-mêmes. L’acte de chanter sur scène métaphorise l’exercice du pouvoir politique : cela explique en partie la naissance de l’opéra en Italie à cette époque. Les traités italiens sont de la fin du XVIe siècle : ils ne rendent pas complètement compte des réflexions élaborées en France, qui précèdent de peu la rédaction des traités italiens. Il y a donc un jeu d’influences réciproques. La mise en place de l’Académie de poésie et de musique nourrit la rédaction des traités italiens, comme en témoignent les récits sur les noces du duc de Joyeuse inclus dans nombre de ces traités. En France on réfléchit aussi sur ce qui se publie en Italie. La différence tient au contexte politique. Le mouvement avorte en France avec l’Académie de poésie et de musique alors qu’en Italie, il se développe un peu plus tard mais aboutit à l’Opéra comme art total et recréation du spectacle antique car le mécénat italien le permet. Avec Henri IV, la France s’engage dans une tout autre direction.
Marie aborde ensuite les exemples proposés dans son exemplier.
La Galliade de Guy Le Fèvre de La Boderie est un poème qui s’inscrit dans le contexte de la Contre-Réforme. Elle porte la marque du néoplatonicisme florentin mais aussi des néo-kabbalistes chrétiens. Son sujet est la révolution des arts : il s’agit d’un long poème à la gloire de la Gaule, dont les arts seraient originaires, et prétend faire le récit d’un long parcours accompli par les arts avant d’y revenir. Centrée sur la Gaule, elle est donc plus exotique et nationaliste que les recherches sur les Grecs et les Romains. A l’origine des temps, régnait l’harmonie du ciel et de la terre, c-à-d entre Dieu, l’homme et l’univers, harmonie perdue, mais qui serait de nouveau de retour de façon imminente dans les années 1570. Le texte se place donc dans la mouvance astrologique : il n’est pas très éloigné de réflexions contemporaines de Nostradamus. L’œuvre est construite autour de la notion d’harmonie, et structurée en chapitres intitulés “cercles”. Elle conseille le prince sur la façon de tenir son peuple un peu à la façon d’un chef d’orchestre même si ce concept n’existe pas à l’époque. L’auteur évoque les modes dorien et phrygien, deux modes supposés agir sur les âmes et les corps : l’un apaise, l’autre excite. Il exprime une volonté de gouverner de façon musicale, d’apaiser et de trouver un règlement des violences par cette discipline.
Tout comme Guy Le Fèvre de la Boderie, Les réflexions de Pontus de Tyard, sans présider à la fondation de l’Académie de poésie et de musique, participent de son élaboration. Pontus de Tyard a écrit des ouvrages en prose et des dialogues, dont le Solitaire premier, qui offre une théorie de l’action poétique, et le Solitaire second, qui le complète en approfondissant l’aspect musical. Le dialogue réunit le Solitaire et Pasithée, représentante de l’union de la poésie et de la musique. La poésie équivaut au premier des quatre degrés de l’enthousiasme divin. Le Solitaire premier s’achève sur l’évocation des Muses, qui sont la figure tutélaire de ce premier degré. Pontus part d’un passage du Timée de Platon où le créateur fixe les proportions de l’âme et du monde. L’univers et l’âme sont évoqués comme une harmonie entrecroisée. Le Solitaire second fait apparaître une troisième figure, le Curieux, dont le rôle semble être de promouvoir les harmonies de l’univers, tandis que Pastihée figure les harmonies humaines du micorcosme. Pris ensemble, les deux Solitaire représentent la somme de la philosophie de Pontus de Tyard. L’union de la poésie et de la musique représente le premier stade du retour vers Dieu par l’effet d’une furor poeticus. L’évocation des effets bénéfiques de la fureur unit ceux de la musique polyphonique et ceux de la poésie : poésie et musique sont l’expression d’un même enthousiasme.
Le rapport entre poésie et musique est au centre des travaux de l’Académie mais fait aussi partie de la pensée politique des Valois. Baïf est le créateur (avec le compositeur Thibaut de Courville) de l’Académie. Il a lu et admire les psaumes de Marot mis en musiques par Claude Goudimel, musicien protestant et est sensible aux effets du chant religieux en français. Aussi est-il déçu que les autorités catholiques refusent le chant religieux en français. Sa collaboration avec le musicien Claude le Jeune sur la musique mesurée à l’antique lui permet d’imposer aux musiciens un rythme adapté aux textes. En même temps, il souligne la fonction d’apaisement de la musique dans le contexte des guerres civiles. Tous deux sont sollicités lors du mariage de Charles IX avec Elisabeth d’Autriche pour produire une musique vocale dont on escompte des effets apaisants propres à calmer les troubles politiques et religieux. La question posée par Jean Vignes (dans l’article “Jean-Antoine de Baïf et Claude le Jeune : Histoire et enjeux d’une collaboration” paru en 2003 dans la Revue française de musicologie et mentionné dans la bibliographie) sur la date de la fondation de l’académie est donc particulièrement intéressante. Il est en effet possible que l’Académie ait été fondée peu après le mariage de Charles IX. La cérémonie aurait été l’occasion de démontrer l’effet bénéfique de la musique mesurée à l’Antique, puis, en « récompense », Charles IX aurait favorisé la création de l’Académie pour poursuivre ses recherches sur l’apaisement par la musique. Le problème est que l’on ne dispose pas d’assez de documents pour en juger. En revanche, la lettre patente qui officialise l’Académie, qui émane du roi lui-même stipule explicitement que le roi attend d’elle que ses travaux bénéficient à la paix dans le royaume. Il attend de l’Académie qu’elle soit un laboratoire de civilisation. L’Académie se veut ainsi une école et un réservoir de poètes et de musiciens capables de remettre la parole en chant. Les concerts qui s’y déroulaient sont l’aboutissement de ces travaux, qui doivent être rapprochés des travaux de Baïf sur la poésie mesurée à l’antique (en particulier ses Mimes). Le témoignage musical le plus complet sur les travaux de l’Académie, portant sur la musique mesurée à l’antique et ses effets, est celui du musicien Claude Le jeune. D’autres participations sont plus aléatoires, et l’on a surtout des témoignages verbaux des participants, rapportés a posteriori par d’autres plumes : à cet égard, Marin Mersenne qui écrit son Harmonie Universelle cinquante ans plus tard est un des témoins indirects les plus bavards sur la fondation et les buts de l’Académie. La portée morale de l’Académie s’inspire très certainement des réflexions aristotéliciennes sur la musique et la politique, et à ce titre, Charles IX a pu connaître le De Musica de Pétrarque par les traductions contemporaines, qui prône la nécessité d’avoir une musique de qualité pour la bonne conduite d’un Etat. Étaient attendus de la musique mesurée à l’antique et de la musique en général des effets moraux qui permettraient au royaume de dépasser la discorde.
Nicolas Kiès revient sur la double polarité de la musique : calmer les cœurs, susciter les passions, le courage, comme l’indique l’anecdote de la musique qui fait trembler l’épée dans le fourreau. Il existe, entre ces deux orientations, une tension mais qu’on peut résoudre par la distinction des différents modes musicaux, ou par l’idée que la violence est soluble dans la paix. À écouter Marie, elle parle davantage de paix que de violence. L’idée est celle d’une paix reconstruite à un autre niveau, ce qui évoque la concordia discors. Nicolas se demande donc s’il existe à la Renaissance une pensée de la violence qui ne soit pas soluble dans une théorie globale de l’harmonie. Marie Goupil répond que l’idée d’arriver à la paix par la musique succède à un temps de violence dans les années 1520. De plus, la question est liée à l’opposition entre Réforme et Contre-Réforme. Les réformés ont la particularité de permettre le chant en langue vulgaire et d’autoriser le chant religieux en dehors des églises, parfois dans l’optique de galvaniser les Réformés quasiment contre les Catholiques : ils ont permis de créer de la violence par le chant. Luther très attaché à l’idée de la musique, d’où la volonté d’utiliser la langue vulgaire : c’est aussi une arme des Protestants. Il existe une violence musicale dont on accuse les réformés. Marie renvoie sur ce point à l’ouvrage de Denis Crouzet déjà mentionné : beaucoup de violences, pendant les guerres de religion, ont lieu en chanson. La façon de théoriser un idéal politique d’application de la musique est aussi une façon de s’approprier une discipline qui peut servir à tout.
Mathieu Mercier ajoute que la violence est mise en scène et en musique dans la succession chronologique des types de spectacles sous les différents Valois. Les spectacles sous Henri II et François Ier restent assez violents, avec une participation de la noblesse dans des spectacles qui tiennent du combat, comme la prise d’un château en bois. Quand les relations à la cour se dégradent, on passe d’un spectacle violent où les nobles sont acteurs à un spectacle éventuellement violent où les nobles sont spectateurs. Cette évolution est essentielle. Il ne s’agit pas seulement de théorie mais d’une position sur la musique pacificatrice liée au réel. La violence est omniprésente dans la cour : en rajouter pose un problème, donc on préfère l’évacuer et la mettre uniquement en musique. Adeline Lionetto-Hesters signale toutefois quelques exceptions à l’évolution générale dessinée par Mathieu. Elle mentionne quelques cartels auxquels Charles IX a participé. Mathieu répond que c’est en effet sous Henri III que s’arrête toute violence physique, même mimée. Adeline évoque une Bergerie de Ronsard en 1564 pour carnaval de Fontainebleau, analysée par Daniel Ménager. Elle reprend idée d’un âge d’or de la France, imagine la paix triomphante. Mais Daniel Ménager montre l’impossibilité fondamentale à poser cette paix. Le conflit reste présent presque malgré le poète dans le texte. La rivalité poétique entre les bergers introduit une discorde et des scènes violentes présentes dans le texte sous forme d’ekphrasis. Adeline cite l’exemple d’un gobelet qui représente le viol d’une nymphe par un satyre : il est révélateur d’une paix impossible à penser et représenter. Mathieu renchérit : la paix est impossible à représenter, car elle est impossible à penser de manière politique, d’où l’utilisation cathartique de la musique. Les derniers Valois sont persuadés que par le spectacle on peut amener l’harmonie par contagion. Ils demandent à la musique de démontrer que la paix est possible, dans une pensée quasi magique. Il cite l’exemple de Cosme de Mégérie, qui a d’abord été mage de Catherine de Médicis puis, à la mort de la reine, est devenu spécialiste des machines de théâtre. Dans les deux activités, l’idée est la même. La divination et les arts se donnent pour but d’amener la paix. Le passage d’une activité à l’autre s’explique donc à la fois au plan technique (faire bouger les miroirs était la spécialité de Cosme : cela doit requérir une certaine habileté technique !) et parce qu’il poursuit le même but sous une autre forme.
Marie Goupil nuance néanmoins en signalant que les musiciens à la cour (ce qui exclut Le Jeune et Baïf, qui ne sont au service de la cour que de manière ponctuelle, dans une fonction qui n’est pas celle des musiciens au quotidien) sont très en deçà de cet idéal pacificateur : ils font seulement leur travail. Il existe une distance importante entre l’idéal rêvé et la pratique réelle des musiciens. Mathieu signale que cet idéal se retrouve tout de même chez les grands compositeurs comme Beaujoyeulx. Marie répond qu’il se situe déjà à un autre degré que les musiciens ou les chantres de base tels que ceux de la chapelle de plain-chant. Mathieu acquiesce et revient sur l’anecdote liée aux noces du duc de Joyeuse, à propos de Claude Le Jeune, réputé avoir réussi à faire tirer son épée à un noble, puis à l’apaiser grâce à la musique. Le mode de l’apaisement est le mode sous-phrygien. Or la rumeur a couru que ce musicien était le compositeur du Ballet de la Reine. Marie conclut en soulignant que tout le problème était justement d’arriver à prouver l’efficacité de la musique. Mathieu souligne une autre question intéressante de ce point de vue : on sait que le Ballet comique de la reine impliquait des bruits fictifs, comme le tonnerre, etc. Il faudrait arriver à comprendre comment les bruits fictifs étaient représentés, car ils ne sont pas pris en compte dans le livret. De plus, il leur fallait se distinguer du bruit de la salle, car le théâtre de cette époque n’a pas de “quatrième mur”. Une histoire du bruit reste à écrire. Marie signale, sur le sujet, que quelques travaux ont déjà été réalisés : Florence Alazard introduit sa thèse autour de la maîtrise du bruit dans la ville, par le prince. Marie mentionne également l’ouvrage de Jean-Pierre Gutton, Bruits et sons dans notre histoire, assez général sur le thème du bruit à l’époque moderne.
Mathieu Mercier : “L’imaginaire d’Henri III”
Ce débat nous amène à la communication de Mathieu Mercier sur “L’imaginaire d’Henri III”. Mathieu travaille en histoire moderne à l’université Paris-Sorbonne sous la direction de Denis Crouzet sur le sujet :”La représentation du roi Henri III de 1589 jusqu’à l’héritage romantique chez les historiens, les polygraphes et les artistes. Il a été commissaire de l’exposition “Fêtes et crimes à la Renaissance : la cour d’Henri III” présentée au château royal de Blois du 8 mai au 24 août 2010.
Il introduit sa communication par des considérations sur le mécénat d’Henri III, qui doit avant tout être nuancé. On pourrait en effet, comme le suggérait Marie Goupil, le comparer à Louis XIV : Henri III est, à bien des égards, un Louis XIV qui n’a pas réussi, faute de moyens, faute aussi d’une théorisation car le monde artistique est un peu déconnecté des problèmes politiques, comme on l’a rappelé dans la discussion à propos des musiciens, et aussi parce que lui-même n’est pas un intellectuel : Henri III n’a rien d’un Montaigne couronné.
Il avait une formation correcte, même si aux yeux de Mathieu, l’éducation humaniste des souverains anglais était probablement un peu plus poussée. On sait qu’il a réunit l’Académie du palais dont il hérite à travers l’Académie de poésie et de musique de Charles IX. On peut voir en Henri III un roi éclairé qui s’entoure des grands esprits de son temps. Mais l’académie ne se réunit que pendant une partie du règne : il se tourne ensuite vers une réflexion moins laïque et plus spirituelle. Certes, il s’intéresse aux humanistes étrangers, les fait venir en France à grand frais, accorde des pensions aux humanistes de la cour précédente, soutient l’imprimerie à Paris (on sait qu’il était proche d’Henri Estienne, le fils de Robert Estienne). Il se remet au latin, en disant qu’il l’a mal étudié dans sa jeunesse, pour pouvoir communiquer avec les érudits européens et relire les auteurs dans le texte. Tout cela est vrai et a été démontré par Jacqueline Bouchet avec beaucoup d’empathie mais reste à nuancer.
En premier lieu, Henri III est un souverain soumis à la mode de son temps : au-delà d’un goût certain pour les artistes il reste avant tout un poseur qui veut montrer qu’il est un roi érudit. Il n’est pas sûr qu’il comprenne tout ce qu’il entend… C’est un roi versatile, qui très vite se lasse et délaisse certains protégés. Ronsard lui en voudra beaucoup de la préférence qu’il manifeste pour Philippe Desportes, un poète qui lui permet surtout de briller auprès de ses maîtresses, mais bien moins audacieux que Ronsard en termes d’innovations poétiques. Lorsqu’il se détourne des humanistes laïcs au profit d’une retraite et d’une pensée religieuse, il écoute Du Perron qui lui dit que toutes les sciences sont vanité. Enfin, la culture d’Henri III passe avant tout par le discours et non par la lecture. Il est difficile d’évaluer l’étendue de sa bibliothèque personnelle. Trois langues y sont présentes. Pour le latin, les reliures sont surtout aux armes du duc d’Anjou, ce qui suggère que ce sont des livres de formation du prince. Les ouvrages en italien, qui représentent environ 16% de la bibliothèque, viennent probablement de la cour précédente et de son passage par Venise au retour de Pologne. Reste les ouvrages en français, qui comprennent des livres à orientation religieuse, de la philosophie, de l’histoire, de la politique, de l’archéologie. Ils manifestent un goût pour les sciences, mais surtout un effet de mode : Henri III a, entre autre une passion pour la mécanique. Quand une entrée lui est offerte, il se passionne pour les automates (Mathieu mentionne ne particulier la baleine de l’entrée à Paris et celle, un peu moins célèbre, de Rouen). Henri III s’intéresse plus facilement aux petits maîtres qu’aux grands. Certes Germain Pilon, le grand sculpteur du royaume, fait des œuvres de commande, a le projet de peupler de statues la basilique de saint Denis. On peut mentionner Antoine Caron mais là encore, avec beaucoup de précaution, car ses œuvres ne sont pas souvent datées. Restent des représentations de bals qui ne sont pas attribuées à des artistes célèbres mais sont sûrement des copies d’œuvres disparues commandées par des Nobles ou des grands bourgeois. Au total, le bilan du règne d’Henri III est celui d’un faible mécénat, qu’explique l’effondrement des finances royales. Après la catastrophique paix de Beaulieu, l’état des finances l’est tout autant : Henri III n’a pas les moyens de sa politique culturelle. Et pourtant il dépense des sommes considérables dans les fêtes, le bal, l’opéra, la danse : par goût et parce qu’il est persuadé qu’il est le plus efficace dans son projet d’harmonie du royaume.
Henri III se concentre donc sur les bals et les fêtes, dans une vie de cour qui est un théâtre. Il doit répondre à la fois aux modèles idéaux du souverain, et aux attentes d’une administration efficace. Trois moments de l’existence royale forment son existence symbolique. Banquets et bals sont des moments de la magnificence.
Henri III fait venir de Venise la troupe des Gelosi, un événement qui marque le début du théâtre profane en France. La cour se comporte comme un laboratoire culturel, en particulier pour les grandes évolutions du théâtre. La France n’a pas de salles dédiées au théâtre comme en Italie mais recourt à des représentations privées dans les palais royaux ou chez les Grands, devant un public exigeant d’érudits et de courtisans dont les goûts s’affinent peu à peu. François Ier assiste plutôt à des pièces qui s’inscrivent en droite ligne dans la tradition du mystère médiéval. La représentation de la Cléopâtre captive de Jodelle devant Henri II a eu un retentissement considérable sur le milieu étudiant. Puis les représentations à Blois marquent une subite désaffection des puissants. La rumeur a voulu que cette désaffection soit due aux superstitions de la reine, qui ne voulait plus que soit représentées de tragédies devant le roi après la mort violente d’Henri II. En fait, la cour s’ennuie devant les pièces. De plus, lorsque le héros d’une pièce de Robert Garnier est tyran sanguinaire puni par la colère divine, le sujet devient par trop politique. Les factieux n’auraient pas hésité à identifier le Nabuchodonosor de Garnier à Henri III. La comédie emporte donc les suffrages de la cour car elle s’avère bien moins dangereuse. Là même, le théâtre “sérieux”, où les comédiens travaillent sur un canevas précis décline au profit de l’improvisation de la Commedia del Arte, comme l’illustre la venue des Gelosi à la cour : ils sont accueillis en grande pompe par un bal masqué où Henri III arbore une tenue provocante. Il leur donne le titre de “comédiens du roi” et les défend contre l’attitude rigoriste des parlementaires, qui marque en fait l’incompréhension des tenants de la culture classique face à l’émergence du baroque et de ses fantaisies : le peuple, comme la cour, applaudit Pantalon et ses amis, rit du capitaine Cocodrillo.
La société de cour se tourne aussi vers les autres formes d’art scénique, dans une frénésie de plaisir et de simulation. Les tournois vont peu à peu disparaître, pour les raisons que l’on a dites dans la discussion : Henri II interdit les représentations de violences et les remplace par la danse ; Henri III excelle dans la Pavane ou la Gaillarde. Or la danse est un art de la sociabilité par définition : elle inculque le maintien, la retenue, la souplesse, instaure un nouveau rapport à l’autre, qu’il faut accompagner en se tenant à distance. Le ballet le plus célèbre de l’époque est leBallet comique de la reine, qui est à la fois un événement et un avènement. Ce ballet n’a de la comédie que le nom, et aurait aussi bien pu, eût égard à son sérieux, être nommé tragique : il n’est qualifié de comédie que pour son dénouement heureux. Beaujoyeulx est venu d’Italie avec sa troupe de violons pour organiser le mariage du duc de Joyeuse, fidèle compagnon du roi. Henri III le fait, dans ce but, valet de chambre du roi. Beaujoyeulx révolutionne le ballet en France en le dramatisant. Le roi demande des fêtes somptueuses : le ballet comique est censé s’enchâsser dans un mois complet de fêtes à l’occasion du mariage. En fait, le ballet, long et compliqué à monter, se trouve décalé par rapport aux autres fêtes. Le ballet se déroule au milieu des courtisans : la frontière entre scène et vie de cour ne se matérialise pas. La mixtion entre réalité vécue et représentation dramatique est accentuée par l’unité de l’effet scénique, avec une innovation majeure : le personnage de Circé, qui dialogue directement avec la cour et dont le discours entre en résonnance avec l’imaginaire de cour et le discours politique. De plus, Circé est représentée comme un personnage solaire, or cet idéal solaire est déjà présent sous Charles IX. L’intrigue participe d’autant plus au mélange du réel et de l’imaginaire que Beaujoyeulx demande aux membres de la cour de participer comme comédiens et danseurs au ballet : il fait appel à la reine pour son maintien, à la princesse de Lorraine, aux duchesses, à la maréchale de Retz. Or tout ce petit monde se déteste : la cour est le monde des clans, celui du roi, celui des Guise, et le clan protestant, non représenté dans le ballet. La volonté de réunir les clans préside au ballet : l’idée est de les faire danser ensemble pour les faire vivre ensemble. Le roi lui-même apparaît au commencement et au dénouement du ballet dans son propre rang de roi. La réalité des rangs au sein de la cour se fond avec l’illusion dont Circé se présente comme la maîtresse. Elle s’affirme jusque dans les costumes avec des restrictions dans le choix des couleurs, des robes et des pourpoints pour les spectateurs : un code est établi pour intégrer les spectateurs au spectacle, pour que l’effet soit saisissant. Assister au spectacle permet de montrer qu'”on en est” (Mathieu cite Chateaubriand, qui disait qu’Henri III était sans doute la personne la plus snob de son temps). L’idée est d’amener toute la cour dans l’harmonie musicale et chorégraphique qui est censée les envahir peu à peu. Cette volonté met l’imaginaire au service du réel. L’école musicale florissante propage sa conception d’une musique des sphères qui a pour pendant la danse des astres. Mersenne affirme l’efficacité de cet art, et invite à une rénovation totale du ballet à des fins astronomiques et cosmologiques.
Comme la dimension musicale a déjà été traitée par Marie, Mathieu se concentre sur les corps. Les figures horizontales demandées aux danseurs représentent des figures géométriques simples, fondée sur le principe de la numérologie, et dans le double but de les obliger à se regarder et de rendre les figures visibles des spectateurs placés dans les gradins : là encore, l’idée sous-jacente est que le spectacle, comme par une pensée magique, peut influencer les courtisans et les amener à plus d’harmonie sous l’influence de la numérologie. Le spectacle du Ballet comique est fondé sur un mouvement de flux et de reflux, toujours en direction du roi. La figure la plus utilisée est le croissant déployé devant le roi, assis sur son trône. L’ensemble du spectacle répond à la volonté de remettre en scène une cour violente par son spectacle. La même fonction est dévolue au cérémonial, qui est en partie pensé sur le modèle du ballet, comme en témoigne la création de la charge de grand maître de cérémonie, qui évoque la figure du maître de ballet. Le spectacle et le cérémonial obéissent à la même pensée : réorganiser la cour, y amener l’harmonie par une composition qui stimule les cinq sens. On essaie de montrer que l’aspiration à l’harmonie est possible. Cela explique la distribution de médailles à la fin du Ballet comique. Chaque médaille comporte une devise et une image. Or celles-ci doivent être prises avec le plus grand sérieux. Ainsi, le dauphin offert par la reine, Louise de Vaudémont, au roi renvoie aux problèmes de stérilité du couple royal. L’idée sous-jacente est que la magie du ballet va agir, que si on montre à Dieu que l’harmonie revient en France, il offrira un dauphin. Plus qu’un acte de propagande, le ballet apparaît comme efficace pour créer l’harmonie. Catherine multiplie ainsi les joutes, tournois, cartels et bals : il faut faire danser les nobles pour les occuper, les empêcher de se battre. Cet impératif explique la présence récurrente, dans les spectacles, du mythe de la Discorde enchaînée, écrasée par le retour de l’harmonie. On prête à la musique un ascendant sur les individus.
Pour conclure, Mathieu revient sur le parallèle entre le mécénat d’Henri III et la politique de Louis XIV. Henri n’a pas l’argent, mais il lui manque surtout la volonté de plier son propre corps au cérémonial de la cour. Il ne parvient pas à s’imposer la discipline du cérémonial et la discipline du bal, à appliquer le “nous nous devons tout entiers au public” que Saint-Simon prête à Louis XIV : Henri III n’accepte pas d’être celui qui joue tout le temps pour être roi tout le temps. Il joue pendant les spectacles, mais suit par ailleurs des modes comme celle des petits bichons, d’où toute la mythologie entretenue par la Ligue d’un roi aux occupations puériles. Car le roi participe à des ballets moins compliqués, plus puériles que celui de Beaujoyeulx : le ballet de Beaujoyeulx l’ennuie, lui veut se retirer et vivre en bon bourgeois. Ainsi, quand son pouvoir sera contesté et qu’il est retiré à Blois, il reçoit en bourgeois les créanciers de la cour : pour montrer qu’il reste le roi, il les reçoit allongé dans le lit de la reine, en disant que celui qui couche avec la reine est le roi. Montrer un couple petit-bourgeois ne correspond pas à la politique montée au début du règne.
Sur l’invitation de Paule Desmoulière, Adeline Lionetto-Hesters lance le débat en expliquant qu’elle a fait la connaissance de Mathieu à travers son travail sur le Ballet comique, mais qu’elle l’a étudié plus littérairement, en se concentrant sur le passage du spectacle au livre et la préface. Le livre comporte beaucoup de gravures avec des décors en pleine page. Mathieu Mercier rebondit sur cette intervention en soulignant que le ballet de Beaujoyeulx a constitué un grand moment de la machinerie du théâtre en France avec des fontaines, des animaux vivants dont la présence sur scène a dû produire un effet exotique, en plus des animaux factices (des tigres empaillés, mais aussi un petit singe vivant…). Ç’a été un grand moment artistique et scénique.
Mathieu s’adresse ensuite à Marie Goupil, à propos de la musique formatrice des esprits. Il transpose l’idée au ballet, qui peut former le roi lui-même, et cite l’exemple d’un ballet dansé par Louise de Vaudémont, épouse du roi, au moment où elle est convaincue que son mari la trompe avec des courtisanes de l'”escadron volant” (et déclinant) de Catherine de Médicis. Ayant connaissance de ces aventures, Louise danse le “ballet des flagellants” : elle se présente devant le roi en train de se flageller avec des rubans de soie, puis décrète qu’elle n’a pas à se flageller pour des fautes qui ne lui sont pas imputables, et revient avec un autre costume pour se mettre à danser. Cette mise ne scène correspond à une volonté d’informer le roi, de lui donner former, de le transformer sans opposition frontale, en accord avec les conseils donnés par Catherine de Médicis. Musique et ballet sont donc formateurs, porteurs d’un message imprimé dans le conscient et l’inconscient.
Marie Goupil revient sur la mise en exergue du Ballet comique de la reine en se demandant dans quelle mesure il témoigne vraiment d’un intérêt d’Henri III pour le ballet : ce spectacle reste relativement isolé, unique par sa splendeur. Mathieu répond que l’intérêt d’Henri III est attesté : dès qu’il peut assister à un bal, il le fait, y compris dans des maisons privées, bourgeoises. Il finance aussi beaucoup de bals dans la capitale pour des raisons politiques, pour marquer son intérêt et obtenir une fidélité en retour. Les pensions versées aux poètes et les sommes consacrées aux ballets n’ont rien de commun. Une fortune passe dans les bals, auxquels il accorde une attention particulière, en y veillant lui-même. Ce goût prononcé est visible dans sa correspondance. Mais de là à dire qu’Henri III adhérait à la théorisation politique que nous y voyons, il y a un pas à franchir. Par contre, l’idée du roi solaire, d’un roi contact direct avec Dieu, dans la lignée de l’idéal de David, lui plaît : il s’agit toujours, en fin de compte, de se passer d’intermédiaire.
Paul-Victor Desarbres revient ensuite sur l’idée de pose intellectuelle, qu’il a trouvée très éclairante. Mathieu indique qu’Henri III, lorsqu’il assiste à des lectures publiques de poèmes, baille d’ennui très souvent, dès qu’ils dépassent le mode de la poésie courtoise. Il pose beaucoup, assiste aux séances de l’académie du Palais, mais surtout à celles sur l’art oratoire car cet art le fascine et il ne se trouve pas bon orateur. Tout ce qui convainc doit l’intéresser. Marie Goupil,dans le même ordre d’idée, cite de nouveau l’article de Jean Vignes, qui a réévalué l’affirmation selon laquelle l’Académie du palais hériterait de l’Académie de poésie et de musique. En fait, les deux coexistent, et l’Académie de poésie et de musique est abandonnée après Charles IX. Henri III s’intéresse plutôt à l’art oratoire : il faut convaincre pour assurer la paix, mais c’est également du snobisme. Mathieu abonde dans ce sens : effectivement, “ça fait chic”. Il y a toutefois eu un changement dans le règne autour des années 1584 : avec l’échec politique et l’échec dynastique (la mort de son frère et l’absence d’enfants obligent à prendre en considération l’arrivée d’Henri de Bourbon sur le trône), il s’enfonce dans son défaut premier, qui est un fond dépressif. Henri III est un roi chic et un roi dépressif. Il manifeste une volonté de se rapprocher de la faveur divine par des retraites à Vincennes, mais son fond dépressif était déjà visible dans les commandes à Desportes. Il abandonne le faste et la danse pour se tourner vers une vision plus noire de la vie royale. Paule souligne qu’il semble exister une tendance historique de beaucoup de souverains de l’époque à la mélancolie, et cite en exemple les souverains espagnols. Il semble qu’à l’époque la mélancolie soit une tendance répandue à l’approche de la mort. Ce n’est pas forcément lié à la maladie, mais à partir d’un certain âge on commence à se préparer la mort. Mathieu signale, dans le même ordre d’idée, que les objets macabres courants à l’époque : ce n’est pas du tout le propre d’Henri III. Marie répond qu’il y a quand même un effet de mode et de chic. Mathieu acquiesce : Henri III est effectivement très sensible aux effets de mode, qu’il essaie d’impulser mais qu’il suit le plus souvent (Il raconte une anecdote autour de la fraise et du col à l’Italienne : Henri III aurait essayé d’initier une mode pour les larges fraises, en sortant ainsi vêtu dans Paris en pleine époque de la Ligue, et, sous les quolibets d’étudiants, serait réapparu le lendemain avec un col à l’italienne).
Isabelle Haquet demande ensuite des précisions à Mathieu sur la numérologie. Mathieu répond que c’est une passion réelle, aux formes diverses, à relier aussi à l’emploi du chiffre au niveau diplomatique, où le goût du chiffre se mêle avec l’imaginaire du secret. Isabelle demande comment le chiffre se voit, concrètement, dans les représentations. Mathieu donne l’exemple du nombre de danseurs. Toutefois, les témoignages des spectateurs montrent que, pour le Ballet comique de la reine, ils n’ont pas perçu le chiffre de vint-quatre danseurs, sur lequel le livret est au contraire explicite et très précis. Il faut donc toujours être très prudent, et distinguer le niveau des intentions et celui de la perception.
Paul-Victor Desarbres : Blaise de Vigenère, un érudit au temps des guerres de religion
Après une courte pause, Paul-Victor Desarbres, qui est doctorant en littérature française du XVIe siècle sous la direction de Marie-Christine Gomez, à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense et travaille sur “Blaise de Vigenère (1523-1596) : un érudit au temps des guerres de religion.” propose une communication consacrée aux rapports de l’érudit Blaise de Vigenère avec le pouvoir. Il cite Jacqueline Boucher qui résume ainsi la situation de Blaise de Vigenère dans le Dictionnaire des guerres de religion : il “s’est beaucoup dispersé par carriérisme.”
L’action politique de Blaise de Vigenère passe par des traductions commentées qui répondent à des fins de propagandes, ainsi qu’à une mode de la pose intellectuelle.Blaise de Vigenère a d’abord été le secrétaire du duc de Nevers : en réalité, il était un véritable homme de confiance du duc qui, en retour, a favorisé ses travaux : Vigenère parle d’une retraite bienheureuse ménagée pour lui par le duc. De temps à autre, le duc lui réclame une publication qui serve ses intérêts. On a conservé quelques lettres où Vigenère rend compte de la progression de ses travaux, décrit ses préoccupations d’éditions. Il a ensuite servi Louis de Gonzague, noble d’origine italienne qui a voulu se faire le mentor en politique d’Henri de Valois, devenu ensuite Henri III. Sa ligne de conduite se résume à la fidélité monarchie et à Henri III. On peut également supposer une relation plus directe de Vigenère avec le roi, puisqu’il a été chargé de missions de diplomatie parallèle pour Charles IX et Catherine, notamment pour les premières approches qui ont mené à l’accession d’Henri de Valois au trône de Pologne. La situation de Vigenère s’inscrit donc dans le système de double allégeance de l’époque décrit par Robert Décimon. Vigenère est un cas intéressant pour la marge de manœuvre qu’il a eue. Vis-à-vis du roi, il est un courtisan et un propagandiste, pour le duc de Nevers un proche, mais c’est aussi un homme de lette avec ses idées propres. Sa dimension politique est très peu étudiée.
Paul-Victor se concentre, pour faire plus court, sur la préface au Commentaires de César des guerres de la Gaule mis en françois par Blaise de Vigenère. Cet ouvrage monumental est d’abord une œuvre d’érudition qui illustre aussi bien le didactisme de Blaise de Vigenère que son style d’érudit. Les annotations comprennent l’introduction, un petit traité des guerres de la gaule, un traité des légions et disciplines militaires des Romains, un traité des fortifications des Romains, un traité des Alpes et des passages de France en Italie. Plus on progresse dans le texte, plus les annotations se réduisent : ce sont principalement des clefs pour comprendre les realia du monde romain et gaulois. Il vulgarise la meilleure science de l’époque. La traduction date de 1576 et prend place dans un débat lié à la conjonction d’intérêts politiques contre la monarchie : les monarchomaques protestants théoriciens des états généraux se joignent à la noblesse mécontente (dont le duc d’Alençon, propre frère du roi). Cette coalition ne va pas jusqu’à faire du roi un tyran, mais le présente en prisonnier d’une mère tyrannique : les Italiens sont décriés. Condé, malcontent, reçoit le soutien de Frédéric III le pieux, électeur Palatin, prince calviniste, et pénètre dans le royaume avec Jean Casimir, fils de celui-ci, et ses reitres. En dépit de la victoire du duc de Guise à Dormans, les troupes de Condé et de son allié reviennent avec 25000 hommes : la monarchie est menacée et obligée de négocier. Les allusions implicites de Vigenère à cette actualité sont nombreuses : il fait œuvre de vulgarisation mais aussi de propagande.
Cette conjonction explique l’épître dédicatoire adressée au roi, où Vigenère reprend tout le discours officiel de la monarchie(lecture). Son insistance est importante : il propose un modèle anti-monarchomaque, ou du moins en annonce l’intention. Son œuvre peut se lire comme une réponse à celle de François Hotman, un protestant exilé depuis la saint Barthélémy, auteur de la Francogallia, un traité d’histoire politique, où est proposé un modèle de gouvernement d’après l’histoire des Gaules. Pour ce dernier, un dysfonctionnement institutionnel, un écart entre la forme de gouvernement des Gaulois des Francs d’une part et celle des Français actuels est à l’origine de la guerre civile. Blaise de Vigenère propose un contre-Hotman en insistant sur la continuité des Gaulois aux Valois. On peut noter la prudence avec laquelle il ménage l’orgueil national. Sans doute est-ce, de la part du client de noble italien qu’il est, en rapport avec la méfiance vis-à-vis de l’italianisme. Le thème gaulois est populaire au moment de la publication de sa traduction de César, et les pamphlets anti-italiens font rage. Le discours de Blaise de Vigenère sur la façon dont le roi doit reconquérir les esprits n’a rien d’original : la vision d’un César à moitié brigand est répandue et se retrouve, pour ne citer qu’eux ; chez Etienne Pasquier ou chez Montaigne. Son éloge du roi est classique, mais assorti de conseils : il s’insère dans la propagande orchestrée qui veut rétablir l’estime pour le roi dans les esprits. En contexte, il renvoie aux débats de l’Académie du Palais commencés en février 1576, concomitamment aux réflexions sur la colère et sa légitimité en politique. Le duc de Nevers y tient un discours original, étayé par des arguments tirés de l’expérience plus que de l’érudition : la colère est nécessaire mais il est également nécessaire de la maîtriser. Son discours inclut un développement sur la clémence, la bénignité et la douceur, très proche, sans doute de l’air du temps : l’heure est à la négociation et à la modération. L’appel à la clémence s’inscrit dans un idéal anti-machiavélien et un appel à la négociation. L’appel de Vigenère ne s’adresse autant Henri III qu’il s’inscrit dans une démarche idéaliste et humaniste qui vise à influencer la monarchie à travers la diffusion des lettres.
Vigenère rend César accessible sans le déformer. Dans ses annotations, il infléchit la présentation dans le sens de l’actualité, à travers un parallèle entre les divisions entre les Gaulois et celles entre Français. Il semble répondre point par point à Hotman. Sur la question de l’effet de miroir, Vigenère est particulièrement original. Il le justifie par une équivalence entre les noms des tribus gauloises et ceux des provinces françaises. Par exemple, les Arvernes deviennent les Auvergnats. Cette démarche lui permet de développer des allusions politiques insistantes, et de se démarquer d’Hotman, qui voit une rupture entre Gaulois et Français. Pour Blaise de Vigenère, le tempérament querelleur du peuple gaulois et français explique la perte de leur liberté. Les annotations contiennent des allusions plus précises à la ligue, avec en particulier un développement sur les Grands qui se croient au dessus des autres. La traduction de César proposée par Vigenère est donc bien, à travers ses commentaires, une défense de la monarchie contre la thèse de Hotman. La solution proposée par Vigenère face aux troubles se trouve dans la préface au roi : c’est la solution prônée depuis longtemps par le duc de Nevers, spécialiste des expéditions militaires contre l’étranger (qu’il prônait déjà sous Charles IX). Pour le duc et Vigenère, la guerre contre les princes protestants permettrait de fédérer les nobles autour du roi. Le thème est beaucoup plus développé dans la suite des ouvrages de Vigenère. Il se livre à une sorte de construction d’idéal des croisades dès 1577. Nevers n’a jamais manqué d’idées d’expéditions lointaines (contre protestants de l’Empire). Vigenère, au début du septième argument de la Guerre des Gaules avance l’idée que les Français n’ont pas le naturel conquérant, ce qui expliquerait, selon lui, leurs querelles intestines.
Son évocation des difficultés du traducteur est un développement particulièrement savoureux de la traditionnelle excusatio : il recourt à la comparaison avec un écuyer qui pique le cheval d’un noble dans une ruelle au pavé glissant, sous les yeux d’une dame : la position, comme celle du traducteur, se prête bien moins aux belles figures qu’un exercice mené dans un champ au terrain égal et propice. Avec l’écuyer, qui peut être aussi un jeune noble, un type social se dessine. L’excusatio aux gentilshommes peut donc se lire en lien avec le thème, en tout cas avec le contexte de publication. L’art avec lequel Vigenère montre son érudition évoque l’art du Courtisan de Castiglione, dont il évoque le modèle dans le Traicté des chiffres ou secrètes manieres d’escrire. Sa traduction de César s’inscrit dans une salve de publications voulues par le roi, ou du moins dans la mouvance de celles-ci. L’éloge au roi est assez bien renseigné. C’est encore une façon de prouver sa fidélité au duc de Nevers : il ne participe pas seulement à une contre-offensive mais développe une marge de manœuvre. Avec ce polygraphe, la vulgarisation prend un tour hautement politique, mais jamais polémique : il ne cite jamais Hotman, mais pratique l’art de la transposition dans ses réponses.
Cette conclusion est suivie d’une question d’Isabelle Haquet : dans quelle mesure peut-on parler de liens directs entre Vigenère et le roi ? Paul-Victor demande à quel niveau se situe la question. Du point de vue biographique, on peut évoquer des traductions commandées par le roi. En effet, Blaise de Vigenère est le rival et l’émule d’Amyot. Le roi avait demandé à Amyot de traduire les Images de Philostrate, qui a répondu que c’était impossible : Vigenère a repris le flambeau. Après cette réponse,Isabelle reformule sa question, en demandant dans quelle mesure on pourrait parler d’un voile “nevérien” entre ce que transcrit Vigenère et les désirs d’Henri III ou s’il existe entre le roi et Vigenère des relations plus directes, qui ne soient pas médiatisées par un tiers : car l’anecdote ne relève pas d’une commande directe, mais passe aussi par l’intermédiaire de la rivalité avec Amyot. Paul-Victor cite l’exemple d’une plaquette de 1578 qui est une description d’une fondation pieuse faite par les ducs de Nevers. On a conservé une lettre où Vigenère explique au duc qu’il a retardé la publication parce que le portrait n’était pas satisfaisant. Isabelle répond que cela fonctionne pour le duc de Nevers, mais que le point d’achoppement qu’elle a rencontré dans ses propres recherches concerne plutôt les rapports de Vigenère à Henri III. Paul-Victor répond que la seule donnée assurée est le parallèle des idées : biographiquement, ce serait une recherche énorme que de déterminer le rôle exact de Vigenère à l’hôtel de Nevers et surtout pour Henri III. Frances A. Yates définit bien le problème en disant en substance dans une note que Vigenère a un rôle de second plan, mais de grande importance. Mais elle ne précise pas cette idée. La seule chose que l’on puisse affirmer est que Vigenère manifeste une volonté de coller au plus près aux positions du pouvoir, mais il n’a peut-être jamais vu Henri III personnellement. Vigenère semble aller toujours au devant des attentes du roi mais il n’y a jamais de contacts attestés. En ce qui concerne la traduction de César, ce n’est pas sa signification politique qui a été retenue lors de la publication ; de même pour la traduction des Histoires de Chalcondyle, qui retraçaient le déclin de l’empire byzantin, ouvrage publié en 1577 et réimprimé jusqu’en 1662. A propos de cette publication censée entretenir l’idéal de croisade, Nevers note dans son journal qu’à la sortie d’une séance du conseil, Catherine de Médicis s’est moqué de lui. Or Vigenère s’attache avant tout à Nevers.
Mathieu Mercier remarque à propos du travail de Paul-Victor que l’on pourrait écrire une histoire du règne d’Henri III avec les préfaces adressées, et en même temps l’histoire d’un règne imaginaire, presque fantasmé, ou tout du moins idéalisé. Paul-Victor répond qu’en effet, avec Blaise de Vigenère, on aurait sans doute un Henri III vu par Nevers. Il signale, pour l’entrée à Mantoue, une mise en scène implicite du duc de Nevers, qui est à la fois un hommage au roi et un signal qui lui dit que Nevers doit avoir une place importante dans son règne. C’est un point à étudier.
Fanny Oudin