CR Chorea : Marges – séance du 7 janvier 2012
Sont présents Anne Debrosse, Paule Desmoulière, Emiliano Ferrari, Enora Gault, Marie Goupil, Nicolas Kiès, Léa Lebourg-Leportier, Adeline Lionetto-Hesters, Geoffrey Lopez, Fanny Oudin, Diane Robin, Claire Sicard, Aurélia Tamburini, Ivana Velimirac, Hélène Vu Thanh.
Diane Robin : Introduction méthodologique au thème des marges
Anne Debrosse ouvre la séance en rappelant que nous passons, en ce début d’année, à un nouveau thème, “Les Marges”. Elle rappelle que le programme et l’introduction théorique du thème se trouvent en ligne sur le site Cornucopia et passe la parole à Diane Robin pour une introduction plus méthodologique.
Diane Robin commence par rappeler que les chercheurs s’intéressent depuis relativement peu de temps aux marges. De plus, cet objet pose des problèmes spécifiques qui le rendent malaisé à aborder et à étudier. En effet, les sources sont parcellaires parce que leur accès est souvent difficile voire impossible ou censuré. Cependant, on commence à s’y intéresser dans les années 1970, grâce à un tournant méthodologique majeur : il y a un regain d’intérêt pour les marginaux dans les mouvements novateurs en sciences humaines. Ce tournant a lieu sans doute grâce à l’histoire cuturelle et à l’histoire des mentalités, qui s’intéressent aux anonymes, aux exclus et à la culture populaire, ce qui tranche avec l’histoire traditionnelle, centrée sur la politique et les figures dominantes.

Le phénomène traverse les sciences humaines puis arrive dans la recherche en littérature et en histoire de l’art. Référence fondamentale, l’œuvre deMichel Foucault est centrée sur des marginaux, que ce soit dans ses écrits avec les fous dans l’Histoire de la Folie (écrit dans les années 60, paru dans les années 70) et les criminels dansSurveiller et punir (1975), ou dans ses cours au Collège de France, où il se penche sur les sorciers, les hermaphrodites, etc. Les marginaux, les marges, lui permettent d’analyser les rapports de forces qui régissent la société, notamment les processus d’exclusion et les processus disciplinaires.
Les travaux de Foucault ont inspiré de nombreux courants de la recherche, notamment les Cultural Studies et la sociologie de la déviance (Howard Becker). Avec le courant des Annales, sous l’impulsion de Roger Chartier, l’histoire s’y intéresse tout particulièrement. La micro-histoire se penche sur le marginal sur tous les plans, qu’il s’agisse d’étudier une région reculée, un marginal dans son village ou un hérétique.

Carlo Ginzburg écrit alors un ouvrage pionnier, devenu une référence de la micro-histoire : Le Fromage et les vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle (1976), sur lequel Diane va revenir plus loin. La philologie anglo-saxonne a également été influencée par la micro-histoire : on s’intéresse aux marges des livres, aux annotations, aux notes de bas de page… dans les années 1970, comme le montrent les travaux d’Anthony Grafton (référence qu’Olivier Pédeflous a donnée à Diane).
Il y a une même réflexion sur les marges en littérature. Patricia Eichel-Lojkine (Excentricité et humanisme : parodie, dérision et détournement des codes à la Renaissance, 2002) réfléchit sur la culture marginale et les rapports qu’elle entretient avec la culture dominante à la Renaissance. Elle voit un lien étroit entre culture et contre-culture et une instabilité permanente entre ces deux pôles, ce qui fait qu’il n’y a pas un centre qui rejette dans les marges ce qui n’en fait pas partie. Elle étudie le détournement parodique des codes par exemple (chez Rabelais et Érasme notamment). On s’intéresse également depuis peu à l’argot, aux dialectes, aux usages déviants de la langue, ce qui est « aux marges du bien-dire »(pour reprendre le titre d’un colloque organisé par Anna Carlstedt et Christophe Clavel, « Aux marges du bien-dire. Marginalité et langue littéraire en France au XVIe siècle », qui s’est tenu le 5 février 2011 à Paris-Sorbonne). Enfin, la même tendance se trouve en histoire de l’art. Eugenio Battisti met en lumière un vaste courant de réaction à la culture classique. Il remet en cause l’idée d’une Renaissance centrée sur la beauté, policée, conçue comme une civilisation des mœurs. On s’intéresse aux contre-cultures et à la représentation des grotesques, de la laideur, de la monstruosité.
Fanny Oudin intervient pour souligner que la Renaissance est un grand mouvement de codification esthétique et éthique : tous ceux qui sont en marge apparaissent vraiment comme une contre-culture. Elle s’interroge sur la question de la culture savante et/ou populaire, qui lui inspire un lien avec le Moyen Âge, notamment la question du public du fabliau : s’agit-il d’une littérature populaire, savante, courtoise ? Les auteurs du XXe s. se sont-ils intéressés à ce qui précède la Renaissance, notamment dans le cadre de la question de la parodie ? Diane et Fanny en débattent : il y a une culture qui se formalise, ou plutôt se normalise, puisque la formalisation est déjà très en place au Moyen Âge, notamment dans la poésie orale (selon Paul Zumthor). En fait, la formalisation (peut-être liée oralité) s’oppose à la normalisation. Diane répond que l’idée de « bon langage » est plus spécifique de la Renaissance. Fanny enchaîne sur la question du dialecte et du patois : le passage du dialecte ou patois au « bon langage » pourrait être un exemple de cette normalisation. Diane souligne que la Renaissance glorifie les langues vulgaire et les distingue des dialectes : il s’agit d’en faire des normes. Par réaction, des auteurs choisissent délibérément de subvertir ces normes, comme dans le cas des contre-académies italiennes. Certains artistes et certains écrivains parodient le système. Les contre-académies mêlent culture savante et populaire. La tendance de la recherche à étudier les marges est très pertinente parce qu’elle se trouvait déjà au XVIe siècle, qui avait la volonté de montrer un lien entre cultures populaire et savante. Pour les savants des Académies et des Contre-Académies, la culture populaire n’est pas réduite au folklore.

Un intérêt pour l’exclusion se lit en histoire : il ne s’agit pas d’un intérêt pour la singularité des exclus ou pour leur isolement, mais les études sur l’exclusion permettent de mettre en lumière le rapport complexe entre culture populaire, marginale, et culture dominante (cf. Ginzburg). Les marges présentent un intérêt pour étudier le centre. Par exemple, en histoire de l’art, Daniel Arasse propose une histoire du détail (ou marges au sens d’« élément périphérique »), qui est très cultivé dans les tableaux de la Renaissance. Il n’est pas forcément nécessaire à la compréhension du tableau. Ce peut être un détail cher au peintre et entièrement personnel. Cependant, il a un double intérêt pour l’éclairage des normes. Lorsqu’il fait écart, lorsqu’il présente une anomalie par rapport à la composition générale, le détail permet un nouvel éclairage sur le tableau, une remise en cause des interprétations traditionnelles. Et lorsqu’il est une petite note vraie et virtuose, il est emblématique de la question centrale de la mimesis (rivaliser avec la nature). Les détails peuvent être emblématiques du processus de représentation adopté par le peintre et du processus de perception engagé par l’auteur tableau. Le cas des grotesques est tout aussi intéressant à cet égard, selon l’analyse qu’en fait Philippe Morel : elles peuvent apparaître comme des détails par leur taille réduite, et ce sont des figures marginales (érotiques, hybrides…) aux marges de l’espace pictural.
Emiliano Ferrari intervient alors pour parler du fonctionnement métaphorique des marges, qu’il estime similaire : l’images des grotesques est utilisée pour expliquer le fonctionnement même de la pensée, certains modes de pensée. Montaigne justifie ses Essais comme des grotesques qui circulent en marge d’un texte – celui, originel, de la Boétie, mort entre temps (le Discours sur la servitude volontaire n’avait pas été publié) – donc autour d’un centre vide. Les grotesques illustrent le désordre de la pensée qui s’oppose à la pensée logique et organisée, comme par exemple le syllogisme : la pensée qui n’arrive pas à mettre d’avant ni d’après est considérée comme désordonnée, car elle s’oppose à Aristote, qui est un modèle dominant. La grotesque est ainsi une figure pratiquée pour retrouver une émancipation de la pensée (voir Jean Céard, La nature et les prodiges. L’insolite au XVIe siècle en France).
Diane reprend qu’il y a beaucoup de liens à faire entre grotesques et pensée.
Emiliano précise qu’il n’y a pas forcément un rapport de raison, qu’il ne s’agit pas simplement d’exprimer une pensée fantaisiste. En fait, Montaigne utilise cette métaphore pour développer une épistémologie, un fonctionnement de la pensée. Il peut aussi parler des Essais comme des excréments de son esprit : il fait appel à toutes les figures de la marginalité.
Nicolas Kiès réagit en disant qu’il peut prendre la figure de la bassesse de la marginalité pour pouvoir innover sans le dire, sur le mode « Je vais vous répéter ce que disent les Indiens, qui délirent, ne croient pas en Dieu, mais quand même je vais le répéter ».
Ivana Velimirac suggère que la grotesque, chez Montaigne, ne symbolise pas uniquement le désordre, mais un mouvement de circulation, un cercle jamais fini, qui fuit toujours en avant. Chaque chapitre est en effet composé selon cette structure. Il y a donc un mouvement clair dans ce désordre. La grotesque se présente comme élément visuel également.
Fanny pose alors la question du Baroque. Diane lui répond que, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, le Maniérisme s’intéresse aux grotesques pour elles-mêmes, elles s’affranchissent du cadre. Cela peut conduire au Baroque.
Emiliano rappelle qu’à Florence, à l’époque du baroque, on faisait des jeux sur la perspective. Montaigne avait fait peindre des grotesques chez lui : la grotesque n’a donc pas droit de cité que dans la noblesse des grandes villes, elle se trouve aussi chez un gentilhomme campagnard.
Anne revient sur l’idée du détail qui fait sens, mais seulement au bout d’un moment. Le détail peut se présenter sous l’apparence de choses malléables qui commencent à perdre forme grâce à un effort du regard (par exemple, c’est le cas pour l’anamorphose dans Les Ambassadeurs d’Holbein).
Fanny souligne que le rôle du détail est très différent de celui du Moyen-Âge.
Emiliano poursuit que, pour l’histoire de la pensée, ces questions sont importantes car Montaigne est lu par Descartes, Pascal etc. Montaigne introduit dans la philosophie une attitude de pensée qui relève d’une autre attitude épistémologique.
Fanny rappelle que Montaigne s’oppose ainsi à Thomas d’Aquin.
Emiliano pense qu’il s’oppose également à Aristote, qui enchaîne des raisons. Le XVIIe siècle reprend une attitude, celle de Montaigne. Montaigne recompose la pensée à partir d’un nouveau centre qui est le moi. Il s’oriente ainsi vers la subjectivité. Les grotesques lui permettent de se débarasser des processus de pensée véhiculés par les autorités, elles représentent une méthode de pensée différente, par association notamment, plus que par dialectisme : il propose ainsi une nouvelle méthode de pensée à ses successeurs. Le Discours de la Méthode de Descartes s’ouvre sur une phrase tirée de Montaigne.
Adeline Lionetto intervient pour rappeler la présence des grotesques chez Rabelais, avec les Silènes.
Paule Desmoulière revient alors sur le problème des relations entre Académies et Contre-Académies. Les Contre-Académies ne font-elles que se moquer purement et simplement des Académies savantes ? Les Académiciens ont plutôt une double casquette.
Diane approuve : les contre-académiciens sont des académiciens qui ont pignon sur rue et qui tournent en dérision l’esprit de sérieux.
Selon Paule, cependant, ce n’est pas parce qu’on critique l’esprit de sérieux qu’on critique la culture savante : au contraire, c’est peut-être en jouant avec la culture savante qu’on la commente le mieux. Les « académies pour rire » sont peut-être pour eux une autre façon d’aborder la même chose.
Selon Diane, néanmoins il y a dimension polémique, les contre-académiciens contestent vraiment les canons. C’est l’époque de la Contre-Réforme, qui proscrit ce qui est bas. On refuse l’utilisation du dialecte, on procède à une codification du toscan. De plus, il y a une radicalisation de part et d’autre. Dès lors, les contre-académiciens prennent donc le contre-pied des Académies. D’ailleurs, il n’y a pas qu’une dimension ludique : ils vont très loin, à tel point qu’ils vont être censurés, comme l’Academia del Val di Blenio à Milan dans les années 1560. À Rome, avec les grands poètes bernesque, c’est moins important : on va plutôt dans le sens d’un jeu avec les canons sans dimension polémique car, à l’époque, on accepte mieux les jeux qui portent sur les genres. Il y a une nette évolution entre les décennies 30-40 et 50-60).
Fanny pense que le système décrit par Paule est plus proche des pratiques du Moyen Âge.

Giovanni da Udine, Décoration d'un plafond, Villa Madama, Rome 1520-21 (source : wga)
Diane reprend ensuite le cours de sa présentation de l’histoire et des méthodes de la recherche sur les marges et la marginalité.
Ces nouveaux objets d’étude stimulent l’élaboration de nouvelles méthodes de recherche : Foucault développe son Archéologie du savoir à partir de ses travaux sur les marginaux (cet ouvrage se trouve juste après sa thèse sur la folie). Il y a des points de convergence entre son Archéologie et l’histoire des idées, car il définit son approche comme une histoire des marges et des mentalités. Il propose non pas une histoire des sciences mais une histoire des connaissances imparfaites, mal fondées, qui n’ont jamais atteint le stade de la scientificité (démonologie…) qui hantent les littératures, l’art, les sciences, le droit, la morale et la vie quotidienne. L’histoire des mentalités implique une confrontation avec des savoirs inédits qui se trouvent aux marges de la littérature, comme ce qu’on a appelé des sous-littératures, comme les almanachs, journaux, auteurs « inavouables »… C’est en confrontant ces types de discours en marge aux savoirs canoniques qu’on peut reconstruire les mentalités de tout un groupe en raison de la nature hybride de l’objet. Les recherches sur les marges appellent une approche nécessairement pluridisciplinaire et comparatiste.
Méthodologiquement, l’approche microscopique de l’objet est souvent privilégiée. Elle sert ensuite à tirer des implications pour caractériser l’ensemble. Ainsi, parce qu’il est difficile d’appréhender la culture populaire – ce qui explique pourquoi il se focalise sur un élément et un cas limite à la marge – Carlo Ginzburg a initié une méthode de recherche spécifique. Il élabore une méthode du paradigme indiciel : il reconstruit la vie et l’univers mental d’un individu à partir de sources parcellaires, et il se base sur une figure singulière pour réfléchir sur la mentalité général, c’est-à-dire qu’il part des individus pour faire émerger des pratiques sociales. Des points de convergence se dégagent donc entre micro-histoire et histoire de la peinture (avec l’analyse du détail) : on plaide pour une histoire rapprochée de la peinture, en opposition avec une histoire « de loin », qui consiste à appréhender la composition dans son ensemble en hiérarchisant les éléments du tableau et en cherchant UNE interprétation, un seul sens dominant (sens spécifique qui dépend de la façon dont le sujet a été traité). La recherche sur les détails permet de nuancer la conception traditionnelle de la recherche en histoire de l’art en ouvrant à une pluralité de significations. Le point de convergence entre ces deux courants de recherche se trouve dans un nouveau rapport avec l’objet de recherche, fondé sur l’intimité. Par exemple, l’artiste peut cultiver des détails qui ne sont pas destinés à être vus du commanditaire ou du spectateur, donc il peut intégrer en détail ses marottes : l’intimité du peintre dans le tableau devient centrale. La même chose se passe dans la micro-histoire, qui se développe en récits.
Pour conclure, ce qui passionne les chercheurs dans les recherches sur les marges, c’est le rapport de proximité, l’intimité avec l’objet alors qu’il est censé être éloigné de nous. C’est l’une des raisons qui peut expliquer l’engouement des chercheurs pour ces nouvelles approches.
Anne pose une question sur Montaigne : l’idée de la marge où on va chercher du nouveau (au sein d’un discours de la bassesse) ne viendrait-elle pas de Plutarque ? Il y a des sources antiques où on avait déjà une volonté de rechercher du nouveau à travers des exemples qu’on ne connaissait pas (par exemple, dans les Mulierum Virtutes, Plutarque rejette dans son prologue les exemples trop connus comme Sappho pour se consacrer à des figures obscures). Il s’agissait d’une réflexion qui ne fonctionnait pas forcément par analogie mais qui cherchait un mode de pensée différent.
Emiliano répond que Montaigne a construit un bestiaire dans l’Apologie de Raymond Sebond, et que cette figure de l’animalité vient de Plutarque. On trouve même chez Montaigne des éloges du daimon de Socrate et du« connais-toi toi-même » qui viennent sûrement de Plutarque, où Montaigne puise sans cesse. Notamment, Plutarque a une méthode de pensée qui ne dit pas tout et laisse la réflexion personnelle prendre la suite (ce qui est illustré avec l’image des danaïdes, qui figurent l’inépuisable, et de Plutarque qui montre avec le doigt). Chaque lecteur invité à faire le même geste que Montaigne dans les Essais : il ne cherche pas l’exhaustivité. C’est important même pour la pensée de l’Âge classique (même si ça n’est pas très montaignien, dans le sens où c’est méthodique). Pour Francis Bacon la recherche ne doit pas contraindre le mouvement, ne doit jamais être finie : elle doit être continue. L’idée que la pensée est moins exhaustive, plus allusive, est utilisée pour mettre en crise un cadre qui n’était plus satisfaisant. Il y a une exigence de débrider le jugement. Le dogmatisme des autorités « tyranniques » est remis en cause. Paysans, cannibales, enfants, monstres sont des figures marginales déjà convoquées par Montaigne contre les figure dominantes. La vertu et la morale ne s’apprennent pas à l’école.
Anne réagit en revennant sur l’idée de Paule, sur la marginalité des contre-académiciens. Il y a aussi une marginalité dans les autorités, et pas seulement dans la culture populaire ou exotique : dès la fin du XVe siècle, Politien remet en cause les auteurs classiques (Cicéron et Virgile) pour leur substituer d’autres autorités antiques (Stace et Quintilien), moins connues. L’engouement pour le grec semble venir du même processus de remise en cause des autorités traditionnelles grâce à l’évocation d’autorités aussi anciennes mais atypiques. Le grec contre la domination du latin : il est plus ancien, pas moins légitime, et plus difficile à comprendre. Une partie de l’auditoire de Politien ne comprenait pas ses cours de grec, ou à moitié seulement, et Politien faisait exprès d’avoir un niveau très élevé. Par conséquent, les marges ne sont pas forcément identifiables avec la bassesse ou le populaire, mais se définissent par la minorité. Avec Politien, l’érudition pointue, obscure, est une forme de marginalité, ainsi que l’érudition qui s’attache à la mise en avant de nouveaux modèles, en-dehors des auctoritates.
Emiliano reprend la parole avec l’exemple de la pensée de Sextus Empiricus et du scepticisme : il s’agit d’une pensée marginale. Il est d’accord que les marges ne sont pas l’apanage du populaire. Elles incarnent peut-être une autre culture savante. La culture savante grecque pouvait être marginale.
Fanny souligne les liens entre la pensée de Montaigne et la méthodologie de l’anthropologie : il y a une même mise en valeur des marges grâce à un regard de l’éloignement. Il s’agit prendre une distance pour penser les marges.
Anne rappelle l’idée de la relativité du regard. Ce qui nous paraît central est en fait marginal et vice-versa.
Emiliano rappelle les liens entre Montaigne et Sextus Empiricus, qui partagent le relativisme. Une vérité est toujours conditionnée par un réseau d’éléments.
Fanny précise que Montaigne considère que si Platon avait vu la société cannibale, sa vision de la société idéale aurait été transformée. Il retourne le savoir antique pour réfléchir à une nouvelle société.
Emiliano approuve : le sauvage entre dans une constellation de figures (animal, paysan) qui sont utilisées de manière critique.
Adeline donne une autre référence pour approfondir l’idée : dans le livre III, Montaigne prend des distances par rapport aux grands principes de l’humanisme. Il met en avant la vanité du savoir par opposition au principe de l’innutrition. On en fait souvent un humaniste alors que c’est une grande figure du contre-humanisme ou du second humanisme.
Emiliano acquièsce : Montaigne arrive quand l’humanisme est fini, il y a d’ailleurs un fantasme de la fin du monde avec les guerres de religion, qui empêchent toute vie social : la vie devient lourde pour lui face au grand idéal dans lequel il a commencé sa carrière. À la fin du troisième livre, les choses sont changées.
Adeline dit que Montaigne ne présente plus le savoir comme un aliment mais comme un poison, qu’il est vain et répond à un sentiment d’orgueil, à une volupté de savoir.
Nicolas revient sur l’idée en disant que certes, la deuxième moitié du XVIe siècle est sombre, mais que dès le début du siècle, il existe un courant critique de l’humanisme qui le travaille. « Le vers est dans le fruit » dès le début de l’humanisme (Philippe Desan). Dans la deuxième moitié du siècle, le courant critique qui était dans l’humanisme s’en sépare, d’où la complexité qu’il y a à parler de contre-culture : les deux sont indissociables.
Emiliano dit que pour Montaigne, l’homme n’est plus un animal ni raisonnable ni sociable. L’homme tel qu’on l’a connu avant lui est mort.
Léa Lebourg-Leportier : “Littérature de gueuserie et représentations de criminels à l’époque moderne : le cas de Guilleri”
Après une pause qui nous permet de fêter les rois de la tradition catholique et le noël de la tradition orthodoxe, nous reprenons nos activités avec une communication de Léa Lebourg-Leportier. Léa est doctorante en littérature comparée sous la direction de François Lecercle, à l’université Paris-Sorbonne, et travaille sur “Les discours de l’échafaud en Angleterre et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.” Dans ce cadre, elle a effectué un retour aux sources de la littérature sur les brigands, qui puise ses racines dans le XVIe siècle, et nous propose une communication sur un célèbre bandit du début du XVIIe siècle, Guilleri.
Léa présente tout d’abord la figure du gueux et la littérature de gueuserie et la représentations de criminels et voleurs au XVIe s., afin d’arriver au cas de Guilleri (début XVIIe s.).
Roger Chartier, dans son article intitulé « La “Monarchie d’argot” entre le mythe et l’histoire » (1979), écrit que c’est dans la représentation de ses marges qu’une société met le mieux en valeur ses normes. La figure du gueux apparaît comme le paradigme de la marginalité sociale. Mais qu’est-ce qu’un gueux ? Le terme recouvre une catégorie sociale large et variée. Il s’agit d’individus non sédentaires qui mendient pour vivre. Ce peut être d’anciens soldats blessés et désœuvrés, des étudiants pauvres, des chômeurs, des vagabonds… Ils sont souvent assimilés à des charlatans ou à des escrocs qui abusent de la crédulité des passants : ils mènent leur vie à la limite de la légalité. Les gueux représentent une frange assez large de la population, c’est-à-dire entre 5 et 8% de la population en temps normal et 20% en temps de crise selon Roger Chartier. Leur marginalité finalement n’est pas tant quantitative qu’idéologique. Ainsi, Ambroise Paré associe gueux, mendiant et monstres (tous sont inclus dans Des monstres et prodiges, 1573). Monstres et mendiants menacent l’ordre, qu’il soit naturel ou social. L’idée que le gueux serait une menace pour l’ordre social se répand au XVIe s. Cette inquiétude croissante a pour conséquence que la répression s’intensifie. Le gueux perd le statut d’élu de Dieu qu’il avait au Moyen Âge. Sa pauvreté devient suspecte et dangereuse, et justifie certains processus d’exclusion et de répression.
Pourtant, il fascine aussi au XVIe s. Brantôme, dans ses chroniques, rapporte que le roi Charles IX aurait invité des bohémiens pour faire des démonstrations de leurs tours à la cour. Au même moment on assiste à la naissance ou au développement de traditions littéraires comme le roman picaresque espagnol, qui est un véritable succès européen. La littérature de gueuserie se développe fortement au XVIe s.
Léa propose quelques titres et un panorama européen de cette littérature qui s’ouvre au XVe s. :
- Le Speculum cerretanorum de l’Italien Teseo Pini, en latin (1484-1486).
- Le Liber vagatorum (anonyme) en Allemagne (1510).
- Des livres qui dévoilent des ruses de filous et de prostituées sont publiés en Angleterre. Il s’agit de Vade mecum qui avertissent des stratagèmes de brigands. Par exemple, La fraternité des vagabonds, de John Awdeley (1561).
- En France : Advertissement, antidote et remede contre les piperies et les pipeurs (1587) ; La Vie généreuse des Mercelots, Gueuz et Boesmiens, contenans leurs façon de vivre, subtilitez et Gergons, de Pechon de Ruby (1596).
Cette littérature se veut documentaire et didactique : il s’agit d’exposer les tours des gueux pour prémunir contre leurs escroqueries. Léa cite un passage de La Vie généreuse des Mercelots, Gueuz et Boesmiens : « Si j’avais eu temps d’écrire les bons tours que j’ai vu faire à ces trois sortes de gens, il n’y aurait volume plus gros. Ces folies meslées de cautelles c’est afin que chacun s’en prenne garde » (p. 98, éd. Champion, 2007). Ces ouvrages sont conçus comme des manuels qui décrivent les codes des bandes de vagabonds. La Vie généreuse présente trois groupes : les merciers (marchands ambulants souvent considérés comme voleurs), les gueux et les bohémiens. Chaque groupe a ses codes spécifiques. On décrit aussi le langage secret par lequel ils communiquent, le « jargon ». « Jargon » devient « argot » aux XVIIIe s., mais au XVIe s. « argot » est réservé au groupe des gueux lui-même. Ces récits intègrent souvent des dictionnaires de jargon. En ce sens, la littérature de gueuserie reprend une tradition ouverte en France au milieu du XVe siècle par un document judiciaire sur la bande des coquillards de Dijon et par les ballades en jobelin de Villon. Tous ces textes de la littérature de gueuserie participent à la constitution d’une imagerie, d’une série de motifs qui seront repris pour décrire d’autres représentants de la marginalité sociale et de l’illégalité au cours des siècles ultérieurs (comme les bandits de grands chemins).

Lagniet, Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres... le troisième des gueux en proverbes, Paris, c. 1657-1660 (source : Wikipedia)
Parmi les motifs dont la postérité littéraire a été importante, on trouve la « monarchie argotique ». Le monde des vagabonds apparaît comme un microcosme, un état dans l’État, avec un roi, des institutions et une langue. Une gravure contenue dans un ouvrage de Jacques Lagniet, le Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres… le troisième des gueux en proverbes (c. 1657-1660), illustre cette « monarchie argotique ». Au centre, le grand Coesre [prononcé « querre »] ; à ses côtés, un cagou, sorte de lieutenant : cela montre la présence d’une hiérarchie, car il est le deuxième en titre après le roi. Les membres du groupe ont des dénominations ironiques : la gueuse est appelée « la marquise ». Le titre de l’ouvrage de Pechon de Ruby use du même procédé : la “vie généreuse” est évidemment ironique. C’est une façon parodique de parler de leur vie. Le métier de gueux est présenté ironiquement comme un métier honnête. Tout cela pérennise l’image comique et facétieuse du voleur habile en tours et en dissimulations. Mais c’est éloigné des réalités historiques, car les bandes de gueux étaient en réalité moins hiérarchisées, plus spontanées. En tout cas, ces représentations fictives influencent durablement la littérature moderne sur les criminels.
C’est le cas d’un bandit du Poitou de la fin du XVIe siècle : Guilleri. À travers son exemple, il s’agit d’examiner le rôle de ces motifs hérités du XVIe siècle dans la représentation du criminel et en particulier dans sa mythification.
L’histoire
Guilleri est un personnage historique : il sévit dans le Poitou dans les années 1604-1608. Son arrestation est évoquée par les journaux de Merlin et de Pierre de l’Estoile (texte cité par Jean Lavallée dans Compère Guillery, bandit du Poitou, Geste éditions, 1991, p. 132.).
Sa vie est connue grâce à un rapport administratif du prévôt du Poitou, M. de la Gestière, qui détaille les opérations et les finance pour capturer Guilleri. Le prévôt demanda au roi le remboursement de ses frais, mais il ne fut jamais remboursé. Cependant, il fut anobli pour les services qu’il avait rendus. À partir de ce compte-rendu administratif, Jean Lavallée (Compère Guillery, bandit du Poitou, 1991) tente de reconstituer la vie de Guilleri. Né en 1566, fils de maçon, il est l’aîné de sa famille. Il est engagé dans l’armée royale puis dans les troupes de la Ligue qui sont licenciées en 1598. Désœuvré, il se retire à Machecoul, où, selon toute probabilité, il se met à voler. Il constitue une troupe de 30 à 40 hommes pour voler sur les chemins de foire de Fontenay et de Niort. Guilleri engendre une frayeur générale. Le prévôt est alors appelé pour poursuivre les bandits. Dans son rapport, il décrit les attaques sans succès qu’il mène : les bandits bénéficient de l’aide du peuple, soit par solidarité, soit par crainte de représailles. Face à ces difficultés, il se joint au comte de Parabère lieutenant-général du Poitou. Ils capturent quelques bandits en 1606, dont Guillaume Guilleri, fils de Philippe Guilleri. Guillaume est roué. Après son exécution, Philippe s’enfuit à Bordeaux où il se déguise en marchand de vin. Reconnu au bout de deux ans, il envoyé à la Rochelle pour y être roué de coups (1608). Les derniers bandits de la bande seront arrêtés en 1612.
La légende et les récits littéraires
Une sorte de légende se constitue à partir de ce personnage historique, dont il reste peu de choses dans les multiples textes (notamment les pièces de théâtre au XIXe s.) qui lui donnent souvent une origine noble : on invente le mythe d’un grand seigneur méchant homme, de noblesse bretonne et non plus d’origine pauvre. Deux images principales se dégagent : l’une fait du voleur un monstre, l’autre, un bandit au grand cœur qui ne vole pas les pauvres, qui ne vole qu’à moitié les riches et qui hait les assassins.
La bibliothèque municipale de Poitiers possède un exemplaire du premier texte qui prend Guilleri pour personnage principal, un ouvrage anonyme intitulé Les cautèles, finesses et subtiles inventions de volerie qu’a usé le capitaine Guillery et ses compagnons (1608). Guilleri est une figure instable : il est à la fois généreux – il aide une jeune fille qui a égaré une vache – et cruel – il pend le bourreau de Nantes qui a tué son frère.
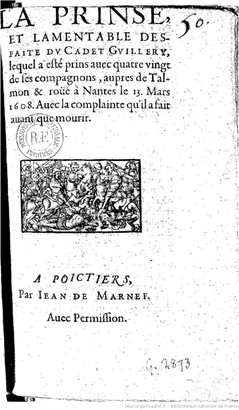
Page de titre de l'anonyme publié chez Jean de Marnef (source : Gallica)
L’image négative prévaut dans deux occasionnels de 16 pages publiés juste après le supplice de Philippe Guilleri en 1609.
- L’un est imprimé chez Jean de Marnef à Poitiers, La Prinse et lamentable desfaite du Cadet Guilleri lequel a esté prins avec quatre vingt de ses compagnons auprès de Talmon et roué à Nantes le 13 mars 1608. Avec la complainte qu’il a fait avant que de mourir [sa page de titre est donnée en illustration ci-contre]. Il est inexact du point de vue de l’histoire puisqu’il confond Guillaume et Philippe.
- L’autre, chez Abraham de Meaux la même année, La Prinse et deffaicte du Capitaine Guillery, qui a esté pris avec soixante et deux volleurs de ses compagnons, qui ont esté roüés en la ville de la Rochelle le vingt-cinquième Novembre 1608. Avec la complainte qu’il a faict avant que mourir, est plus exact du point de vue historique.
Pour mémoire, Léa revient sur la définition des occasionnels (selon Jean-Pierre Seguin, qui a publié Canards du siècle passé en 1969 etL’information en France de Louis XII à Henri II en 1961) : ce sont des imprimés d’information non périodiques. Avant les années 1630 (date où arrivent les premières gazettes), ils font à peu près 10 cm de large sur 16 cm de haut, et ont entre 6 et 16 pages. En France, ils naissent au moment des campagnes de Charles VIII en Italie. Il s’agit alors de brochures rédigées à partir de lettres de correspondants (par exemple, c’est le cas pour la prise de Naples en 1495). Dès le début du XVIe s., il existe deux sortes d’occasionnels :
- des occasionnels qui rapportent des faits historiques, en général bien informés parce que les éléments sont donnés par des correspondants qui se trouvent sur place. Ils touchent toutes les catégories de lecteurs. Des mémorialistes contemporains les ont utilisés comme sources.
- des pièces qui relatent des faits divers, souvent pleines d’inexactitudes et d’exagérations.
Les canards, textes sur les crimes, prodiges et monstres en tous genres, naissent dans cette deuxième catégorie. Dans les deux occasionnels de 1609 (Marnef et Meaux), Guilleri apparaît comme un monstre et il y a des propos sur l’inévitable justice divine (les deux occasionnels portent des titres différents mais leur texte est quasiment identique). Par exemple, dans l’édition d’Abraham de Meaux :
« depuis que l’homme a faict alliance avec l’ennemy de son salut, bronchant [= tombant] parmy les tenebres de son erreur, il ne cesse de courir à perte d’aleine, jusques à ce qu’il se trouve sur le bord du précipice, où à la fin l’autheur de ses desbauches le fait tresbucher, & en fait un joüet d’un funeste supplice, & le spectacle d’une piteuse tragédie » (p. 3).
Le criminel a une image plus positive à la fin, quand il se soumet au châtiment, mais il s’agit moins de valoriser le bandit que de montrer l’éclatante réussite de la justice royale.
La perspective négative se prolonge au-delà des années qui suivent la mort de Guilleri : François de Calvi, qui écrit un Inventaire et Histoire générale des Larrons en 1631, propose un inventaire général des larrons qui a pour fonction documentaire de faire connaître les techniques des larrons. Un portrait d’un “capitaine Lycaon “, pseudonyme pour Guilleri, y apparaît. Calvi reprend des extraits d’occasionnels sur Guilleri. Il insiste sur les épisodes de cruauté, par exemple quand Guilleri coupe le bras d’un homme qu’il voulait voler et qui n’avait pas d’argent sur lui parce que, en prévision d’une éventuelle attaque, il avait fait transiter l’argent autrement, par un messager.
![Théâtre de l'ambigu-comique. Compère Guillery, mélodrame ; 4e tableau, la ferme du Ravin : [estampe] (source : gallica)](http://cornucopia16.com/wp-content/uploads/2014/01/théâtre-de-l-ambigu-comique-compère-guillery-mélodrame-4e-tableau-la-ferme-du-ravin-estampe-source-gallica.jpg)
Théâtre de l'ambigu-comique. Compère Guillery, mélodrame ; 4e tableau, la ferme du Ravin : [estampe] (source : gallica)
- Il n’est pas un criminel au départ, il débute sa carrière de bandit parce qu’il est poursuivi par les autorités pour un acte considéré comme criminel par elles mais pas par son entourage traditionnel (par exemple, pour Guilleri, la contrebande n’est pas perçue comme illégale mais comme une sorte de coutume, ce qui la légitime).
- Le bandit apparaît comme un redresseur de torts
- Il prend aux riches pour donner aux pauvres
- Il ne tue que par légitime défense ou par juste vengeance (mais les auteurs de la Bibliothèque bleue abandonnent l’épisode où Guilleri venge son frère en tuant son bourreau). S’il survit, il revient chez lui et devient un honorable citoyen et un membre respecté de la communauté.
- Cette communauté l’admire et le soutient.
- S’il meurt, c’est uniquement parce qu’il est trahi.
- Il est au moins théoriquement invisible et invulnérable. De plus, il n’est pas l’ennemi du roi ou de l’empereur, source de justice, mais seulement des tyrans locaux (seigneurs, clergé).
Guilleri correspond tout à fait : quand il est soldat, il est admiré de tous, et une fois voleur, il ne vole que les riches, et de moitié seulement. C’est le pauvreté qui le mène au vol mais il le regrette et se range à la fin de sa vie.
Cet aperçu met en relief les motifs de la littérature de gueuserie. Il montre que dans les deux cas, on délaisse la vérité historique pour construire un mythe, négatif ou positif, que ce soit brute ou un redresseur de torts. Pour cela, on utilise des motifs connus adaptés au public et à la figure à construire. Dans les occasionnels déjà, on retrouve des motifs littéraires de la littérature de gueuserie. D’abord, celui d’un microcosme hiérarchisé et très bien organisé comme dans un épisode où Guilleri fait visiter sa forteresse à un gentilhomme qu’il a capturé :
« [Ils] luy monstrerent tout la dedans force munitions tant de guerre que pour la vivre avec un moulin à bras & un four, des petites pieces de capaignes, à force mousquets, & arquebuses, picques, grenades, petards & autres engins tant pour l’offensive que pour la deffensive, puis les autres fortifications des fossez à pleine cuve, un pont levis avec un ravelin enclos d’une palissade, & pour dire en un mot, il y remarqua tant de fortifications qu’il luy sembloit imprenable » (p. 10).
De même, des 30 ou 40 hommes dans la bande de Guilleri dont parlait Le Geay, on passe à 400 hommes. Enfin, comme les faux mendiants du XVIesiècle, l’habileté de Guilleri semble le rendre invisible. Mais, si dans les occasionnels ces topoï permettent de dresser le portrait d’un ennemi redoutable pour le royaume, dans les versions plus positives, ils rendent le bandit sympathique.
C’est le cas dans la version de la Bibliothèque bleue qui semble être la plus proche de l’héritage de la littérature de gueuserie. En effet, comme dans le récit de Pechon de Ruby par exemple, le texte est divisé en chapitres et présente ainsi l’histoire du bandit comme une accumulation de bons tours. Le chapitre intitulé « Comme il vola un Paisan en lui faisant prier Dieu » est significatif. Guilleri demande à un paysan qui fait route pour La Rochelle s’il a de l’argent. Le paysan répond que non, Guilleri l’enjoint alors à prier Dieu avec lui pour en recevoir. Guilleri fait mine de trouver quelques pièces et demande au paysan s’il en a lui aussi reçu. Le paysan se montrant récalcitrant, Guilleri finit par le fouiller et lui vole la moitié de l’argent qu’il dissimulait en soulignant que c’est grâce à lui que le paysan a reçu de l’argent et que par conséquent, il mérite de récupérer la moitié de ses gains. Ce tour rappelle les techniques des coupeurs de bourse dans les nouvelles de Bonaventure des Périers ou les techniques des merciers décrites par Pechon de Ruby. Cela conforte l’image positive d’un bandit facétieux, qui se joue de ses victimes avec humour, sans être une menace, ce qui n’est pas sans rappeler la figure du trickster Renart. En reprenant une version de la vie de Guilleri très influencée par des motifs littéraires connus et qui donne une image favorable du voleur, les éditeurs de la Bibliothèque bleue choisissent un texte qui ne rompra pas avec l’homogénéité de leur corpus éditorial qui intègre souvent des textes de tradition ancienne et connue (comme les romans de chevalerie par exemple ou l’hagiographie) et répondent à un mouvement qui sera développé dans la première partie du XVIIIe siècle : celle des figures de bandits au grand cœur dont Cartouche et Mandrin sont des avatars.
En conclusion, l’héritage de motifs littéraires du XVIe s. est important. Le cas de Guilleri souligne que les thèmes de la littérature de gueuserie représentent un horizon d’attente obligé, adapté en fonction des publics. Parmi le foisonnement des images fictives, seul le bandit lui-même est absent, car il est enfermé dans la représentation d’un mythe comme les marginaux dans les hôpitaux généraux. Il n’est pas seulement marginalisé, pas seulement mis à l’écart, mais il est évacué. Il disparaît dans les fantasmes d’une société à qui il fait trop peur pour qu’elle le regarde.
[Léa a accepté de compléter ce compte-rendu avec les précisions qu’elle a cherché ensuite.]
Anne ouvre le feu des questions : il y a une opposition entre l’image de brute sanguinaire et celle de héros au grand cœur. Mais y a-t-il quand-même des preuves matérielles sur le caractère sanguinaire des troupes de brigands ? Léa répond que le rapport du prévôt décrit surtout les plaintes reçues, que les bandits sont craints surtout parce qu’ils taxaient les chemins des foires de Niort et Fontenay. Ils ne semblaient pas particulièrement sanguinaires, ils volaient surtout. Aucun assassinat n’est répertorié. Ils représentent donc surtout une menace financière pour ce cas précis de bande. Voici ce que dit Le Geay de la Gestière des crimes principaux de Guilleri et de sa troupe dans son compte rendu :
« volleurs quy forçoyent les maisons des gentilshommes et autres, volloyent sur les grands chemins de foyres royalles de Fontenay et Nyort, rançonnoyent les marchans et riches paysans, les taxoyent à des sommes de deniers qu’ils les contraignoyent payer crainte d’estre thuez […] ».
Paule demande alors quelle base sociologique explique la carrière de Guilleri, fils de maçon : qu’est-ce qui le pousse à ce choix ? Qui sont ceux qui le suivent ? Léa répond que, dans le cas de Guilleri, il commence à voler quand il n’a plus sa solde. Il recrute parmi ses anciens camarades. Paule demande si le fait qu’il y a eu beaucoup de mercenaires, puis qu’une réduction de leur nombre en raison de la baisse du besoin a créé ces troupes de brigands. Léa répond qu’en effet, il s’agit de soldats qui ne veulent pas laisser les armes. Paule dit qu’ils répondent ainsi à la fois à une sorte de penchant et à une nécessité. Léa approuve : la nécessité pousse ces anciens soldats vers la réponse la plus facile. Paule demande alors quelle sont les affaires des brigands ? Pillent-ils un coffre de l’État, prennent-ils leurs vivres sur les populations locales, ont-ils une activité diversifiée ? Léa répond que leur spécialité était de se poster le long des grandes routes et de racketter les passants. Paule trace un parallèle avec une pièce qui est peut-être un dernier rejeton de ce motif en Angleterre en 1642 : dans la pièce, des bourgeois vont vivre en vagabonds parce qu’ils ne supportent plus les contraintes. Cependant, les historiens disent que cette histoire est née du changement de la politique agricole sous Elisabeth : les spéculations sur la terre, la création de grands terrains, l’élevage remplace agriculture (les ovins remplacent la petite culture parcellaire) poussent les gens à devenir vagabonds, parce qu’ils n’ont pas le choix, ils sont jetés sur les routes. Dès lors, est-ce qu’il y a d’autres formes du motif dont parlait Léa dans la littérature ? Particulièrement, y a-t-il des pièces de théâtre et des ballades ? Quelles sont les places respectives de la prose et du vers ? Léa répond que, pour Guilleri, il y a eu des pièces de théâtre au XIXe s., des comédies sur l’image du bandit social. Pour le XVIIe et le XVIIIe s., on trouve surtout des ouvrages en prose pour Guilleri. En revanche, pour Mandrin et Cartouche, on trouve des textes très variés génériquement (théâtre, épopées en vers parodiques, chansons…). Guilleri est moins célèbre, or la variété des genres est proportionnelle à la célébrité du personnage.
Fanny demande si les formes sont moins diversifiées parce que le motif est ancien et qu’il y a une dimension didactique forte. Léa répond qu’il y a également une dimension didactique pour Cartouche et Mandrin. De plus, la littérature de gueuserie est souvent didactique mais aussi comique et facétieuse. Mais on a l’impression qu’au XVIe comme XVIIIe s. d’un côté on a le voleur cruel sanguinaire de l’autre le bandit grand cœur.
Fanny demande s’il arrive qu’on trouve les deux images dans les mêmes textes. Léa répond que selon le critique Lincoln Faller, il y a trois images traditionnelles du bandit : la brute, le héros et le bouffon. Ces trois images sont très souvent reprises parfois dans un même texte.
Fanny revient sur la figure du trickster par excellence, Renart. Adelinesurenchérit avec Rutebeuf, les Goliards… Cependant, Fanny souligne que Rutebeuf met plutôt en scène l’ivrogne. Paule évoque pour sa part La Célestine.
Paule pose alors la question du format et des pamphlets. Léa dit que les textes sont appelés « pamphlets » en Angleterre. Paule demande s’il s’agit d’in-octavo ou d’in-quarto, ce à quoi Léa répond répond d’après Jean-Pierre Seguin, avant l’apparition de la presse périodique en 1631, les occasionnels faisaient dix centimètres sur seize centimètres et comptaient de six à seize pages. Après 1631, les occasionnels s’aligneraient sur le format in-4° des gazettes et compteraient entre deux et quatre pages. Nicolas souligne que le format des occasionnels est très codifié, compté en nombre de pliures de la feuille. Paule est intéressée par la question parce que les textes sur l’exécution de Ravaillac sont des in-octavos de 3 ou 4 pages. Y a-t-il un rapport générique et matériel entre les textes sur les bandits et les relations d’exécutions de criminels, d’arrivées d’ambassadeurs, d’entrées… ou y a-t-il des textes distincts pour les bandits ? Léa dit que ces productions ne sont pas distinctes, que dans tous les cas, ce sont des canards. Paule se demande malgré tout quelles distinctions on peut faire, étant donné que tous les textes occasionnels ne sont pas des canards. Léa répond que selon Jean-Pierre Seguin, les textes d’occasion qui ne sont pas des canards sont plutôt des textes portant sur des événements d’histoire. La différence serait donc thématique. Cela pose problème car certains disent que les canards diffèrent aussi en termes de format, qu’ils prennent souvent la forme d’un placard, d’une affiche, tandis que d’autres disent que le canard est rare et peut avoir le même format que les autres occasionnels. Nicolas souligne que le format et le mode de circulation viennent en premier pour opérer des distinctions. Paule demande où se place la question des publics par rapport à ces considérations sur les formats. Léa dit que, pour la Bibliothèque bleue, la question est plus celle d’un mode d’édition que celle d’un public en particulier. L’ouvrage peut être lu par tous. Paule revient sur la question du papier, de qualité grossière, imprimé avec encre qui vieillit mal : c’est un signe de basse qualité. Nicolas acquiesce, cela implique que c’est une production et un achat pas chers. Paule demande s’il n’y aurait pas un versant strict et un versant cher, un passage de la littérature populaire à la littérature plus reconnue. Léa cite un article de Roger Chartier dans l’Histoire de l’édition française sur le statut éditorial et les césures culturelles. En choisissant de donner aux textes ayant le plus de succès une forme qui permette d’imprimer à bas coût une grande quantité d’exemplaires, les éditeurs créent une division entre des textes soignés et des imprimés éphémères : « En filigrane, se dessine donc une opposition, qui sera durable, entre deux corpus de textes, ceux qui nourrissent les pensées des plus riches ou des plus instruits, ceux destinés à alimenter les curiosités du peuple. Même si au XVIIe siècle ces deux ensembles n’ont pas deux publics radicalement différents, puisque, on l’a dit, nombreuses sont les lectures partagées, il n’en reste pas moins qu’ils définissent deux matériaux que les imprimeurs éditent en visant des clientèles, des circulations et des usages qui ne sont point les mêmes. Et c’est dans l’aspect matériel du livre que s’inscrivent ces intentions contrastées : objet noble, soigné, relié, préservé d’un côté, objet éphémère de l’autre. Par sa forme et par son texte, le livre devient signe de distinction et porteur d’une identité culturelle ». La sélection par les éditeurs des livres édités à grande échelle va petit à petit classer des ouvrages qui n’étaient a priori pas préférés par les couches sociales populaires dans la catégorie des ouvrages moins luxueux et donc délaissés par les élites.
Nicolas aimerait revenir sur la figure intermédiaire du criminel entre brute et justicier, à savoir le criminel facétieux. Il donne deux références à ce sujet : les Propos rustiques (1547) de Noël du Fail, qui mettent en scène une figure de gueux et qui seront repris dans les Ruses et cautelles du capitaine Ragot ; Les Serées, du poitevin Guillaume Boucher (publié en association avec les Marnef), qui comporte plusieurs chapitres sur les gueux (y compris ceux torturés par la justice), qui sont des figures intermédiaires, ambiguës, facétieuses. Il y a une longue tradition des bons mots sur la sellette ou sur l’échafaud, qui sont des moments d’ambiguïté par excellence : ce sont à la fois des sommets de stoïcisme et de maîtrise de soi et des actes complètement symboliques. Il mentionne une journée d’étude organisée par Jean-Claude Arnould en février 2010, dont les actes sont en ligne sur le site de l’Université de Rouen, sur “Juges et Criminels dans la narration brève du XVIe siècle”. Adeline apporte de l’eau au moulin bibliographique en citant L’homme de la Renaissance (Eugenio Garin dir.), et plus spécialement le chapitre sur le soldat, au moment où il cesse d’être soldat (l’ouvrage se réfère surtout au domaine italien)
Ivana demande enfin si on peut trouver des traces du miles gloriosus, comme topos ? Léa répond que non, pas vraiment pour ce cas là. Mais ce personnage influence peut-être d’autres représentations de bandits étant donné que ceux-ci apparaissent souvent comme des personnages facétieux et comiques.
Claire demande s’il s’agit du même Guillery que dans la célèbre comptine. Jean Lavallée place la chanson de Guillery (Il était un p’tit homme/Qui s’app’lait Guillery/Carabi!) parmi son corpus des textes consacrés au voleur sans rappeler l’origine de la chanson ni les liens que la chanson entretient avec la figure historique. Ce lien ne semble pas évident, puisque la comptine ne fait ni mention de vol ni de crime.
Fanny Oudin : Figures de l’ermite : “Le cas d’Ogrin, dans le Tristan de Béroul”

Ms. B.N.F. français 310, fol. 55v, Posthumien de Nola et l’ermite velu (source : mandragore)
D’ici peu, vous saurez tout sur les ermites velus. En attendant le verbe, voici l’image.
Compte-rendu écrit par Anne Debrosse et Fanny Oudin