CR Chorea : Guerre – séance du 12 janvier 2013
Sont présents Eloïse Zulicek, Geoffrey Lopez, Henri Simonneau, Benoît Autiquet, Pauline Lambert, Aline Strebler, Goulven Oiry, Mathieu Ferrand, Aurélia Tamburini, Bastien Morel, Camille Messager, Lionel Alexis, Nicolas Meunier, Adeline Lionetto-Hesters, Anne Debrosse, Xavier Malassagne, Nicolas Kiès.
Le séminaire s’ouvre par un tour de table où chacun des participants se présente.
Henri Simonneau, « La mise en scène de la guerre (XIVe-XVIe siècle) »
Henri Simonneau nous propose une grande introduction au sujet, en rappelant les mouvements historiographiques récents sur le thème de la guerre aux XVe et XVIe siècle. Il entend poser quelques jalons essentiels à notre sujet et montrer les continuités qui existent entre la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne. Avec un « regard d’historien », il pose enfin la question de la « mise en scène » de la guerre, problématique qui ne saurait laisser indifférents les littéraires.
Henri Simonneau est agrégé d’Histoire et docteur en histoire médiévale. Membre de l’IRHIS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion), il a soutenu en 2010 une thèse sur les hérauts d’armes dans les Pays-Bas bourguignons (1467-1519) à l’Université de Lille 3, sous la direction de Bertrand Schnerb.
I. Approche historiographique
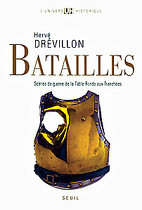 Hervé Drévillon le rappelait dans l’introduction de son ouvrage intitulé Bataille. Scènes de guerre de la Table Ronde aux tranchées, la bataille « est le paradigme d’une écriture de l’histoire scandée par le surgissement d’hommes et de faits exceptionnels » (1). Henri Simonneau rappelle comment l’histoire de France (celle des manuels scolaires) s’est longtemps construite par le prisme des récits de grandes victoires et de défaites, devenues les couches sédimentaires d’un récit national et même de la « nation France ». Bien que cette approche ait été largement battue en brèche par les historiens depuis plusieurs décennies, la guerre et la bataille sont restées parmi les préoccupations majeures des recherches en littérature et en sciences humaines, en tant que phénomènes constitutifs de la culture des peuples et des nations (le programme actuel d’Agrégation d’histoire comprenant le thème « guerre et société » ne saurait mieux témoigner de l’actualité du sujet). Pourtant, l’angle général des études a changé. C’est ce renouvellement dont Henri Simonneau nous résume ici les grandes lignes.
Hervé Drévillon le rappelait dans l’introduction de son ouvrage intitulé Bataille. Scènes de guerre de la Table Ronde aux tranchées, la bataille « est le paradigme d’une écriture de l’histoire scandée par le surgissement d’hommes et de faits exceptionnels » (1). Henri Simonneau rappelle comment l’histoire de France (celle des manuels scolaires) s’est longtemps construite par le prisme des récits de grandes victoires et de défaites, devenues les couches sédimentaires d’un récit national et même de la « nation France ». Bien que cette approche ait été largement battue en brèche par les historiens depuis plusieurs décennies, la guerre et la bataille sont restées parmi les préoccupations majeures des recherches en littérature et en sciences humaines, en tant que phénomènes constitutifs de la culture des peuples et des nations (le programme actuel d’Agrégation d’histoire comprenant le thème « guerre et société » ne saurait mieux témoigner de l’actualité du sujet). Pourtant, l’angle général des études a changé. C’est ce renouvellement dont Henri Simonneau nous résume ici les grandes lignes.
Des médiévistes à la pointe ?
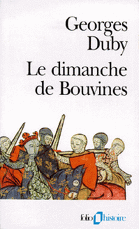 Henri Simonneau rappelle combien les travaux médiévistes ont toujours été sensibles aux phénomènes guerriers (charpentes de l’organisation sociale). Georges Duby (Le Dimanche de Bouvines) est sans doute un des précurseurs d’un nouveau courant historiographique au début des années 1970. Son approche associe analyse au jour le jour des évènements du XIIIe siècle et mise en évidence de structures mentales, sociales et économiques. Deux autres noms ont significativement renouvelé le genre : Philippe Contamine (fin de l’époque médiévale) pour son point de vue sociologique et anthropologique et Hervé Drévillon (époque moderne) en remettant la bataille au cœur des préoccupations modernistes. Comme référence synthétique, Henri Simonneau nous renvoit au volume de Jean Chagniot (directeur d’étude à l’EPHE) : Guerre et société à l’époque moderne, coll. Nouvelle Clio, PUF, 2001.
Henri Simonneau rappelle combien les travaux médiévistes ont toujours été sensibles aux phénomènes guerriers (charpentes de l’organisation sociale). Georges Duby (Le Dimanche de Bouvines) est sans doute un des précurseurs d’un nouveau courant historiographique au début des années 1970. Son approche associe analyse au jour le jour des évènements du XIIIe siècle et mise en évidence de structures mentales, sociales et économiques. Deux autres noms ont significativement renouvelé le genre : Philippe Contamine (fin de l’époque médiévale) pour son point de vue sociologique et anthropologique et Hervé Drévillon (époque moderne) en remettant la bataille au cœur des préoccupations modernistes. Comme référence synthétique, Henri Simonneau nous renvoit au volume de Jean Chagniot (directeur d’étude à l’EPHE) : Guerre et société à l’époque moderne, coll. Nouvelle Clio, PUF, 2001.
Y a-t-il encore à dire sur la guerre ? La question soulevée n’est pas que rhétorique. Pourtant les travaux Fleurissent dans l’interdisciplinarité.
John Keegan (professeur à Princeton) a été un des initiateurs d’une nouvelle approche de la guerre à travers les sciences appliquées. Victor Davis Hanson (au sujet de la guerre antique) fonde son étude sur la réalité des combats : armes et stratégies utilisées. En France, Renaud Beffeyte (L’art de la guerre au Moyen Âge) se concentre sur les techniques et les machines de guerre médiévale, perfectionnées à l’époque moderne. Henri Simmoneau ne manque pas de rappeler que, dans le cadre de ce séminaire, Jean-Louis Bouglé nous proposera une intervention à ce sujet. Sur cette ligne de diversité d’approches, une thèse à l’Université de Lille III avait été consacrée aux blessures de guerres à la fin de l’époque médiévale. Là encore, Aline Strebler nous offrira une approche médicale de la question dans le cadre de ce séminaire. Par ailleurs, parmi les travaux médiévistes fleurissants, Henri Simonneau signale le dictionnaire consacré à Jeanne d’Arc en 2012 (dir. Philippe Contamine, Xavier Hélary, Olivier Pons) qui fait suite à la biographie de Françoise Autrand. Le séminaire choréa s’intéressera également à la question en mars, avec l’intervention d’Elisabeth Carminati (les représentations de Jeanne d’Arc à la Renaissance).
Une tendance thématique des travaux historiographiques depuis une dizaine d’années : les rituels de guerre à l’époque médiévale.
Nicolas Offenstadt a rédigé une thèse sur les discours et les rituels de paix à la fin du Moyen Âge. Laurent Hablot (Université de Poitiers), suite à une thèse sur la devise dans la société aristocratique médiévale, s’intéresse de près aux cris de guerre et signes d’identité sur le champ de bataille.Henri Simonneau a lui-même travaillé sur le rôle du héraut d’armes dans les rituels de guerre et sur le champ de bataille. Sur la question de l’environnement sonore de la guerre, l’article de Philippe Contamine offre une précieuse référence en ce qui concerne la place de la musique militaire dans le fonctionnement des armées (1300-1550).
L’étude des armements a cédé la place à la question des relations d’amitiés qui unissent les hommes de guerre, ainsi qu’aux problématiques de la violence et de la délinquance.
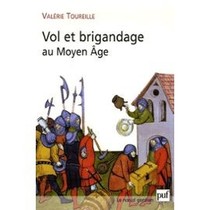 Les références sont une nouvelle fois nombreuses. On pourra consulter Vol et brigandage au Moyen Âge de Valérie Toureille qui dénote bien le climat d’insécurité et les mécanismes qui assurent la bascule entre guerre et les phénomènes de délinquance, vol, meurtre… (Grandes compagnies, Ecorcheurs du XVe siècle). Les travaux les plus récents se sont intéressés au système de la rançon, de l’appatis et du butin de guerre ainsi qu’aux sommes considérables circulant autour des champs de bataille au Moyen Âge.
Les références sont une nouvelle fois nombreuses. On pourra consulter Vol et brigandage au Moyen Âge de Valérie Toureille qui dénote bien le climat d’insécurité et les mécanismes qui assurent la bascule entre guerre et les phénomènes de délinquance, vol, meurtre… (Grandes compagnies, Ecorcheurs du XVe siècle). Les travaux les plus récents se sont intéressés au système de la rançon, de l’appatis et du butin de guerre ainsi qu’aux sommes considérables circulant autour des champs de bataille au Moyen Âge.
Dans le sillage de la pensée de Philippe Contamine, Henri Simonneau nous rappelle que la guerre est avant tout un phénomène culturel. Jamais « violence pure et illimitée », elle est entourée de tout un appareillage conceptuel, ressortissant à la coutume, au droit, à la morale et à la religion (2). C’est pourquoi il convient de revisiter nos idées reçues : si la guerre fait bien partie du quotidien des hommes du XVe siècle, il faut néanmoins s’ôter de l’esprit l’image de campagnes françaises constamment ravagées par les guerres intestines (d’après un imaginaire exalté par les auteurs du Moyen Âge et de la Renaissance). La guerre fait donc partie de la culture des sociétés européennes, elle est l’activité fondamentale de son élite, la noblesse. D’autre part, dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, le discours des princes tourne toujours autour de la guerre (contre les Anglais, les princes révoltés, la Croisade, les guerres d’Italie, les guerres de religion). La culture de la guerre innverve la culture des princes et de la noblesse, qui se veut l’héritière de la chevalerie de l’époque où les Croisades se gagnaient encore. L’émergence d’une noblesse de robe n’apportera aucun infléchissement à ce phénomène.
Une des traits de continuité les plus visibles entre Moyen Âge et Renaissance : l’attrait pour les biographies chevaleresques
Guillaume le Maréchal, Boucicaut et Bertrand du Guesclin, Jacques de Lalaing, Jean de Saintré, Tiran le Blanc, le chevalier Bayard…, nombreuses sont ces biographies qui connaissent multiples réimpressions à l’époque moderne, jusqu’à garnir les étagères de la bibliothèque de Don Quichotte. En apostrophant Geoffrey Lopez et Goulven Oiry au sujet de leurs communications à venir en cette séance, Henri Simonneau pointe l’homme de guerre comme un des personnage des plus inspirant pour la littérature du XVIe siècle. C’est qu’il s’agit d’une actualité brûlante, dont témoigne la soutenance de thèse de Francesco Montorsi (le 1er décembre 2012) : Lectures croisées. Étude sur les traductions de récits chevaleresques entre Italie et France autour de 1500. Au sujet du Roland Furieux de l’Arioste (dont la traduction française est concernée par ce travail), l’équipe de Cornucopia vous renvoie également au compte rendu de L’Arioste et les arts, disponible sur le site.
(1) Hervé DREVILLON, Batailles. Scènes de guerre de la Table Ronde aux Tranchées, Paris, Seuil, 2007, p.10-11.
(2) Philippe CONTAMINE, « L’idée de guerre à la fin du Moyen Âge : aspects juridiques et éthiques », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 123e année, n°1, 1979, p.70.
(1) Hervé DREVILLON,Batailles. Scènes de guerre de la Table Ronde aux Tranchées, Paris, Seuil, 2007, p.10-11.
(2) Philippe CONTAMINE, « L’idée de guerre à la fin du Moyen Âge : aspects juridiques et éthiques »,Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 123e année, n.1, 1979, p.70.
II. L’héritage médiéval : quelques idées à oublier

Albrecht ALTDORFER, "la bataille d'Alexandre", 1529, Alte Pinakothek, Munich (source : WGA)
Henri Simonneau se propose de « tordre le cou » à quelques idées courantes concernant l’héritage médiéval de la guerre et les continuités entre l’époque médiévale et l’époque moderne, préconçus qui survivent parfois même dans les rangs de l’université. On oppose souvent la guerre médiévale (« féodale ») à la guerre moderne (celle des Etats modernes). D’un côté le ban, l’arrière-ban et les chevaliers, de l’autre l’armée moderne, pour ne pas dire l’armée de métier. Henri Simonneau nous invite à nuancer pour grande part cette image.
Premier écueil : guerre féodale vs guerre moderne
Les premières compagnies d’ordonnance au service du roi de France datent de 1445. Le service des armées permanentes est ensuite largement développé par Louis XI. L’utilisation des troupes mercenaires est également un phénomène ancien, et des armées volumineuses peuvent être mobilisées au XVe siècle grâce au service de type féodal. Depuis le milieu du XIVe siècle, les princes ont des unités d’élite qui forment la garde rapprochée du seigneur (600 à 700 cavaliers et leurs pages présents à la cours pour Philippe Marie Visconti au début du XVe). Charles le Téméraire, à la bataille de Gavre (1453) peut ainsi mobiliser 60 000 hommes, plus qu’à Marignan ou à Pavie. Henri Simonneau nous expose une évolution majeure dans la conception de la guerre : l’Etat cherche désormais à monopoliser la violence légitime. Ce mouvement se dessine progressivement, dès le XIIIe siècle. Dans ce contexte, la guerre « privée », dont nous avions parlé en 2012 dans le séminaire consacré au duel, continue à être une plaie de la monarchie jusqu’à une époque très tardive.
Deuxième écueil : les armes à feu et l’artillerie
C’est bien à tort que l’on situe les armes à feu et l’artillerie au cœur d’une « révolution militaire ». Henri Simonneau revient sur les origines de la poudre (usage attesté en chine en 1044, son invention se transmet en occident par l’intermédiaire des Mongols et du monde musulman, elle est utilisée en Europe dès le fin du XIIIe siècle, bien que mal perçue et associée à la magie noire). Progressivement, l’artillerie se fait une place dans l’armée. Les bombardes restent uniquement des instruments de siège (difficiles à déplacer), destinés principalement à impressionner l’adversaire par leur bruit et leur grandeur colossale (le duc de Brabant fait forger une bombarde de 35 tonnes). Par ailleurs, les armes à feu comme l’arquebuse ou l’escopette ne sont pas davantage décisives (elles le deviendront au XIXe en vertu de progrès techniques tardifs qui les auront rendues maniables, utilisables et précises).

Musée de l'armée, Paris (source : Wikipédia)
La hantise de la décadence de la chevalerie. La noblesse d’arme.
Le Moyen Âge multiplie les discours sur le déclin de la chevalerie. Henri Simonneau s’appuie sur l’exemple des hérauts d’armes, sa spécialité, qui ont rédigé ou recopié nombre de traités sur la perte des valeurs aux XIV et XVe siècles. Au XIIIe siècle, les ménestrels regrettaient déjà le « temps passé » où les chevaliers combattaient pour le roi, la veuve et l’orphelin. Peut-être le souvenir des Croisades est-il encore douloureux ? La Croisade resterait ainsi la seule forme de guerre irréprochable, elle fut un objectif constant, mais souvent lointain, des souverains médiévaux et modernes.
Le XVIe siècle fait place à une véritable réflexion sur la place de la cavalerie dans l’armée, et donc dans la noblesse et dans la société (Machiavel, La Noue ou Tavannes). Les théoriciens ne proposent pas un retour aux sources de la chevalerie (comme le faisait le Moyen Âge) mais bien une réforme du service mobilière. Machiavel développe une idée de réforme politique sur le rôle de la noblesse. Henri Simonneau revient sur les causes de ces débats. Le recours de plus en plus massif aux troupes d’infanterie, la transformation des usages de la cavalerie lourde dans les batailles et la diffusion de la cavalerie légère posent la question du monopole militaire de la noblesse. Par ailleurs, le recul de la proportion de nobles au sein des armées, les nombreux appels aux mercenaires étrangers et le remplacement progressif du service de ban par des taxes font peser le doute sur les compétences d’un ordre dont l’existence continue d’être justifiée par ses fonctions guerrières. Ainsi, dans les derniers conflits des guerres de religion, la noblesse ne représente plus que 20 à 30% des effectifs). Henri Simonneau attire notre attention sur un dernier point, plus fondamental, qui fait vaciller les structures traditionnelles de la hiérarchie militaire et aristocratique : l’efficacité de l’infanterie fait naître de nouvelles revendications sur l’honneur guerrier dans les milieux populaires. Les cahiers de doléances de 1576 proposent ainsi de donner la noblesse aux roturiers qui feraient carrière dans les armées après trois ans de service comme soldat, deux ans comme chevau-léger et quinze comme gendarme. La noblesse d’armes ferait ici fi de la naissance.
III. La mise en scène de la guerre
La guerre est un rituel (violent) dont les codes sont hérités du Moyen Âge.Henri Simonneau met en valeur quelques points qui semblent éclairer une « culture de la guerre » : la déclaration de guerre, la lance, l’adoubement, la mort du chevalier sur le champ de bataille. Ces remarques sont tirées de ses propres recherches mais s’appuient également sur la thèse de Benjamen Druelle : De papier, de fer et de sang. Chevaliers et chevalerie à l’épreuve du XVIe siècle (1460-1620), dir. Hervé Drévillon.
Le cartel
La déclaration de guerre au XVIe siècle se calque sur le modèle rituel très codifié de la déclaration en duel par voie de hérauts (le héraut apporte en main propre une provocation en duel, le destinataire répond que cette déclaration le « comble de joie »). C’est sur ce mode opératoire que François Ier ou Charles Quint déclarent la guerre, le procédé perdurera jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Sur ces questions, l’équipe de Cornucopia vous renvoie à l’intervention d’Henri Simonneau dans le cadre du séminaire sur les duels en 2012.
La Lance
La lance, signe identitaire fort et voie d’élévation sociale, conserve son importance tout au long du XVIe siècle. Elle apporte à son détenteur l’élévation sociale à laquelle aspire tout chevalier. La charge en haie est le mode traditionnel de charge de la cavalerie lourde. Elle nécessite un dressage particulier et est au cœur de l’éthique guerrière et de l’unité de la chevalerie. Très impressionnante par la violence de l’impact, c’est une technique discutée (moins maniable que les chevaux légers). Mais les réformateurs du XVIe siècle vont se heurter à la résistance de l’aristocratie, attachée à la charge de cavalerie lourde (la noblesse, corps central de la société, ne peut être une arme secondaire dans la bataille). Ainsi, l’usage et la pratique de la lance apparait, pour les contemporains du XVIe siècle, comme un trait de génie de la noblesse de France. En 1551, Henri II réaffirme le principe du service monté à lance sur le modèle des compagnies d’ordonnance « tant pour le bien et tuition de nostre roualme que pour le contentement d’iceux nobles, qui de leur nature y sont le plus dextre ». Enfin, la monarchie et la noblesse fait un usage métaphorique de la lance, l’arme devient en effet un reflet de leur grandeur, il est un instrument nécessaire de leur représentation : Charles VIII rentre à Naples en 1494 lance sur la cuisse, comme s’il était prêt à charger ; Titien représente Charles Quint sur son cheval armé d’une lance ; voir encore Henri IV à la bataille d’Ivry en 1590. Henri Simonneau explique ce phénomène par un effet de confluence : le maintien de cet idéal chevaleresque « par la lance » doit tempérer l’image d’une armée de plus en plus roturière, où le chevalier disparait.
L’adoubement
A l’époque moderne, l’adoubement reste un rite initiatique important, sur le modèle des cérémonies monarchiques et princières. Sa dimension politique prime : il s’agit d’investir publiquement les responsabilités du chevalier et de légitimer l’usage des armes pour le maintien de l’ordre. L’adoubement sacralise aussi la guerre et les guerriers. Le déclin considérable du nombre de chevalier entre le XIIIe siècle et la fin du Moyen Âge observé par Philippe Contamine, doit être attribué au coût de la cérémonie et aux nombreuses responsabilités qui incombent au chevalier. De plus, à partir du XIVe siècle apparaît le nouveau phénomène des ordres de chevalerie, sorte de « superchevalerie », selon l’expression de Jacques Heers.
Au XVIe siècle, l’adoubement est une pratique en déclin, rarement visible hors des fictions littéraires. Néanmoins, Henri Simonneau nous fait remarquer que c’est sur le champ de bataille, à l’issue du combat, que sa forme reste la plus fréquente (au Moyen Âge il prenait effet avant le combat). Ainsi, dans le récit de Symphorien Champier, François 1er est fait chevalier des mains du chevalier Bayard ou encore, Blaise de Montluc décrit son adoubement à la suite de la bataille de Cérisoles (1544). Ici, la colée médiévale a cédé la place à la simple accolade pour transmettre la dignité chevaleresque : « Ainsi arrivasmes au camp, où estoit monsieur d’Anguyen, je courus à luy & il se baissa, et me fist cest honneur de m’embrasser, et me fist sur l’heure chevalier, dont je me sentiray tout ma vie honnoré, pour l’avoir este en ce hour de bataille, et de la main d’un tel prince ».

LEONARDO da Vinci, Le chevalier (étude), 1504, Gallerie dell'Accademia, Venise (Source : WGA)
La mise en scène de la mort du chevalier
La mort sur le champ de bataille est l’horizon bienheureux du chevalier. Henri Simonneau note là une idée de sacrifice à ne pas sous-estimer et qui s’illustre dans de nombreux écrits, nous en avons retenu quelques extraits : En 1584, Louis Ernaud (Discours de la noblesse), fait du sacrifice un horizon d’attente pour une noblesse désireuse de « rachete[r] par sa mort, la vie & le salut de plusieurs ». Dans La vie d’Ogier Danois (publiée en 1613), la vie terrestre de la noblesse est présentée comme un purgatoire et ses souffrances à la guerres sont dites nécessaire à la rédemption de ses semblables. Un vrai chevalier doit mourir au combat, pour le service du prince, et rien n’est pire que la mort accidentelle, passive et anonyme. Aussi Brantôme blâme-t-il la mort de Charles VIII, qui « ne mourut point en un lieu où son généreux cœur le portoit, mais au chasteau d’Amboise, au plus vil lieu qu’il fust, dans une gallerie » ou Philibert de Clermont, mort d’une maladie « Ce fust un grand’heur pour lui ce disoient ses compagnons) d’avoir este mort en ce combat [à la Bastide] ; et la fortune ne lui debvoit avoir esté si contraire, […] de lui avoir prolondé sa vie de huict jours pour mourir dans son lict, se mourir en celui d’honneur au lieu de sa profession et de son désir ». A l’inverse, François Daillon, seigneur de la Cropte, eut l’honneur de mourir au champ d’honneur après avoir guéri d’une maladie « mais le Dieu des armes ne voulut que la mort hydeuse et affreuse d’une maladie et d’un lict en triumphast, mort certes par trop indigne de sa valeur ; mais, […] l’osta du lict et le prict par la main, et le mena mourir plus glorieusement à la bataille de Ravenne ». La crainte de l’infâmie dans la mort explique également l’erreur de Monsieur de Tais à la bataille de Cérisoles en 1544. Poussé par les demandes de ses capitaines, il fait charger sa troupe de piquiers au plus profond des lignes italiennes alors que celles du Saint Empire se préparaient à le prendre par le flanc. Ceux-ci l’avaient supplié de les mener au combat, préférant « mieux mourir main à main, que d’estre tuez à coup d’artillerie ». En échange, cette mort héroïque leur apporte en récompense l’éternité littéraire.
La mort au combat implique une cérémonie souvent mise en scène par le héraut, courtier de l’honneur chevaleresque. Pourtant, le rite peut devenir obsolète, comme le suggère l’annecdote rapportée par Jean d’Auton : le 28 avril 1503, dans la bataille de Cérigole (qui oppose français et espagnols), Louis d’Armagnac (Duc de Nemours) trouve la mort. Le roi d’armes de Champagne, le découvrant nu, retire sa cotte d’armes pour en revêtir de duc. Les Espagnols, témoins de la scène, « voyant celui être désarmé de son lis, le tuèrent disant que plus de franchise n’avoit ».
En quelques mots de conclusion, Henri Simonneau nous montre combien la guerre au XVIe siècle continue d’être très largement influencée par une conception médiévale héritée des rituels de chevalerie et dont les motifs ont pu inspirer les auteurs de biographie chevaleresque ou se refléter dans le modèle « écorné » de Cervantes…

Lucas the Elder CRANACH, "Tournois avec lances", 1509, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt (source : WGA)
Discussion
Pauline s’interroge sur la périodicité d’un phénomène. Henri Simonneau a expliqué que « la guerre privée » (les duels) est restée une « plaie de la monarchie » jusqu’à une période très tardive. Quelle est son étendue ? Henri, en réponse, explique que les duels sont interdits par la monarchie dès le milieu du XVIe. Henri renvoie aux observations du séminaire choréa consacrés au duel auquel il avait lui-même participé puis complète son explication : les duels restent présents au XVIIe siècle (faut-il seulement citer les Trois Mousquetaires ?) et il en existe même encore au XIXe siècle. On peut établir qu’à partir du XVIIIe siècle le duel n’apparaît plus comme un moyen de résoudre les conflits. Geoffrey note que les duels plus tardifs, aux XIX et XXe siècles, mettent généralement en opposition député et député ou député et journaliste (on trouve même sur internet certaines vidéos de duels du début du XXe siècle en « marcel et pantalon » dans la maison de campagne du représentant du parlement). Henri remarque que Louis XIV avait trouvé le moyen de faire en sorte que sa noblesse cesse de s’affronter. Il faut considérer le phénomène comme un véritable problème de société : l’élite manque de mourir à chaque combat (Azincourt marque la disparition d’un tiers de la noblesse).
Bastien : Le nombre de chevaliers décroît de manière conséquente tout au long de la fin du Moyen Âge, cela signifie que l’effectif des mercenaires augmente ? Henri : il augmente. En effet, les chevaliers, les nobles, doivent le service du « ban » et de « l’arrière-ban ». Seulement, beaucoup ne veulent pas l’accomplir, notamment la noblesse de robe, qui est alors tenue de payer des soldats. C’est donc des taxes indirectes qui vont servir à payer les mercenaires –présents depuis très longtemps-. Les corps de l’armée sont donc financés par des nobles qui ne remplissent pas leur service de guerre. On tendance à associer le mercenaire à l’image du condottiere… Attention, la « condotta » est un système qui se comprend uniquement dans le contexte italien. Mais les ducs de bourgogne ont bien des mercenaires, des troupes écossaises ect. Les capitaines de guerres se mettent au service d’un tel, mais dans le cas où ils ne seraient plus rétribués, ils changent de camp (c’est toute la difficulté). Quand ce phénomène ancien sera généralisé, les troupes ne seront plus appelées « mercenaires » (à partir du moment où les taxes permettront d’avoir constamment des troupes soldées à disposition). La présence de ces troupes étrangère est longtemps attestée. Geoffrey dit avoir lu dans des chroniques qu’à la prise de la bastille on a trouvé de vieux espadons de la garde écossaise.
Matthieu s’interroge sur le lien établi entre la période médiévale et la Renaissance, est-ce que les guerres de religions ont introduit une rupture ?Pour Henri, c’est comme la guerre civile qui a opposé armagnacs et bourguignons. La guerre civile, début du XVe siècle, est une catastrophe qui pose de véritables problèmes politiques puisqu’on ne parvient pas à contrôler les dérapages (même ceux de la noblesse qui défend ses possessions). A ce sujet, on pointe souvent du doigt les nobles qui ont « trahi », sont passés de « l’autre côté » selon l’emplacement de leurs terres. La guerre civile affecte significativement les traditions et ce qui faisait les cadres de l’armée. Les guerres de religion amènent beaucoup de remises en cause (c’est une période très troublée pour la noblesse et les structures traditionnelles des élites). Les critiques se multiplient dans ces moments où l’autorité royale est effleurée. Matthieu se souvient d’une lecture des travaux de Denis Crouzet autour de la question de continuité Moyen Âge-Renaissance : il y aurait eu une reprogrammation conflictuelle pour la noblesse en perte de repère. Dans quelle mesure cela-t-il été sapé par ces guerres ? Henri, au-delà des lignes de continuité qu’il a défendu, reconnait qu’il s’agit d’un phénomène complexe, rarement nettement défini. Le passage XVe-XVIe n’est pas une rupture. Il s’agit d’une recomposition de la noblesse en quelques sortes (elle sera toujours là aux XVIIe-XVIIIe). Malgré ces guerres, c’est toujours la noblesse qui a le monopole de la guerre (les officiers sont tous des nobles).
Matthieu s’interroge sur le lien établit entre la période médiévale et la Renaissance, est-ce que les guerres de religions ont introduit une rupture ? Pour Henri, c’est comme la guerre civile qui a opposé armagnacs et bourguignons. La guerre civile, début du XVe siècle, est une catastrophe qui pose de véritables problèmes politiques puisqu’on ne parvient pas à contrôler les dérapages (même ceux de la noblesse qui défend ses possessions). A ce sujet, on pointe souvent du doigt les nobles qui ont « trahi », sont passés de « l’autre côté » selon l’emplacement de leurs terres. La guerre civile affecte significativement les traditions et ce qui faisait les cadres de l’armée. Les guerres de religion amènent beaucoup de remises en cause (c’est une période très troublée pour la noblesse et les structures traditionnelles des élites). Les critiques se multiplient dans ces moments où l’autorité royale est effleurée. Matthieu se souvient d’une lecture des travaux de Denis Crouzet autour de la question de continuité Moyen Âge-Renaissance : il y aurait eu une reprogrammation conflictuelle pour la noblesse en perte de repère. Dans quelle mesure cela-t-il été sapé par ces guerres ?Henri, au-delà des lignes de continuité qu’il a défendu, reconnait qu’il s’agit d’un phénomène complexe, rarement nettement défini. Le passage XVe-XVIe n’est pas une rupture. Il s’agit d’une recomposition de la noblesse en quelques sortes (elle sera toujours là aux XVIIe-XVIIIe).
Geoffrey Lopez, « Le capitaine idéal à la lecture de Brantôme »
Geoffrey Lopez étudie en Master II de littérature française à la Sorbonne et travaille à l’édition du Chapitre Des Duels de Brantôme sous la direction d’Olivier Millet. Secrétaire de Cornucopia, il avait déjà participé au séminaire de 2012 consacré au duel.

François SPIERING, "Urgande Handing over the Lance to Amadis ",1590-95, collection privée (source : WGA)
Geoffrey Lopez remercie Henri de lui avoir ouvert le champ des « morts héroïques » dont il va ici évoquer d’autres exemples. Il commence par nous présenter l’œuvre de Brantôme. Il s’agit d’un diptyque dont seul le premier recueil, les Dames, nous est généralement familier (lui-même subdivisé en deux livres : « Illustres » et « Galantes », ainsi nommés par les éditeurs du XVIIe siècle). La majeure partie de son œuvre demeure la plus méconnue, celles des Hommes (composée de plusieurs discours : Vies des grands capitaines étrangers et français, Discours sur les duels, Serments et jurements espagnols, Retraites de Guerre). C’est en s’appuyant sur cette galerie de portraits et d’anecdotes qui brossent le panorama des hommes de guerre du XVIe siècle, que Geoffrey Lopez se propose de dégager le portrait idéalisé du Capitaine : son visage s’esquisse par touches successives, collectionnées d’un homme à l’autre. Cette intervention prend pour référence les travaux d’Etienne Vaucheret, Brantôme, mémorialiste et conteur, Honoré Champion, Paris, 2007 (voir en particulier l’article : « Le Grand Capitaine »).
Écarter la figure du monarque ? Portrait idéal des hommes à son service.
Geoffrey Lopez nous explique pourquoi il ne s’agira pas ici de traiter de différentes figures de monarque, pourtant apparemment les plus à même d’incarner, comme chefs suprêmes de l’armée, le « capitaine idéal ». Brantôme considère que les monarques n’ont pas l’obligation de participer directement aux batailles, mais peuvent, comme il l’écrit pour Philippe II, mener leur guerre « assis en la chaise de leur conseil comme en leurs salles d’armes » (1). Si notre mémorialiste énonce cependant qu’il y a plus de mérite à résoudre des affaires qu’on ne voit pas, Geoffrey Lopez veut ici dresser ici le portrait d’un homme de terrain, ayant part active au conflit (capitaine, colonel, maître des camps…) plutôt que commandant depuis sa tente.
 Geoffrey Lopez note que la protection du monarque peut fournir l’un des rôles essentiels du capitaine idéal. A ce sujet, Brantôme, citant Paul Jove, nous rappelle la manière dont le Marquis del Guast ordonna à Charles Quint de quitter le lieu d’un combat :
Geoffrey Lopez note que la protection du monarque peut fournir l’un des rôles essentiels du capitaine idéal. A ce sujet, Brantôme, citant Paul Jove, nous rappelle la manière dont le Marquis del Guast ordonna à Charles Quint de quitter le lieu d’un combat :
« Sacrée Majesté, puis qu’il vous a pleu m’honorer d’une telle dignité, j’use maintenant de mon droit et vous encharge de vous retirer d’icy, en la bataille du milieu, là où sont les enseignes ; de peur que, par cas fortuit, un coup de canon tombant sur vous, ou quelque arquebusade, l’universelle sauveté de la fortune publique ne tombe en danger irréparable, par le moyen de la perte d’un seul homme. » (2)
Le capitaine idéal, loyal à la monarchie, est en droit d’espérer des charges supérieures en récompense de ses services. Un roi qui ne traiterait pas bien ses capitaines peut ainsi s’attendre à les voir passer à l’ennemi. Geoffrey Lopez cite la figure d’Andrea Doria (3), qui ne manqua pas de passer à l’ennemi quand le roi François 1er lui retira injustement ses charges de général des galères, il passa dans le parti de Charles Quint et chassa les Français de Gênes (la ville érigea une statue en son honneur). Le capitaine doit par ailleurs mériter la charge qu’il obtient. Brantôme, que l’on sait avoir connu cette peine de voir s’élever d’autres moins vaillants que lui, fustige les Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit dont il compare les colliers à ceux qui servent à attacher le bétail : sous le règne d’Henri III, ces derniers sont en effet communément remis aux favoris et non en récompense d’un véritable mérite. Les meilleurs courtisans ne sont pas les meilleurs capitaines, Geoffrey Lopez nous transmet l’expression féroce :
« […] c’est une chose très périlleuse de donner des charges de guerre à ces mignons et favoris de merde qui ne font que gaster et souiller la besongne et ne fayre rien qui vaille »(4).

Vecellio TIZIANO, "Cavalier et cheval", 1537, Ashmolean Museum, Oxford (source : WGA)
Les morts héroïques
Loin des courtisans, c’est à la guerre que le Capitaine doit exercer son talent jusqu’aux dernières limites de sa vie, l’épée à la main. Geoffrey Lopez rappelle combien la mort d’un homme de guerre fonde le portrait que l’on fera de lui. Ainsi, durant le siège de Rome, le Connétable Charles de Bourbon (5) demande que l’on couvre son corps pour que ses soldats ne le voient pas à terre et continuent à se battre. Pourtant, Brantôme écrit que tous les grands du monde devraient pouvoir mourir comme le Compte de Buren (6) : revêtu de ses plus beaux habits, après avoir récompensé ses soldats, avoir dit adieu à ses plus chers amis et enfin après avoir été porté au lit par ceux qu’il aimait. Geoffrey Lopez remarque que sa mort n’est pas ici héroïque au sens guerrier du terme, mais elle place le Compte de Buren au rang des figures les plus nobles de l’Histoire (sénateurs, consuls, princes romains).
Brantôme croît qu’un péché entache à jamais la gloire d’une homme et qu’une mort infamante conclut souvent une vie de péché. La mort subite du Maréchal Matignon (7), particulièrement infamante (en plein repas), s’explique ainsi par l’injure qu’il fit à la Reine Marguerite de Navarre en la chassant d’Agen :
« Aussi Dieu, qui est miséricordieux pour les uns, et justicier pour les autres, a donné possible cette sentence à ce Mareschal, sur ce sujet, de mourir ainsi soudainement, qui est une grande punition de Dieu, puis que tous les jours nous le prions qu’il nous préserve et garde de mort subite » (8).
De la même manière, la cruauté de Cossains lors de la Nuit de la Saint-Barthélémy précipita sa mort (9). Dernière anecdote évoquée par Geoffrey sur ce point, le cas de Philippe Strozzi. Il se rendit coupable d’une des plus grandes cruautés : jeter aux eaux les prostituées dont ses hommes s’étaient acoquinés. Bien qu’il s’en repenti, Brantôme décrit une cruauté bien punie :
« […] tout ainsi qu’ilz avoient aymé et pourchassé la mort de ces pauvres creatures, de mesmes Dieu leur envoya la leur, qui, bien qu’il deffende fort ce vice de paillardise, il abhorre ce vilain genre de mort ; car possible aucunes se fussent converties et eussent servy Dieu, comme il s’en est veu force ; et ledict Strozze la paya aussi despuis. » (11).
Le cas paradoxal de la cruauté nécessaire
D’après l’analyse d’Etienne Vaucheret, Geoffrey Lopez oppose aux figures qui semblent maudites par leur méfait, celle de l’Amiral de Coligny (Monsieur de Chastillon). Bien qu’il fit exécuter nombre de paysans, son âme n’entre pas au nombre des âmes souillées, la raison en est que ses actes n’ont pas été opérés par cruauté de cœur, mais par devoir. Geoffrey remarque cependant que les massacres de paysans décrits par Brantôme n’ont rien de raisonné et valent bien la noyade des garces du Pont de Cé précédemment évoquée (11). Mais l’excuse est proverbiale, nécessité fait loi :
« Tant y a que l’on a tenu mondict Seigneur l’Admiral fort cruel. Mais il falloit qu’il le fust […] il y forçoit son naturel et son humeur […] »
Geoffrey Lopez rapproche à titre d’hypothèse cette « cruauté forcée » de la sagesse militaire dont les principes sont développés dans l’article d’Etienne Vaucheret (les relations humaines à l’intérieur de l’armée, le rapport avec l’adversaire, la conduite de la guerre).

Dominicus CUSTOS (1560-1612), Fernando Francesco d'Avalos (Marquis de Pescara), (Source : Wikipédia)
La sagesse militaire
Pour Brantôme, le capitaine idéal doit savoir conserver prestance et rang de supériorité dans ses relations avec les soldats, posture qui lui permet d’être généreux et de récompenser les bons soldats, sans toutefois être complaisant ou permissif. Brantôme vante la rigueur de Coligny et de ses ordonnances, « les plus belles et pollitiques qui furent jamais faictes en France » (12).
Dans le rapport à l’adversaire, Brantôme prône la noblesse de cœur et la courtoisie. Geoffrey Lopez resitue l’importance du « beau geste » comme axe de la pensée de Brantôme, celui-ci juge méritoire pour un capitaine victorieux de considérer le capitaine vaincu comme son égal : « J’appelle celuy grand capitaine, qui, ayant en teste et à faire avec un autre Grand son pareil, ne s’en estonne point, luy tient visage et luy fait penser à sa conscience ; aussi-bien que l’autre à luy » (13). Dans les guerres fratricides qui déchirent le XVIe siècle, Brantôme voudrait que l’on respecte la dignité et le rang des ennemis vaincus. En voici un contre-modèle ignominieux : la mort du prince de Condé (Louis 1er de Bourbon) lors de la bataille de Jarnac.
Geoffrey Lopez synthétise en ces termes : en somme, le capitaine idéal doit tenir son rang de noblesse et accorder les vertus de l’âme aux devoirs de sa charge. Il doit rester maître de lui-même (ne pas s’effrayer), et attendre de l’adversaire autant de ruse et de hargne qu’il en serait lui-même capable (voir le court éloge de l’Empereur Maximilien 1er qui parvient à déjouer les ruses de Louis XI). Une grande part de son mérite consiste à savoir retirer ses troupes du champ de bataille et sonner la retraite au moment opportun, ainsi que l’écrit Brantôme dans la phrase d’annonce de son Discours sur les belles retraites d’armées de diverses nations :
« Et le Capitaine qui fait une belle retirade devant son ennemy, est bien autant à estimer que celuy qui le combat ;d’autant, [disoient les grands Capitaines et Généraux d’armées], que le moindre Capitaine qui aura du coeur, peut combattre, et non bien se retirer. » (14).
Geoffrey Lopez nous rappelle l’exemple du Marquis de Pescara, cité par Brantôme : ayant échoué au siège de Marseille et menacé par François 1er, il dû organiser une rapide retraite vers Milan, fait louangé par l’auteur (alors même que ce capitaine comptait bien des démonstrations plus « héroïques » à son actif) (15). Selon Geoffrey Lopez, la figure de Bayard, conforme aux vertus chevaleresques et visage récurrent dans l’œuvre de Brantôme, fournirait un modèle privilégié au « capitaine idéal ». Poursuivi par le Marquis de Pescara et le Duc de Bourbon, il ordonne la retraite de ses troupes de Milan tandis que lui, blessé à mort à la suite d’une embuscade, se laisse mourir sur le champ de bataille. A la sagesse militaire s’accorde ainsi la vertu d’âme qui lui permet d’attendre la mort sans crainte. Brantôme ajoute à son trépas le panache et l’héroïsme dont voici l’expression savoureuse (alors que Bourbon exprime avoir pitié de lui, Bayard répond au traitre de la couronne de France) :
« Mais moy, Monsieur, de vous, qui combattez contre Vostre Dieu, vostre Roy, et vostre patrie ; et moy, je meurs les armes à la main pour les deffendre ». (16)
Sous cette fin certainement embellie, Geoffrey Lopez nous retrace néanmoins la représentation idéale de la mort pour les hommes de guerre de la Renaissance (faut-il seulement opposer le contre-modèle de Gaston de Foix –Duc de Nemours- qui trouva la mort en voulant décimer l’armée en déroute tandis que la bataille de Ravenne était déjà gagnée?)
En quelques mots de conclusion Geoffrey Lopez nous explique que le Capitaine idéal doit être à la fois savant et expert des arts de la guerre, afin de conduire au mieux son armée et d’élaborer, au besoin, des stratégies de repli ou de remaniement. Il doit également se montrer savant humaniste, lettré et connaisseur des textes antiques (où il trouve faits d’armes glorieux et exemples de vertu ou de grandeur). Geoffrey Lopez nous donne ainsi la direction proposée aux lecteurs de Brantôme : l’auteur donne nombre d’exemples modernes et anciens afin que chaque lecteur puisse se mirer à travers le prisme de tant de modèles de vertu ou de vice, de courage ou de couardise. Le capitaine idéal, s’il doit toujours s’exercer aux armes, ne doit pas négliger son esprit.
N’est-ce pas ce que voulait dire le père Strozzi quand il rappelait à l’ordre son jeune fils obstiné à s’exercer à la pratique du cheval et au jeu de paume ?
« Ah ! Malheureux (luy dit il), faut il que tu ressasie le corps avant l’esprit ? Jamais cela ne t’advienne. Avant toutes choses, ressasies ton ame et ton esprit de quelque belle lecture et estude ; et apres, faictz de ton corps ce que tu voudras » (19).
notes :
(1) Etienne VAUCHERET, Op.cit., p.197-210
(2) Ibid., p.127
(3) Ibid., p.269
(4) Cette phrase devrait se trouver à la page 112 du tome 5 de l’édition Bastien, mais elle est absente, nous donnons donc la version présente dans l’édition des Oeuvres Complètes par Ludovic Lalanne, chez Renouard, 1867, Paris, au tome 3, Les Vies des Grands Capitaines François, p.3. Cette partie assez féroce est déjà absente du manuscrit de la dernière rédaction, mais se retrouve dans le ms. 6694 en marge, mais biffée de la main de Brantôme.
(5) Op.cit. tome 4, p.174-175
(6) Ibid., p.126
(7) Brantôme, Vies des Hommes Illustres et Grands Capitaines François, in Oeuvres Complètes, tome 7, chez Jean-François Bastien, 1787, Paris, p.44.
(8) Ibid., p.45
(9) Op.cit. p.204
(10) Brantôme, Discours sur les colonels de l’infanterie de France, édition critique proposée par Étienne Vaucheret, publication conjointe de la Librairie philosophique Joseph Vrin, Paris, et des Éditions Cosmos, Montréal, 1973, p.187
(11) Ibid., p.136-137
(12) Ibid., p.136
(13) Op.cit., tome 4, p.45
(14) Brantôme, Discours sur les belles retraites d’armées de diverses nations, in OEuvres Complètes, tome 8, chez Jean-François Bastien, 1787, Paris, p. 461
(15) Ibid., p.465
(16) Ibid., p.470

BERTOLDO DI GIOVANNI, "Bataille" (détail), après 1478, Bronze, Museo Nazionale del Bargello, Florence (source : WGA)
Discussion
Henri : Sait-on quel est le lectorat de Brantôme (noblesse, bourgeoisie…) ? Geoffrey : Brantôme a écrit son livre pour la noblesse, précisément pour en raffermir les vertus guerrières. Or, il n’est publié que 50 ans après sa mort (ses vœux d’édition n’ont pas été respectés). Par exemple, pour écrire la Princesse de Clèves, Madame de la Fayette s’est beaucoup inspirée des Dames galantes. Certains manuscrits clandestins ont circulé dans les salons de la noblesse. Henri : Brantôme est beaucoup lu ?Geoffrey : Oui, plus tard. Les premières éditions complètes datent de 1666 (à la Haye), après un certain temps, on retrouve des éditions complètes de 1722 puis de plus en plus en France au XVIIIe. Au fur à mesure, on oubliera le recueil des Hommes et la majeure partie du recueil des Damespour ne retenir que la partie croustillante des Dames, rebaptisées « galantes ».
Bastien : Dans les lectures de Brantôme, y a-t-il un capitaine antique ou biblique idéal ? Geoffrey : pour la Bible, c’est l’épisode de David et Goliath qui retient exclusivement l’attention. Mais le Capitaine idéal trouve davantage de références dans l’antiquité, notamment à travers les figures de Pompée, Jules César (Brantôme traduit leurs discours respectifs dans La Pharsale pour les envoyer à Marguerite de Navarre). Henri demande si Brantôme cite Végèce. Au Moyen Age cet auteur était la référence antique par excellence (même s’il n’est alors souvent lu que dans des traductions).Geoffrey se propose de vérifier dans la liste des sources établies parEtienne Vaucheret. En effet on dispose de l’inventaire de la succession de Brantôme (qui comprend une bonne partie de sa bibliothèque, retranscrite par un notaire peu érudit).
Nicolas : Au sujet de la nécessité pour le capitaine de bien cultiver son esprit, quelle place occupe l’art de la parole ? Autrement dit, dans quelle mesure le bon capitaine doit-il bien parler (qualité fondamentale pour Plutarque) ? Ce détour par la parole pour est-il nécessaire ? Certains bons capitaines sont-ils de piètres orateurs ? Brantôme fait-il le parallèle entre l’art de « bien parler » (au moment opportun) et la vertu guerrière (celle qui consiste à agir au bon moment) ? Geoffrey : Oui, la parole est essentielle pour le bon capitaine, on le voit dans le Discours sur les duels. Les vrais bons duellistes ont le « bon mot » ou souvent la « bonne insulte » (leur figure est d’ailleurs souvent réutilisée pour la section des Grands capitaines). Pour les capitaines, le « bon mot » consiste à encourager les soldats ou à insulter l’ennemi de sorte à le ridiculiser. Brantôme n’inculpe pas pour autant les moins bons orateurs, il n’y fait tout simplement pas référence. Nicolas insiste sur la valeur de certains faits de parole (ces mots qui sont tout sauf gratuits…), par exemple les « bons mots » censés impressionner l’ennemi. Geoffrey revient sur le « bon mot » évoqué tout à l’heure au sujet de la mort de Bayard : il symbolise la vertu du capitaine « j’ai pitié de vous qui êtes un traitre à votre couronne ». Nicolas : on peut dire que l’efficacité du mot dans l’évènement correspondrait aussi à une efficacité militaire ? Geoffrey veut distinguer les bons mots en rapports aux faits immédiats, destinés à l’ennemi (ridiculisé), ou veillant à discipliner les soldats. À ce sujet Brantôme cite le prince de Montpensier dont les réprimandes sont dites « extraordinaires » et lui permettent de tenir ses soldats d’une main de fer. La fonction idéale et idéalisée de la parole est de tenir le rang, la charge et de construire, par la même occasion, la figure du chef.
Aline : J’ai à l’esprit Les Mémoires de Saint-Simon. Comme tu as parlé de publication tardive, je me demandais si Saint-Simon avait pu lire Brantôme ? Geoffrey ne sait pas mais juge cela fort probable si l’on considère le goût longtemps entretenu pour la lecture des mémoires. Pour les lecteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, Brantôme fait véritablement l’« Histoire », on imagine retrouver dans ses textes une sorte de « genèse » de la noblesse (grâce aux multiples références à la Renaissance, au Moyen Âge et à l’antiquité). C’est sur cette valeur historique estimée que certains récits du XVIIe vont retenir les éléments les plus croustillants de Brantôme pour construire un XVIe siècle sulfureux (voir Madame de La Fayette).
Bastien : Brantôme pourrait être à l’origine d’un style littéraire ?Geoffrey : non, brosser des portraits correspond à un modèle ancien (de Jove, de Plutarque…). Brantôme appose cependant une note très personnelle, et parfois son amertume.
Benoît veut prolonger la question de Nicolas sur l’art de la parole et l’art de la guerre, en particulier au sujet de la retraite dont on a beaucoup parlé. Il note que Montaigne parle également de cela, notamment dans l’antiquité ; Montaigne cite une armée conduite à une retraite très désordonnée qui aboutit paradoxalement à la victoire. Chez Montaigne cet exemple fournissait l’occasion d’une remise en cause de la raison face à la passion, de désigner une forme d’efficacité de la peur. Par ailleurs, dans l’art de conférer, la capacité à faire retraite réside aussi dans l’aptitude à écouter l’autre, à ne pas le considérer comme un adversaire. Ce mode de retraite serait-il alors une forme de remise en cause de la virilité, d’un idéal du noble guerrier ? Chez Brantôme est-ce que cette mise en valeur de la retraite s’accompagne d’un travail sur la figure virile du capitaine idéal ?Geoffrey répond que Brantôme envisage la retraite comme une qualité intégrante du grand capitaine (il faut savoir quand et comment partir, ce qui implique une expérience du combat, mais c’est surtout un éloge de la sagesse, marque d’expérience et de maîtrise. Il faut savoir ordonner très exactement ses troupes dans une direction donnée, vers un but sécurisé. C’est parfois un fait plus beau qu’une victoire. Benoit : Qu’en est-il des retraites désordonnées ? Geoffrey : la peur n’est jamais positive selon Brantôme, elle crée au contraire le désordre. Benoit : le capitaine-a-t-il aussi la vertu de négocier pour éviter unr bataille par exemple ? Geoffrey : Brantôme n’envisage pas cet aspect dans son oeuvre.
Aline : nous avons beaucoup parlé de « maîtrise » comme sagesse, la stratégie est-elle aussi associée à la sagesse du capitaine ? Geoffrey : oui, c’est en ce sens qu’il faut également comprendre la référence aux sources antiques. Brantome fait l’éloge du Duc de Guise qui puise ses stratégies dans les commentaires de Jules César. Celui qui avant la bataille sait établir une stratégie efficace est particulièrement digne de louange, à l’inverse de Gaston de Foix qui incarne l’impulsion imbécile : courir après les troupes en déroute simplement pour augmenter sa gloire. Ainsi Brantôme critique toute action inconsidérée, peur et passion sont à filtrer. Même s’il excuse parfois les jeunes capitaines qui s’assagiront.
Adeline est étonnée de la place que tient l’amiral de Coligny (protestant) dans ces pages. En effet, il est présenté par Brantôme comme une figure exceptionnelle. Cela signifie que Brantôme fait abstraction de son catholicisme quand il écrit au sujet des grands capitaines ? Geoffrey répond par l’affirmative. Il est vrai que Brantôme a beaucoup souffert des guerres de religion où il a même affronté certains de ses amis (François La Noue par exemple). Brantôme vante ainsi sans partage Coligny, Guise, le Marquis de Pescara, le Duc de Bourbon, Charles Quint… Il traite de ces figures emblématiques avec une neutralité totale du point de vue des guerres de religion. Brantôme se positionne comme catholique non comme ligueur (il refuse d’ailleurs d’entrer dans les nombreux partis qui lui ouvrent leurs portes : le parti huguenot, la ligue, les malcontents…) et refuse tout parti extrême ou opposé à la monarchie. Adeline : Parle-t-il de ses propres faits d’armes ? A-t-il été sur le champ de bataille? Geoffrey : oui, il en parle sous couvert et de manière allusive, « un jeune gentilhomme dont je tairai le nom car cela me ferait trop de gloire ». Brantôme n’a pas vraiment de fait d’arme à son compte (il parle davantage de ceux de son frère ou de son père) et se situe toujours comme témoin de faits de guerre, répondant présent lors de nombreuses batailles.
Goulven Oiry, « Le capitaine fanfaron à la lumière de la comédie »
Goulven Oiry est ATER à l’Université de Savoie, il vient de soutenir une thèse qui croise les lettres et l’urbanisme : « L’Iliade parodique. La comédie française et la ville, 1550-1650 » (sous la direction de Pascal Debailly de l’Université Paris VII et de Philippe Chaudoir de l’Institut d’Urbanisme de Lyon), il travaille actuellement à son édition. Son intervention porte sur la place du soldat fanfaron dans la comédie humaniste.

Pieter BRUEGHEL, « bataille du carnaval », Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, (sources : WGA)
Goulven Oiry commence par attirer notre attention sur la manière dont il convient de cerner le théâtre comique du début de l’époque moderne. Il est nécessaire de se défaire de nos réflexes de périodisation habituels : la distinction entre Moyen Âge, XVIe siècle et XVIIe siècle n’est pas vraiment opératoire, on lui préfèrera la délimitation de périodes plus cohérentes : 1450-1550 et 1550-1650. 1450-1550 correspond à l’époque de floraison de la farce et de ses dérivés (la sottie, les sermons joyeux).Goulven Oiry se propose de traiter aujourd’hui de la seconde période, 1550-1650, puisque la seconde partie du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe correspondent à l’invention et à l’institutionnalisation de la comédie française dite commedia erudita ou sostenuta (un genre nouveau, qui transpose d’abord des modèles grecs, latins et italiens et cherche à dépasser la tradition farcesque). Goulven Oiry nous présente un corpus mal connu et longtemps considéré comme le balbutiement du grand art moliéresque.
Goulven Oiry nous fait remarquer que la montée en puissance de la comédie française coïncide avec les guerres de religion. Le genre comique des années 1550-1650 s’avère en effet fortement marqué par le traumatisme des fameux « troubles civils », par les combats acharnés entre Catholiques et Protestants pour le contrôle des villes. Si les guerres de la fin de la Renaissance se soldent par des monceaux de ruines, la destruction de villes, le « héraut des hommes » que met en scène La Néphélococugiede Pierre Le Loyer (1579) le dit en de magnifiques décasyllabes :
« Le Cruel Mars esmouvant les courages / Aux fiers combatz, aux meurtres, aux carnages, / Parmy la plaine entassoit à monceaux / Les corps humains, pasture des corbeaux, / Razoit les fortz, demanteloit les villes, / Ou les rendoit esclaves et servilles / Dessouz les loix des fortes garnisons, / Qui s’emparoient des plus riches maisons. »
(Pierre Le Loyer, La Néphélococugie ou La Nuée des cocus, v. 3103-3110)
Goulven Oiry nous montre combien la cité (à la fois enjeu et instrument de pouvoir) et les armes ont partie liée. En temps de guerre, lorsque le « cruel Mars émeut les courages », toute ville doit pouvoir se défendre : jusqu’au XVIIIe siècle compris, le lieu urbain se conçoit donc d’abord comme un rempart. La ville et la guerre s’appellent l’une l’autre ; plus la ville se veut inexpugnable, plus elle sera convoitée en cas de conflit, plus il importera de la préserver.
Or le genre comique des années 1550-1650 accorde une place centrale à cette articulation guerre – ville. Cette question se cristallise autour de la figure du soldat fanfaron et du capitaine bouffon, véritables matrices de la comédie. Gouven Oiry nous dévoile les aspects d’une dramaturgie comique qui, envisagée sur le plan spatial, se conçoit tout entière comme un siège de ville parodique.

Jan SWART VAN GRONINGEN, "Femme se lamentant devant une ville en feu", 1550-55, Rijksmuseum, Amsterdam (source : WGA)
I. La comédie ou le spectre de la démolition des villes
À la charnière des XVIe et XVIIe siècles, le genre comique évoque le spectre de la destruction de l’espace urbain. Ce faisant, il se fait l’écho des affrontements sanglants qui émaillent toute l’époque. Les allusions aux batailles urbaines et aux sièges émaillent l’ensemble du corpus.Goulven Oiry pointe la panique consécutive aux sacs de villes comme moteur principal de l’action. Au terme de certaines comédies, s’il y a une reconnaissance, c’est précisément parce que les personnages se sont perdus de vue (lors d’une prise de ville). C’est la ficelle dramatique des Les Corrivaus de Jean de La Taille (1573), La Reconnue de Belleau (1578), Les Esprits (1579) et Les Tromperies (1611) de Pierre de Larivey, par exemple.
Or, l’évocation des sièges de villes est presqu’immanquablement le fait des soldats fanfarons. Goulven Oiry rappelle que les soldats bouffons sont des rejetons du Miles Gloriosus de Plaute, dont le nom exact est Pyrgopolinice (« vainqueur de villes entourées de tours »). Les Rodomont sont les personnages les plus présents dans le théâtre comique des années 1550-1650 et nourrissent tous un penchant pour la démolition. Goulven Oiry nous présente quelques-uns de ces foudres de guerre autoproclamés.
Le Capitaine des Tromperies de Larivey (1611) prétend d’abord avoir « ruyné cent Citez », il s’attribue pillages, « bruslemens », « sieges » et « victoires ». À l’acte III du Fidèle (1611) du même Larivey, le vaniteux Brisemur justifie son nom sous le regard narquois de son valet incrédule :
“BRISEMUR : J’ai été la destruction et ruine de mille cités.
NARCISSE : N’en dis pas tant et va au rabais monsieur Baudet.
BRISEMUR : Et avec ce poing, j’ai renversé les murailles par terre, et réduit les pierres en menue poussière, dont j’ai acquis cet honorable nom de Brisemur.”
Le très célèbre Matamore de l’Illusion comique (1639) offre un écho direct à cette déclaration : « Le seul bruit de mon nom renverse les murailles », lance-t-il à l’acte II de la pièce de Corneille. Ses exploits auraient eu lieu non seulement en Europe, mais aussi en Chine ou en Afrique. Le héros destructeur aurait par exemple « passé par le feu villes, bourgs et campagnes » en Égypte, aurait mis à feu et à sang les régions du Caire ou de Damas. Matamore, qui emprunte le jargon du bâtiment et de l’architecture laisse entendre que son épée pourrait ravager une maison dans son entier, soit, précise-t-il…
« … ardoises et gouttières, / Faîtes, lattes, chevrons, montants, courbes, filières, / Entretoises, sommiers, colonnes, soliveaux, / Parnes, soles, appuis, jambages, traveteaux, / Portes, grilles, verrous, serrures, tuiles, pierre, / Plomb, fer, plâtre, ciment, peinture, marbre, verre, / Caves, puits, cours, perrons, salles, chambres, greniers, / Offices, cabinets, terrasses, escaliers »
Le soudard de comédie se présente comme un grand démolisseur devant l’Éternel. L’abondance verbale mime l’amoncellement des débris, façon puzzle.
Goulven Oiry en vient à l’exemple du soldat Atrabaze, dans lesVisionnaires de Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1637), il se rêve fossoyeur de la civilisation urbaine de l’Antiquité :
” Où sont les larges murs de ceste Babylone ? / Ninive, Athene, Argos, Thebe, Lacedemone, / Carthage la fameuse, et le grand Ilion, / Et j’en pourrois nombrer encore un million ? / Ces superbes citez sont en poudre reduites : / Je les ai pris par assaut, puis je les ay destruites.”
Quant au « Véritable Capitan Matamore » de Mareschal (1640), il se dit largement doté de tout ce qui est nécessaire à l’attaque de fortifications, soit « charges, bêches, mortiers, crochets, échelles, pieux ». Le pseudo-héros s’identifie absolument à ses prises de villes. Le foudre de guerre revendique des exploits « à la prise de Prague », « devant Casale » et « à Nancy ». Il estime qu’en 1627-1628, il aurait pu donner aux catholiques une facile victoire, « sans forts » ni « redoutes », car il aurait su « avaler la mer et la Rochelle ». Goulven Oiry remarque avec humour que le destructeur de murailles est tellement puissant, réputé et menaçant qu’il n’a plus besoin de passer à l’attaque. On lui cède sans effusion de sang pour éviter le massacre :
“A Pignerol, comme un monceau de paille, / Je renversai d’un souffle un grand pan de muraille ; / J’eusse encor fait sauter la Ville et le Rocher, / Mais on l’ouvrit sitôt qu’on me vit approcher.”
Au « siège de Breda », qui eut lieu en 1625 puis en 1637 dans la guerre des Provinces-Unies, « l’un de [ses] regards fit plus que le Canon ». Le Matamore de Mareschal s’invente ainsi une participation plus que généreuse à la Guerre de Trente Ans. Goulven Oiry nous fait remarquer que le jeu est toujours le même : une toile de fond avérée fait ressortir des prouesses parfaitement imaginaires. La litanie des sièges prétendument victorieux est un élément fondamental dans l’auto-caractérisation du type. Pourtant la rage destructrice ne fait jamais illusion, bien évidemment : tous les militaires bouffons sont des pleutres patentés, qui prennent la fuite à la première escarmouche.
Sur ce point, Goulven Oiry conclut que la comédie tout entière se présente comme un siège de ville parodique. En effet, la mégalomanie destructrice a beau être pure fiction, c’est précisément en tant qu’illusion grotesque qu’elle s’avère fort intéressante. La bravoure de pacotille qui est celle de Matamore donne en effet le ton d’un traitement burlesque de la guerre.
II. La comédie ou le siège de ville parodique

Jacques CALLOT, "Siège de la Rochelle", Bibliothèque Nationale, Paris (source : WGA)
Selon Goulven Oiry, le soudard bouffon endosse une fonction mémorielle, il porte avec lui le souvenir des « troubles civils » ou de la Guerre de Trente Ans, et des multiples prises de villes qui les ont scandés. C’est pourquoi les soudards de comédie forment une caricature des soldats réels (notamment des Gascons et des Espagnols). Mais Goulven Oiry veut insister ici sur la fonction éminemment poétique du soldat grotesque : sa posture contamine tous les autres personnages et donne le la du jeu comique (tous les personnages masculins sont décrits et se décrivent comme des combattants). L’enjeu du combat a simplement cessé d’être héroïque : il ne s’agit plus de prendre des villes, mais des filles.
Goulven Oiry nous fait remarquer que ces textes sont fondés sur un transfert de la référence militaire dans le champ érotique. La trame métaphorique dominante de la comédie assimile la conquête amoureuse à une conquête guerrière : L’assaut qu’il faut donner sur les maisons des jeunes femmes (ou de leurs pères) est rapporté à une prise de ville.Goulven Oiry précise que c’est avant tout le soldat fanfaron qui assure cette métamorphose grotesque de la geste guerrière. En voici un exemple : le discours de Rodomont dans Les Contens d’Odet de Turnèbe, pièce de 1584.
RODOMONT : Il m’est advis que je vay maintenant me presenter à quelque breche, la rondache au bras et l’estoc au poing. Et quand je pense là où je vay, il me souvient de la prise d’Issoire ou de Mastric. Encor je suis seur que la place où je vay donner l’assaut est de plus difficile accès et plus malaisée à gaigner que ne sont les chasteaux de Milan, de Corfou, de la Goulete ou la citadele d’Anvers. Mais amour, qui me conduit sous son estandart, me promet que je demoureray maistre de la place sans effusion de beaucoup de sang, pourveu que je conduise mes troupes en silence, pendant que ceux de dedans ne se doubtent de l’embuscade que je leur ay dressée et qu’ils se preparent de se rendre à Basile, sur lequel je raviray aujourd’huy une belle victoire. J’ay envoyé mon homme faire une patrouille autour des avenues, et selon le raport qu’il m’en fera je jetteray mes gens à la campaigne et feray marcher mes bataillons.
Goulven Oiry développe la particularité de cette pièce : dans Les Contens(1584), c’est d’abord Rodomont qui évoque les « meurtres et carnages » de la guerre. Il exalte « le fait de la guerre », le « mestier d’armes », « la fumée des canons et mousquetades » face à son homme de main Nivelet et rappelle la facilité qui serait la sienne à « prendre quelque ville imprenable ». Par ailleurs, Rodomont convoite Geneviève, mais doit faire face à deux rivaux, Basile et Eustache. Basile se comporte en guerrier lorsqu’il s’agit d’« entrer au logis » de la belle (il en vient à « combatre » victorieusement « sous le drapeau d’amour », alors qu’Eustache est mis rapidement hors jeu et que Rodomont est arrêté pour dettes…), c’est lui qui « [prend] la place »[1]. Goulven Oiry nous montre ainsi que le traitement parodique se dissémine dans toute la pièce, il infuse à partir du soldat fanfaron.
Pour le plaisir d’un autre exemple voici celui du Railleur d’André Mareschal (1638). On retrouve le jeune premier Clarimand et un certain Beaurocher, qui seconde le jeune homme en ses manigances amoureuses :
CLARIMAND : Ne me vends point si cher ma fortune à l’attendre ; / Le vent est-il heureux ? dis, que puis-je prétendre ? / Que faut-il espérer ?
BEAUROCHER : Ce qu’un Victorieux / Qui soumet une Ville à son joug glorieux ; / Cette place rendue ouvre à vos vœux la porte ; / Même en voici la clef que je vous en apporte ; / (Lui montrant une lettre) Clytie en ce papier vous engage sa foi. /
CLARIMAND : Et je puis adorer un autre Dieu que toi ? /
BEAUROCHER : Que d’assauts de ma part ! combien de résistance !
Goulven Oiry nous montre, à l’aide d’un schéma type « poupée russe » ce transfert symbolique qui engage un emboîtement d’échelles : la ville, la maison et le corps féminin sont présentés comme des citadelles assiégées. Soutenue par les personnages masculins, la dynamique de l’intrigue revient à percer ces murailles successives. Ainsi, si on l’envisage sous l’angle de son imaginaire spatial, la comédie apparaît fondamentalement comme une parodie de la guerre. Ce n’est plus l’enceinte sacrée de la cité qu’il s’agit de fracturer, mais les « pertuis » des vierges.
Pour achever de rendre compte de la dramaturgie comique des années 1550-1650, Goulven Oiry se propose de nous en récapituler les rouages (dont Molière reste au fond tributaire) :
Configuration liminaire
Contexte nécessaire à l’action :
L’imbroglio prend place dans une société urbaine où priment l’appât du gain et le souci qu’a chacun de sa réputation.
Situation de départ :
En ville, un jeune premier désargenté tombe amoureux d’une jeune fille de famille fortunée.
Obstacle :
Cupide, le père de famille refuse de donner sa fille à un mauvais parti. Il espère marier sa progéniture à un homme riche (qui l’exonérera du paiement de la dot).
Rouage n° 1 :
Le père séquestre sa fille dans l’attente de ses noces, pour la soustraire aux griffes des prétendants indésirables (= sans le sou).
La jeune fille doit absolument arriver vierge au mariage. Dans la société ultra-patriarcale de la fin de la Renaissance, l’« honneur » des jeunes femmes est le tabou fondamental : la défloration doit résulter du mariage, mariage et défloration doivent aller de pair.
Rouage n° 2 :
Les jeunes premiers prennent à rebours le chemin qu’imposerait le respect des convenances sociales : ils déflorent la jeune première pour extorquer le mariage.
Ils pénètrent dans la maison-forteresse pour abuser des charmes de son occupante plus ou moins consentante.
Rouage n° 3 :
Placé devant le fait accompli, le père n’a d’autre choix que de consentir au mariage qu’il refusait initialement.
Il doit couper court à la circulation de rumeurs délétères sur le compte de sa fille. Il ne peut se permettre de voir sa fille « déshonorée » aux yeux de la ville tout entière (déshonorée = déflorée mais non mariée).
Épilogue :
En obtenant la main de la jeune fille, le jeune premier fait main basse sur la fortune de ses parents.

Giuseppe ARCIMBOLDO, "costume dessiné d'une femme à la lance", 1585, Galleria degli Uffizi, Florence (source : WGA)
En conclusion, Goulven Oiry rectifie les analyses de la critique qui ont fréquemment décrit Matamore et ses acolytes comme une « matrice » en considérant sa propension à l’affabulation. Si le soldat fanfaron était décrit comme le symbole de la comédie, c’était d’abord et avant tout en tant qu’acteur. Matamore est plus à l’aise avec les mots qu’avec une épée note Goulven. Cette virtuosité dans l’ordre verbal et les déconfitures dans l’ordre pratique nourrissent tout un jeu d’oppositions. La critique, le plus souvent, rapporte le comique des Rodomont à leurs contradictions (entre l’apparente vantardise et la réalité, ce sont des êtres de papier tributaires de motifs topiques). Sans contester la validité de ces assertions, Goulven Oiry remarque que l’interprétation du personnage demande à être complétée. La critique s’est fort peu intéressée au penchant de Rodomont pour la démolition. C’est pourtant en creusant ces références aux combats et à la ruine qu’on peut relire le type. Le soldat fanfaron, non content d’évoquer presque à lui seul l’arrière-plan de la guerre dans la comédie, en donne aussi symboliquement la clef. Selon Goulven Oiry, le comique du capitaine de comédie est moins à chercher dans l’opposition entre le vrai et le faux, le courage et la lâcheté, mais dans la mise en rapport du militaire et de l’érotique.
Goulven Oiry note que de façon générale, la dimension parodique n’est envisagée par la critique que sur le plan formel (approche qui présuppose une compréhension du style comme matrice d’un jeu langagier, et non comme support d’un dispositif anthropologique). Goulven Oiry relie et articule ces deux dimensions nous avance l’idée que le jeu parodique dont Matamore est le point d’application ne se limite pas à la dimension verbale de cette figure dramatique, ni même à cette figure dramatique prise dans l’absolu. La comédie apparaît tout entière (langue et action) comme une guerre burlesque, le rabaissement grotesque se joue au triple niveau de l’inventio, de la dispositio et de l’elocutio, et n’est jamais plus lisible que lorsque l’on examine le genre comique sous l’angle de son imaginaire spatial.
Pour Goulven Oiry, la parole faussement conquérante de Matamore nous donne donc la clef de la dramaturgie : nous assisterons bien à une guerre, mais elle sera parodique. Matamore cherche à faire peur pour éviter d’avoir à se battre mais prête surtout à rire (cette transmutation de la peur est le propre du comique théâtral). Goulven Oiry nous rappelle enfin que dans l’« examen » de L’Illusion comique, Corneille explique lui-même que le soudard a été « inventé exprès pour faire rire ». Au sein même de l’univers dramatique, Géronte emboîte le pas à l’auteur en assénant que Matamore prête à « rire » du « crotesque récit » de ses « rares exploits ». L’attitude du trompe-la-mort de carnaval recoupe donc la définition qui est donnée des comédiens au terme de la pièce. À la scène 6 de l’acte V, le magicien Alcandre explique à Pridamant que les « acteurs d’une troupe comique » ne sont violents qu’en parole. Faire du théâtre, c’est jouer à faire peur :
L’un tue et l’autre meurt, l’autre vous fait pitié, / Mais la Scène préside à leur inimitié ; / Leurs vers font leur combat, leur mort suit leurs paroles, / Et sans prendre intérêt en pas un de leurs rôles, / Le traître et le trahi, le mort et le vivant / Se trouvent à la fin amis comme devant.
A titre de « bonus track », Goulven Oiry revient sur le lien entre les discours des fanfarons et les soubresauts de l’Histoire, il semblerait réducteur de poser que les rodomontades des capitans parodieraient purement et simplement la réalité, car l’implication inverse semble aussi pertinente : les soldats réels ressemblaient parfois à des fanfarons de comédies. La frontière entre le brave avéré et le bravache patenté est incertaine, à cet égard, et en contre-point à l’intervention de Geoffrey Lopez, Goulven Oiry nous fait partager un savoureux extrait de citant Brantôme :
« Mais de quoi m’amusé-je tant à écrire la louange de ces braves hommes, vu que d’eux-mêmes, ils le savent publier, à mon avis, et ne les cachent nullement ; car, si leurs beaux faits s’étendent seulement d’un doigt, ils les rallongent de la coudée. Ils ont raison ; aussi, à bien faire bien dire. Et si j’ay vu remarquer à des grands personnages et capitaines que peu souvent eux, étant en troupes, ont failli de leur devoir et valeur, sinon dernièrement à la prise de La Goulette » (Brantôme, Rodomontades et gentilles rencontres espagnoles, Œuvres complètes, Paris, Plon, 1893, t. IX, p. 51).
Goulven Oiry conclut sur cette idée : l’art de la rodomontade ne consistait pas à dire l’exacte vérité mais à trouver, dans le domaine du discours, l’équivalent de la valeur démontrée au combat. Une bonne rodomontade s’appréciait donc selon les critères propres de l’efficacité discursive : l’humour, la rhétorique, la pertinence métaphorique, etc. Brantôme établit ainsi une distinction entre les rodomontades de parole – capacité à trouver dans l’ordre du discours une démesure capable de transcrire un fait d’armes extraordinaire – et la rodomontade d’« effet » ou d’« action » – transposition dans la réalité du champ de bataille des formes d’emphase propres au discours. Qu’elle fût de parole ou d’effet, la rodomontade réhabilitait l’essence même de la prouesse, qui consistait à illustrer la vertu ou, en bonne étymologie, la prudhommie .
Goulven Oiry défait ainsi le préjugé qui assimile la rodomontade à une facétie théâtrale disjointe de toute réalité. Il rappelle une évidence : la facétie fait partie intégrante de la réalité sociale, la réalité guerrière elle-même laisse place à la facétie. Une certitude : le couple dichotomique réalisme / fiction ludique ne saurait être un outil critique pertinent. En matière littéraire, il n’est finalement guère sérieux d’opposer le sérieux au comique. La comédie nous conduit au contraire à approfondir l’analyse des liens entre le rire et le réel. Elle nous invite à reconsidérer particulièrement les zones de contact entre la parole comique et la réalité historique de la guerre.

Siège d'une motte féodale au XIe siècle : détail de la Tapisserie de Bayeux (source : Wikipédia)
Discussion
Henri demande s’il existe des scènes de bataille ou des duels dans ces pièces. Quelle est la réalité de la fameuse lance que l’on retrouve dans le schéma récapitulatif de Goulven ? Goulven répond qu’il y a une insistance très forte sur les scènes de duel dans les références verbales, mais ceux-ci restent à 90% esquivés (les personnages s’y préparent mais le duel se passe toujours sans effusion de sang ou est évité). Mathieu félicite Goulven pour la clarté de son exposé qui éclaire véritablement la comédie de la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce propos est d’autant plus frappant qu’il permet de comprendre des personnages de farce qui existent déjà dans la période qui précède (sur laquelle travaille Mathieu), c’est aussi un fil conducteur qui indique comment les hommes de la deuxième moitié du XVIe siècle retrouvent des sources antiques, avec des déplacements qui modifient la signification des personnages. Goulven répond qu’effectivement, la comédie est durant le XVIe siècle au carrefour car elle emprunte à la comédie antique ; de même, l’opposition entre la comédie et la farce est un trompe l’œil. Les dramaturges du XVIe siècle tout en prétendant récuser la farce valsent sur le succès populaire de celle-ci pour imposer la comédie. Le soldat fanfaron est un creuset qui se retrouve dans toutes les traditions : l’antiquité, les sources italiennes, le Moyen Âge, les francs-archers de Bagnolet… il est un personnage « matriciel », on le voit dans l’étude des sources. Les soldats fanfaron du XVIIe siècle gagnent en complexité par la relecture de l’Arioste, du Tasse, de portraits de gascons, d’espagnols. Il est frappant de constater que la nationalité du soldat fanfaron change en fonction des conflits, d’abord italien puis espagnol, il s’agit toujours de caricaturer l’ennemi.
Geoffrey note, au sujet des rodomontades, que Brantôme prend plaisir à entendre les faits de guerres invraisemblables et grossis cités par les soldats espagnols ou italiens. Brantôme a par ailleurs vu les premières des comédiens italiens venus en France, il en retient principalement la figure du soldat fanfaron Crocodillo. Brantôme précise que s’il est sur la scène associé à un soldat espagnol, certains français en valent bien le portrait. Par ailleurs, Geoffrey se dit frappé par l’association de la rhétorique militaire à la rhétorique amoureuse. Le procédé est également très présent dans lesDames galantes : la femme est comparée à une place assiégée, il y a de multiples sous-entendus érotiques au combat amoureux et toute une rhétorique du duel où la femme « aimable et honorable » mène l’homme à comparaître « à bonnes armes » au lit et à y bien combattre en duel. Ce lien entre Mars et Vénus est vraiment frappant d’un point de vue rhétorique.Goulven reconnaît que le couplage militaire-érotique outrepasse la comédie et se retrouve jusqu’à la damnation de Faust chez Berlioz, déjà chez Pétrarque il était présent dans un autre registre. Geoffrey fait référence à la femme guerrière qui va combattre dans le jeu amoureux.
Mathieu s’interroge sur ce qui dissocie la comédie du XVIe siècle de la comédie ancienne où le personnage fanfaron existe déjà. Quelle différence majeure s’impose dans le traitement de ces métaphores de conquête amoureuse que l’on retrouvait déjà chez Plaute ? Goulven relève une originalité contestable de la comédie française du XVIe siècle, en effet, celle-ci est avant tout faite de traductions (parfois littérales) de textes italiens. Pourtant, il est frappant que deux points soient modifiés : la référence aux villes et les références aux batailles, devenues plus vraisemblables. Les dramaturges actualisent un schéma éprouvé. Mais les références aux siècles de villes sont souvent délirantes : le capitaine matamore de Maréchal aurait participé du siège de saint Louis jusqu’aux batailles contemporaines ! Mathieu récapitule en ces termes : la reprise d’un schéma antique rencontre l’actualité de guerre, cette articulation entre le littéraire et l’historique fait la comédie. Du point de vue de Goulven Oiry, la comédie est ainsi une façon de « digérer » les guerres de religions. Mathieu explique qu’il traite de comédies en latin dans la période qui précède. Il remarque que ce qui est ici relevé n’existe pas encore dans ces pièces antérieures (c’est justement une période plus calme du point de vue militaire). Comme si le contexte impliquait que la comédie n’émerge pas vraiment alors. Goulven va dans le sens de cette hypothèse, il note d’ailleurs qu’un article concernant les revues théâtrales à Berlin pendant la seconde guerre mondiale rapporte l’explosion théâtrale qui fait acte au moment où la guerre est la plus forte. Le pouvoir essaye d’interdire les comédies en prétendant qu’on ne peut rire pendant la guerre mais réalise finalement qu’il ne peut que les encourager. Mathieu reconnaît que les pièces qu’il étudie apparaissent à un moment où il n’est plus question de parler au théâtre de certaines questions (on est dans la période de tension préliminaire aux guerres de religion), la comédie doit donc se justifier à l’inverse du genre satirique, comme lieu où s’amuser d’autre chose. Cela ne fonctionne réellement qu’à partir des années 50 quand le conflit s’ouvre. Goulven remarque que le succès parodique est souvent lié au thème de la guerre (faut-il seulement citer l’exemple de La Grande Vadrouille ?).
Nicolas propose un prolongement par référence aux textes contemporains qu’il étudie, notamment Chollières (1585-1586) qui écrit des dialogues encyclopédiques et comiques : leur part comique se concentre sur la multiplication de métaphores scatologiques, obscène et guerrière, notamment au sujet des relations amoureuses. C’est un effet répété dans ce texte ad nauseam, Nicolas y voit un lien avec ce motif de la comédie. Nicolas est frappé par la différence de posture par rapport à la guerre : si Goulven y voyait une « soupape », chez Chollières il s’agit d’un motif thérapeutique (divertissement par temps difficiles) puis la guerre n’est quasiment plus évoquée dans la narration. Le geste de récréation est ici différent, on ne grossit pas comme dans la comédie, on esquive d’une certaine manière le conflit pour le transformer en pur conflit de parole (métaphore de la joute omniprésente dans cette série de dialogue entre homme célibataire frustrés qui possèdent les femmes en parole et en pensée. La porte est aussi présente). Goulven confirme que dans la comédie il est sans cesse question de portes à signification grivoises : la ville est symbolisée par le quartier, le quartier par la rue, la rue par le seuil de la porte où l’on frappe sans cesse (onomatopée « toc toc toc » au théâtre). Il remarque par ailleurs que la comédie est concomitante de la montée en puissance de la pastorale, celle-ci, en forêt, constitue une esquive pour se distancer de la ville et de ses conflits, elle composerait un envers de la comédie. Mathieu fait remarquer que l’on retrouve le thème de la porte chez les anciens, dans l’élégie, dans le Satyricon…
Aurélia mentionne une autre référence qui fait également le lien entre guerre érotique et militaire : il s’agit de la première histoire tragique contenue dans le recueil Le Printemps de Jacques Yver (1572). Une jeune femme prend les armes pour défendre une ville, l’enjeu est la perte de son honneur (elle est courtisée par Soliman qui a tué son époux). La jeune femme endosse l’armure de son mari pour défendre la citadelle de Rhodes et mourir en chevalier vertueux au terme de cette bataille. Des exemples aussi explicites sont peut-être rares. Le contexte de guerre est très présent dans ce recueil qui s’ouvre sur une célébration de la paix retrouvée à la suite des guerres de religion. Cette paix retrouvée ouvrirait à une possible guerre des sexes (en contexte de querelle des femmes), les histoires sont ainsi tantôt rapportées par des hommes, tantôt par des femmes…
Benoît pense au texte La Puce de Madame Des Roches (1582) co-écrit par Pasquier et les Dames des Roches dans lequel la conquête de la femme s’oppose à l’image du soldat rasant les murailles. La métaphore de la conquête féminine y est reprise à partir de l’anecdote d’une puce posée sur le décolleté de la fille des Roches. Il y aurait une évolution évidente dans le motif de la virilité conquérante. Est-ce que le théâtre comique enregistre des évolutions semblables du personnage conquérant masculin ? Finissent-ils par pénétrer la ville autrement qu’en détruisant des murailles ? Goulven répond par la négative. On note tout de même une évolution dans les années 1630-1650 : la métaphore de la conquête prévaut toujours, mais elle est de plus en plus lexicalisée (de moins en moins référée aux guerres). De même, la question se renverse, au point que dans les années 1630-1650, c’est parfois la jeune femme qui donne l’assaut, elle peut être déguisée en homme et se faire passer pour un véritable conquérant. Le schéma reste le même bien que la conquête soit complexifiée, il ne reflue que très progressivement. Madeleine Lazard, grande spécialiste de la comédie humaniste, a pu défendre une lecture féministe de la comédie, où la figure de la jeune fille monte en puissance. Selon Goulven cela n’est pas faux du point de vue de la tendance, mais le schéma reste très phallocrate. Benoît note que dans La puce la schéma n’est pas moins phallocrate, la virilité prend une forme plus intrusive… Goulven reconnaît que la comédie interroge la virilité, il nous renvoie à Hervé de Grévillon et à la section qu’il a rédigé « du guerrier au militaire » dans l’ouvrage collectif Histoire de la virilité, tome I, paru en 2011 au Seuil.
Eloïse : est-ce que la tragédie humaniste contemporaine ne mettrait pas en place une inversion sexuée vis-à-vis de la comédie ? Dans le théâtre tragique à thématique amoureuse, au contraire, ce sont des femmes furieuses qui cherchent à conquérir ou à retenir des hommes plutôt efféminés, avec des impulsions guerrières et vindicatives qui sont assimilées aux tendances sanguinaires des tyrans d’autres tragédies. La topique du furor amoureux, omniprésente dans le théâtre tragique humaniste serait peut-être l’aboutissement de cette collusion entre Mars et Vénus. On remarque notamment que si dans les premières tragédies l’héroïne occupe une place centrale, les tragédies plus tardives mettent en regard deux voix de la passion, avec l’émergence de figures masculines d’amoureux. On le retrouve notamment dans la pièce de Gabriel Le BretonAdonis (1569) où le paradigme est porté à une forme achevée puisque Mars et Vénus personnages de théâtres et « types » de la passion se font face sur scène et que l’idée de combat reste en incise de toute leurs joutes verbales. Goulven dit mal connaître le corpus tragique, mais en référence auxJuifves de Garnier, il reconnaît que la tragédie est potentiellement dominée par un point de vue féminin là où la comédie relève pleinement d’un point de vue masculin. Dans les Juifves, le motif obsédant de la prise de ville ne joue pas du tout de la même façon que dans la comédie. Eloïse remarque que la tragédie à sujet amoureux met également en place une problématique spatiale, dans l’Hippolyte de Robert Garnier, la femme, assimilée à la ville, doit conquérir la forêt dans laquelle est reclus le héros mélancolique Hippolyte : cette entreprise de conquête et de confusion des espaces est centrale à la pièce. Goulven remarque également qu’au contraire de la tragédie, il n’est jamais fait mention d’enfants dans le cadre des comédies.
Compte rendu par Eloïse Zulicek