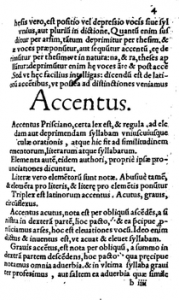CR Chorea : Orient – séance du 9 novembre 2013
Mise en ligne le 9 janvier 2014
Sont présents : Antoine Torrens, Isabelle Imbert, Fanny Oudin, Marie Goupil-Lucas-Fontaine, Adeline Lionetto-Hesters, Aline Strebler, Anne Debrosse, Hélène Vu-Thanh, Blandine Boulanger, Matthieu Ferrand, Aurelia Tamburini, Pauline Lambert, Isabelle Haquet.
Antoine Torrens : “La translittération des écritures orientales au XVIe siècle”
Antoine Torrens est ancien élève de l’Ecole des Chartes et conservateur de bibliothèque à l’Université Paris-Dauphine. Actuellement doctorant, sous la direction de Joëlle Ducos, ses recherches s’inscrivent dans la continuité de son Master 2 et de sa thèse de l’Ecole des Chartes sur la translittération des écritures orientales en France au XVIe siècle.
Antoine a longuement travaillé sur la translittération des écritures orientales et nous parle aujourd’hui de ce qui est au cœur de la problématique sur les translittérations, c’est à dire le lien entre les différents systèmes d’écritures, et les rapprochements, les écarts et influences réciproques entre les différents systèmes d’écriture. Il ne s’agit pas de faire un inventaire des différents usages de l’écriture orientale, mais d’en évoquer plusieurs, de se poser la question de l’orientalisme et la question de la manière dont le regard sur l’Orient amène l’Occident à se transformer. La recherche précédente, entamée à l’Ecole des Chartes, portait vraiment sur les écritures orientales elles-mêmes, mais de plus en plus, Antoine s’intéresse aux écritures latines elles-mêmes.
La question de l’orientalisme est anachronique au XVIe siècle. C’est une notion plutôt appliquée au XIXe siècle, mais la notion s’applique très bien pour le XVIe s., sur de multiples aspects, du point de vue des goûts, du regard porté sur l’autre et notamment du regard porté sur l’origine. Les termes « orient » et « origine » sont proches du point de vue sémantique L’orientalisme n’est pas détachable de la question des monothéismes et des questions mystiques.
Quels usages des écritures orientales au XVIe s ?
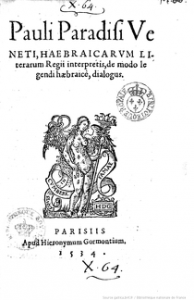
Page de garde du De modo legendi haebraice dialogus de Paul Paradis (source : gallica)
Il y a un idéal humaniste de connaissance et d’encyclopédisme. Au XVe s, en Italie et au début du XVIe s en France, certains mouvements se mettent en place. C’est une période où l’on s’intéresse aux origines, à l’antiquité gréco-latine mais aussi à celle d’avant, l’antiquité hébraïque. Le mouvement se fait vers l’Italie, la Grèce, et de plus en plus vers l’est, vers le Levant, ce qui est une manière de revenir aux origines d’un point de vue littéraire et religieux. Cela pose problème évidemment d’un point de vue théologique. Les écritures orientales sont utilisées dans cette première démarche, pour retrouver les origines, les textes anciens. C’est aux fondements de la Réforme de revenir aux textes même, à la lecture de la Bible dans la réforme protestante, avec l’idée de revenir aux langues orientales et aux écritures orientales. Sur la question des langues, Antoine Torrens renvoie au livre de Marie-Luce Demonet.
L’exemple affiché est celui de la première page du texte d’un manuel d’hébreu qui regroupe plusieurs aspects du début de l’humanisme parisien. Ici, Matthieu Budé, descendant de Guillaume Budé, n’est pas l’auteur, mais un personnage du texte, présenté comme un élève. C’est un dialogue entre deux élèves qui s’apprennent mutuellement à lire l’écriture hébraïque. L’auteur est Paul Paradis, juif converti italien, recruté dans l’entourage de l’évêque de Bayeux, comme professeur au Collège de France à la fin de l’année 1530 – début 1531. La question des écritures orientales arrive tard en France, par rapport à l’Allemagne et à l’Italie. En France, il y a en effet dans l’enseignement de l’hébreu comme de l’arabe, une rupture au Moyen-Age. Entre le XIVe et le XVe siècle, il n’y a presque rien. Au XVIe s., se met en place quelque chose de suivi et ce retour aux origines ne peut se faire que par l’intermédiaire de populations qui viennent d’ailleurs que de France. Les Juifs sont interdits dans le royaume de France depuis 1394. Le problème au XVIe siècle en France est que l’on a besoin d’apprendre et d’expliquer les langues orientales, mais personne ne peut les enseigner. L’accès aux écritures orientales se fait donc de manière différente par rapport à l’Italie et à l’Allemagne.
Paul Paradis, ce professeur venu d’Italie apporte son savoir de la communauté juive d’Italie. On doit chercher l’Orient dans d’autres pays. On n’y a pas d’accès direct en France, à part par le biais de certaines personnes particulières comme Paradis. On essaie de regrouper ces personnes dans des institutions, non par l’intermédiaire de l’université mais par l’intermédiaire de professeurs qui sont un peu à la marge, puis à partir de 1530 par l’intermédiaire des collèges, des lecteurs royaux. Plusieurs collèges trilingues se créent à ce moment-là en Europe. En France, le projet traîne un peu et cela ne se fait finalement qu’en 1530, ce qui est assez tard. Une fois lancés, ces collèges marchent cependant très bien.
Comme on a peu de professeurs en France, on a beaucoup de textes : il y a une production éditoriale plus importante qu’ailleurs de manuels d’hébreu et d’arabe, que l’on ne trouve pas ailleurs.
Le 1er usage de ces écritures orientales est un usage humaniste à la marge du pur désir encyclopédique de connaissances, une volonté de retour au texte : textes de philosophie pour le grec, textes religieux pour l’hébreu.
En hébreu, le premier aspect est la Bible : le grand but dans les années 1520-1530, c’est d’éditer des Bibles critiques, avec des références à la graphie originelle, à la prononciation originelle. Le but est d’aller aux origines de cette langue qu’on ne maîtrise pas du tout.
A la marge, dès que l’on va vers d’autres langues, moins l’hébreu, mais plus l’arabe et l’araméen, la question d’options religieuses spécifiques se pose : la question de la kabbale est plus importante et met en jeu les écritures elles-mêmes. De petits manuels sur la manière d’interpréter la Bible à partir de la numérologie sont édités, avec la mise en commun de mots qui ont la même valeur numérique, dont on tire un sens théologique. Un des usages de ces écritures orientales est un usage mystique.
L’autre question à se poser sur ce sujet des langues orientales est celle du rôle des Grandes Découvertes : paradoxalement, elles apportent peu de choses dans l’ouverture aux nouvelles écritures. On est plutôt dans une continuité médiévale avec la tradition du pèlerinage en Terre Sainte. L’intérêt pour ces écritures orientales est alors un intérêt presque touristique, qu’on retrouve dans les nombreux récits de voyage. On est à la limite entre une volonté de connaissance, une ouverture au monde et des choses religieuses puisqu’il s’agit d’un pèlerinage en Terre Sainte.
Les deux langues « orientales » écrasantes dans la première moitié du XVIe s. sont le grec, non pour l’aspect religieux, mais bien du point de vue de l’écriture puisqu’il s’agit d’une écriture non latine, mais très proche du latin, et le latin. En hébreu et en arabe, ce sont des systèmes beaucoup plus éloignés de l’alphabet latin, qui posent plus de difficultés mais permettent aussi plus de possibilités quant à l’usage que l’on peut faire de l’alphabet latin.

Anonyme : Portrait de Guillaume Postel (source : wikipédia)
L’exception est Guillaume Postel qui a appris l’hébreu et l’arabe, mais on ne sait pas bien comment. Il a sans doute croisé des Juifs plus ou moins convertis, venus de la péninsule ibérique, lors de son passage au collège Sainte-Barbe. Il a appris l’hébreu à la fois au collège Sainte-Barbe et de façon certaine avec des psautiers hébraïques édités en Italie et France dans les années 1510-1520. Il produit en 1538 un Linguarum duodecim characteri, qui est une introduction à 12 systèmes d’écritures. Il fait une introduction assez sérieuse sur l’hébreu, plus aléatoire sur l’arabe et fantaisiste sur le géorgien et d’autres langues plus rares encore.
L’autre usage de ces écritures orientales est l’usage diplomatique, puisque Postel a fait partie de l’ambassade de 1534 auprès de l’empereur ottoman. Par le biais de ce type de traducteurs, des relations sont établies durablement avec la Porte. C’est donc un usage pragmatique, hors de la religion, qui se rapproche des usages commerciaux que l’on a avec les Echelles du Levant.
Avec Postel, le cas est un peu différent : jusqu’alors, l’apprentissage de ces langues orientales intéressait surtout les humanistes dans une volonté de retour aux sources. Postel est vraiment un orientaliste qui est allé dans l’empire ottoman, à Constantinople, a appris dans les livres, mais pas seulement. C’est une forme d’orientalisme plus développée, avec un certain encyclopédisme et un foisonnement qui caractérise l’orientalisme plus tard.
Dans le manuel de Charles Estienne (frère de l’imprimeur Robert Estienne, hellénisant et hébraïsant) de 1538 édité en France à plusieurs reprises, sur la manière de prononcer le latin, Charles Estienne corrige les erreurs de prononciation tout au long de ce manuel. Les exemples et contre-exemples qu’Erasme donne sont basés sur les prononciations régionales françaises, voire des pays germaniques. Parallèlement à ces découvertes sur les langues orientales, il y a une réflexion engagée sur la prononciation de l’alphabet latin que l’on peut mettre en lien avec le fait que la découverte de l’autre amène à se regarder soi-même. C’est encore plus radical à la fin du siècle.
Quand on pense à l’alphabet latin, on pense aux 26 lettres, de la même manière que lorsqu’on pense à l’hébreu, on pense aux 22 lettres… C’est assez vrai au Moyen-Age, même si on a des petites variantes. Ainsi, dans les traités de mathématiques, les signes sont écrits en toutes lettres, avec des abréviations. Ces signes se mettent en place à ce moment là, à la fin du XVIe siècle-début XVIIe siècle. On a de plus en plus tendance à mettre ça en rapport avec la découverte fin XVIe siècle des systèmes d’idéogrammes. Plusieurs traités paraissent alors sur les hiéroglyphes, qu’on ne sait pas déchiffrer. On comprend que ce n’est pas un alphabet, qu’il y a beaucoup de signes qui ne sont pas ceux d’un alphabet. Le système d’idéogramme intéresse en même temps que l’on s’intéresse également au Japon. On se pose la question de l’adaptation d’un tel système pour l’Occident. Mersenne se pose ainsi la question de l’intérêt de créer un système scientifique d’idéogrammes. Il y a une proximité dont il faudrait identifier les tenants et les aboutissants entre le moment où on redécouvre ces systèmes d’écritures par idéogrammes et le moment où on redécouvre des augmentations de l’alphabet latin.
L’autre interrogation porte sur la manière dont le regard sur les langues et les écritures orientales amène à se poser des questions sur notre alphabet et notre système d’écriture.
L’alphabet latin n’est pas un système si évident qu’il peut paraître aujourd’hui : c’est un système qui passe pour simple et logique actuellement parce qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, plusieurs langues comme le turc, le vietnamien sont passées à l’alphabet latin, mais au XVIe s, les érudits font la démarche inverse. Ils redécouvrent certains pans de la littérature classique et se posent la question de la prononciation. En grec, il n’y a jamais eu de rupture de la connaissance de l’écriture, mais dans cette volonté de retour aux origines, ils se posent également la question de l’adéquation entre prononciation et écriture. Dans la démarche d’Erasme, qui aboutit à ce que l’on appelle en France la « prononciation érasmienne » du latin, qui est encore pratiquée de nos jours, il y a une conceptualisation du système d’écriture latin qui conduit à recréer une prononciation qui fait d’une lettre, un son. Avec Erasme, il y a un mouvement de réflexion sur la prononciation du latin chez les humanistes italiens, qui conduit à s’interroger sur la juste prononciation du latin. Pour Erasme, la juste prononciation du latin et du grec repose sur le même système, une lettre = un son.
Isabelle s’étonnant que le latin soit considéré comme langue “orientale”, Antoine précise qu’il n’en est rien et que le paradoxe repose justement sur le fait que l’on a des traités sur les écritures orientales et parallèlement des traités sur la prononciation du latin qui justement se trouvent dans la même démarche, alors même que ce n’est pas une écriture orientale. La question se pose de la même façon pour la prononciation du latin qu’elle se pose avec la question des écritures orientales.
Fanny s’interroge sur la date à laquelle il y a eu des prononciations très différentes du latin et si cela nuit à la compréhension. Selon Antoine, oui, le latin permet au niveau de l’Occident, une intercompréhension très facile, mais de manière écrite. Il y a parfois des allusions dans des traités un peu comiques, où des moines se moquent des accents étrangers, mais l’accent n’est pas non plus présenté comme un problème pour la compréhension.
A une question posée par Pauline sur la circulation, en général, des étudiants et des professeurs entre universités, Antoine répond que, pour les langues orientales, on fait venir beaucoup de professeurs de l’étranger, mais plus on avance dans le siècle, plus on est formé sur place. Ainsi, Nicolas Clénard, l’auteur d’une des grandes grammaires hébraïques du temps et d’une grammaire grecque rééditée plus de 300 fois à l’époque moderne, apprend l’hébreu à Louvain et y enseigne. Lorsqu’il veut apprendre l’arabe, on lui dit de monter à Paris, mais arrivé à Paris, il se rend compte que c’est faux. Il descend jusqu’au sud de l’Espagne et jusqu’au Maroc, pour apprendre l’arabe.
Isabelle revient sur la deuxième diapositive projetée lors de la séance. Elle s’interroge sur la retranscription, dans les éditions de l’époque, de l’arabe par l’alphabet arabe, car manifestement l’une des lettres de cette diapositive n’est pas une lettre arabe, ou une lettre inconnue… Antoine confirme bien que pour plusieurs retranscriptions de lettres arabes, on se pose également la question. On pourrait avancer l’éventualité d’un problème technique lors du gravage des lettres sur bois, voire une défaillance du dessinateur ou de l’imprimeur, mais dans l’édition présentée lors de la séance, il ne s’agit sans doute pas d’un problème de ce genre, car c’est une première édition. Il y a peut être également une question de la retranscription de certaines prononciations qui renvoie à la question évoquée précédemment. Il y a peut-être un processus équivalent pour les graphies.
Marie se demande comment l’arabe est perçu en Occident en tant que langue des Infidèles et pourquoi finalement il y a un tel attrait pour cette langue à ce moment-là. Antoine explique que l’attrait pour l’arabe est parallèle à celui de l’hébreu, et que déjà, l’hébreu est une langue un peu suspecte à l’époque. Il ne faut pas se fier à l’exemple de Guillaume Postel qui se permet d’apprendre et de disserter sur l’arabe parce que c’est un brillant intellectuel. Même pour lui, cet intérêt est suspect. En 1534, Paul Paradis utilise les psaumes comme textes d’exercices linguistiques pour enseigner l’hébreu : il fait alors l’objet d’un procès de la faculté de théologie de Paris qui lui reproche de faire de la théologie sans en avoir le droit. Finalement, très peu de personnes apprennent l’arabe au XVIe siècle. La période postérieure y est plus propice et on le fait pour des raisons plus commerciales et diplomatiques que théologiques. On ne cherche pas à apprendre l’arabe pour comprendre le Coran, par exemple. Isabelle ajoute que, même pour des questions théologiques, on n’apprenait pas l’arabe, y compris au Moyen-Age, dans le cadre de la reconquête. Guillaume Postel a bien avancé qu’il fallait apprendre l’arabe dans une perspective polémique, pour combattre les arguments de l’Islam, mais en réalité, c’est une voix isolée.
La discussion dévie sur le thème de la croisade que l’on retrouve présent, selon Adeline dans les entrées royales notamment, où le motif de saint Louis est exposé. Pour Fanny, il s’agirait plutôt d’une réminiscence d’un certain folklore médiéval, tandis qu’Isabelle et Marie défendent l’idée que le XVIe siècle est un siècle où l’on croit encore sincèrement à la croisade et à la reconquête des lieux saints, même si le thème s’en va mourrant à mesure que le siècle avance, et surtout après la bataille de Lépante. A ce sujet, Marie se demande si l’on s’interroge sur la langue à faire parler aux nouveaux convertis au christianisme. Selon Antoine, les projets de croisade n’impliquent pas forcément la problématique de la langue. Isabelle ajoute que d’après ce que l’on en connaît, la conversion implique de changer de langue. Cela est vrai pour la langue de la religion, mais pour ce qui est de la langue couramment utilisée au quotidien, Antoine et Isabelle ignorent ce qu’il en est.
Anne Debrosse : “Non Saffo o Corinna o Diotima o Aspasia, che vili sono sì fatti paragoni”. Sur la figure de la Grecque antique aux XVIe et XVIIe siècles (France et Italie)”
Anne Debrosse a soutenu sa thèse sur la réception des poétesses grecques dans l’Antiquité et aux XVIe et XVIIe s. (France et Italie) en 2012. Elle enseigne actuellement à l’université de Pau et nous présente ici une partie des conclusions qu’elle a tirées de ses recherches sur la figure de la Grecque antique aux XVIe et XVIIe siècles en France et en Italie.
Anne a travaillé sur la « réception » des poétesses grecques à la Renaissance, au sens large, c’est-à-dire, non seulement sur les questions de transmissions de textes mais aussi sur la façon dont les textes de poétesses ont été lus et sur les présupposés qui sous-tendent des conceptions erronées qui leur ont été associées dès l’Antiquité.
La réception des poétesses grecques présente de traits remarquables : de l’Antiquité à nos jours, on a constamment regroupé les noms des poétesses grecques dans des canons encomiastiques d’un côté, et d’autre part, on a regroupé leurs textes dans des recueils dédiés uniquement à des autrices. On a donc pu considérer qu’il était légitime de regrouper des auteurs en fonction de leur sexe dès l’Antiquité. On présuppose une spécificité des poétesses grecques et de leurs fragments comme si le genre, au sens d’identité sexuelle devenait un genre, au sens littéraire. Qu’un critère physique remplace un critère littéraire est plutôt incongru. Il faut relier ça à la question de l’identité.

Buste de Sappho, copie romaine d'après un original grec du Ve siècle, Musée du Capitole (source: wikipédia)
En littérature, l’identité se précise très souvent par rapport à un modèle. Or, le modèle est ce que l’on imite, surtout dans la première modernité, où le principe de l’originalité à tout prix serait anachronique. Les femmes auteur des XVIe et XVIIe siècles, contrairement à celles qui leur succèderont, manquent cruellement de modèles référents de leur sexe. Elles citent peu d’autrices médiévales parce qu’elles préfèrent, comme leurs confrères masculins, les modèles antiques. Mais, si des autrices antiques ont bien existé, leurs textes ont été majoritairement perdus. Il s’agit de prendre pour modèle un ensemble d’œuvres qui ont disparu. Il reste donc, à défaut des textes, les figures auctoriales qui intéressent beaucoup plus que les textes, ce qui est dû sans doute à l’absence de textes. L’enjeu porte sur l’écriture et la légitimation de l’auctorialité féminine. Sappho est bien sûr un modèle. C’est la première voix de femme, utilisée pour montrer aux femmes que la voie est ouverte, puisqu’il y a un précédent. Elle prouve la compétence ontologique des femmes, validée par un exemple ancien. Sappho a été louée par Platon, Aristote, Plutarque. On fait référence aussi à d’autres poétesses grecques, Errina, Corinne. Sappho est exceptionnelle ; c’est une femme, mais pas tout à fait : Horace parle de la Mascula Sappho. Accumuler les exemples de poétesses grecques revient à dire que les femmes ont une place de choix dans l’histoire.
Au XVIe et XVIIe s, en Italie et en France, les poétesses grecques sont convoquées malgré tout et de façon récurrente par les femmes auteurs et les hommes qui veulent promouvoir l’écriture féminine – malgré l’absence de texte, malgré leur réputation et malgré le peu de connaissances à leur sujet : peu de sources les concernent, mais on les utilise toujours parce que ce sont les premières femmes écrivains de l’histoire, donc elles ont un poids. Leur évocation accompagne systématiquement les diverses renaissances de l’écriture féminine, en France et en Italie. Dès qu’il y a une flambée d’écriture féminine, on fait appel aux poétesses grecques.
On peut expliquer la survivance de ces poétesses par un paradoxe. Leurs textes sont difficiles à retrouver, mais cette obscurité est intéressante parce qu’on peut les utiliser comme on veut. Que les positions soient misogynes ou philogynes, on peut réutiliser les poétesses grecques… Cela fonctionne pour les figures comme pour les textes qui sont tous deux fantasmés et recomposés sur les bases les plus fragiles qui soient. La réception fabrique à chaque période de nouvelles figures de poétesses grecques. C’est une construction sans cesse recommencée d’une place ou d’une exclusion des femmes dans le champ littéraire et dans la société. On expulse les modèles premiers et légitimants de la femme qui écrits dans certains types de littérature, ce qui sape les processus de légitimation de l’écriture féminine. Il faut se demander comment et pourquoi. Il y a eu une querelle autour des poétesses grecques au crépuscule du XVIe siècle et dans les années 1640 en France.
Exclure les Grecques, préférer les Romaines ?
Les Latines sont beaucoup plus rares que les Grecques et n’ont pas eu les honneurs qu’ont eu les poétesses grecques. On met souvent en parallèle à la Renaissance Sappho avec Corinne (chez l’Arioste par exemple). Pourtant, les Grecques sont considérées de plus en plus universellement comment lascives, tandis que les Latines semblent plus respectables et reviennent en force dans les années 1580 en Italie, conséquence probable du Concile de Trente. Le retour des Latines et l’exclusion des Grecques vient sans doute au départ de la pratique ancienne qui consiste à adjoindre un autre modèle à Sappho. Cela commence au moins chez l’Arioste. Sappho est presque toujours flanquée de Corinne, car elle seule pose problème parce qu’elle est exceptionnelle et en raison de ses mœurs supposées. Souvent Sappho seule est présentée comme un modèle littéraire, mais comme un repoussoir moral.
Si l’on résout le problème de cette façon, il en résulte cependant des difficultés redoutables surtout si les exemples accumulés sont constitués de Grecques uniquement. C’est alors l’ensemble des Grecques qui est condamné par contamination avec Sappho. C’est ce qui arrive dans les années 1580 en Italie. Il faut se demander si ce glissement était inévitable. Le cas de Laura Battiferra, éclairé à la lumière de Piero Vettori (1565) et de Bernardino Baldi (1600) est emblématique à cet égard.

Agnolo Bronzino, Ritratto di Laura Battiferri, Palazzo Vecchio, Firenze (source: wikipédia)
Laura Battiferra fait l’objet de deux hommages par ces deux personnages, produits à une cinquantaine d’années d’écart, avant et après 1580. Cela permet de comprendre pourquoi les Grecques ne pouvaient plus facilement servir de modèles. Laura Battifera est la première femme à intégrer une Académie. Elle suit la génération de Vittoria Colonna qui a compté beaucoup de poétesses italiennes. Les parallèles avec Sappho se sont multipliés. Le premier de ces éloges, celui de Piero Vettori (1499-1585), philologue renommé, éditeur de textes antiques et dernier grand helléniste (selon V. Kirkham) de la Renaissance, a entretenu une correspondance avec d’autres érudits de son temps. Il raconte dans l’épître du 31 janvier 1565 à Mario Colonna, l’enterrement de Benedetto Varchi en mentionnant la présence de Laura Battiferra. Il la met en parallèle avec Platon, disant qu’il faut la considérer pour sa culture avant de la considérer pour son sexe. Il affirme qu’il n’est pas étonnant de comparer une femme à Platon, puisque Maxime de Tyr a mis en parallèle Sappho et Socrate. Il passe ensuite à la confrontation entre Laura Battifera et Sappho. Selon lui, Laura dépasse Sappho de très loin.
Laura Battiferra, quand elle a publié ses rimes, place cette lettre de Vettori en tête de ses rimes. Cet extrait a une valeur programmatique pour son recueil de rimes. Elle se place clairement dans la continuité de Sappho, même si elle ne le dit pas elle-même La comparaison avec Sappho est constitutive de son projet littéraire. Elle se présente par la voix de Vettori comme une anti-Sappho au moins sur le plan des mœurs, selon un schéma qui remonte à Martial. Elle est égale à Sappho pour les vers, mais meilleure sur le plan moral.
Bernardino Baldi (1533-1617), aux alentours de 1600, affirme que Battiferra est une autre Corinne et une autre Sappho à la fois. La moderne l’emporte cependant sur ses deux devancières parce qu’elle s’est attachée au sacré, là où les deux Grecques n’écrivaient que des poésies profanes et lascives. Entre Vettori et Baldi, dans un cas, seule Sappho est évoquée, parce qu’elle est la plus ancienne et la meilleure des poétesses grecques.
Dans le cas de Baldi, la poétesse moderne est comparée à Corinne et à Sappho, mais les deux Grecques se voient attribuer les mêmes traits moraux condamnables. Le long voisinage de Corinne avec Sappho a fini par déteindre sur elle. Baldi semble complètement méconnaître les poétesses grecques. Corinne n’écrit pas du tout le même genre de poésie que Sappho qui écrit une poésie lyrique, amoureuse et érotique. De Corinne, on ne garde que des hymnes religieux. Les fragments de Corinne sont plus tardifs que Sappho : Ve siècle av JC, Corinne est contemporaine de Pindare, qu’elle aurait vaincu dans des concours poétiques et musicaux. Ces fragments n’ont rien de lascif et surtout, aucun témoignage antique ne la traite de débauchée, sauf chez Tatien, auteur sujet à caution.
Dans les années 1580, les poétesses grecques restent néanmoins importantes parce qu’elles restent de images légitimantes. Giuseppe Betussi et Francesco Serdonati qui continuent l’œuvre de Boccace qui avait fait un recueil de femmes illustres, donnent une liste augmentée de femmes, qu’ils prennent comme modèles, en citant Politien, de la Vénitienne Cassandra Fedele. Cette liste des femmes de savoir est reprise de Politien. Néanmoins, chez Politien, la liste continue avec des Romaines, connues pour leurs savoirs. Betussi et Serdonati ont coupé leur liste avant les Romaines qui n’ont aucun intérêt à leurs yeux. Pour eux, les poétesses grecques sont les figures les plus valables. Tomaso Garsoni, dans les Vite delle donne illustre de la Scrittura Sacra de 1580 écrit une série de vies de saintes femmes. En outre, l’ouvrage comporte un discours sur la Nobilta des femmes et ce type d’ouvrage est devenu très classique à la fin du XVIe siècle. L’acmé de ce type d’ouvrage est la moitié du XVIe siècle. Des listes de personnages féminins célèbres y sont données et classées par thèmes. La première liste concerne la beauté des femmes, la seconde porte sur leur force physique et la troisième sur leur fécondité. Enfin apparaît la liste des érudites, couronnement de cette série de catalogues : « les grandeurs et la noblesse principale des femmes dépendent de leurs habitudes scientifiques et vertueuses parce qu’en cela seul, on découvre la noblesse d’une personne. Et en cela comme l’affirme Platon dans sa République, les femmes font concurrence de façon honorable à l’homme quand il dit « femme et homme ont des aptitudes égales pour tout ». On trouve autant de femmes que d’hommes très savants dans les sciences. Properce loue au plus haut point les écrits de la Thébaine Corinne (…)». Le savoir est primordial pour Garzoni et les premières représentantes sont des poétesses grecques, Corinne et Erinna, deux figures plus neutres, plus compatibles avec le projet de Garzoni. Ces deux exemples de continuité s’expliquent peut-être par le type d’ouvrages où ils se trouvent. Ce sont des traités apologétiques destinés à mettre les femmes en valeur. Plus les listes sont copieuses, mieux c’est.
En revanche, dans les textes qui mettent en avant la respectabilité des femmes, les Grecques sont largement disqualifiées. Il devient impossible de remettre en cause le bien fondé de la contamination qui a eu lieu entre Sappho et Corinne, qui s’étend ensuite aux autres poétesses grecques et autres Grecques en général. A partir des années 1580, il devient de plus en plus difficile de comparer les œuvres des poétesses grecques antiques avec celles des poétesses modernes.
En 1582, Torquato Tasso, dans un texte adressé à la duchesse de Mantoue qui est sa patronne, cherche à montrer que si la vertu des hommes réside dans leur courage, celle des femmes se trouve dans leur chasteté, qui va de pair avec leur silence. Il existe des exceptions pour qui les règles du commun des mortels ne valent pas. Le Tasse distingue ainsi la féminine virtù de la donatia virtù. Certaines femmes dépassent le lot commun de leur sexe, tout comme César dépasse le lot commun des hommes. Pour ces femmes, la chasteté ne vaut pas plus que le courage, mais une hiérarchie existe entre gens d’exception : ainsi, Scipion doit être préféré à César, Artémis doit être préférée à Cléopâtre. Dès lors, parmi les femmes savantes, la hiérarchie existe aussi : il faut prendre Cornelia pour exemple plutôt que Sappho et les autres grecques. Il préfère la mère des Gracques, Cornélia, à Diotime et Aspasie. Les femmes grecques et non plus seulement les poétesses n’ont pas l’attrait moral de la matrone romaine qui devient le parangon de la femme vertueuse dans les années 1580. Les Grecques semblent trop sulfureuses. Deux types de discours coexistent : l’un, ancien, promeut les poétesse grecques, preuve prestigieuse de la capacité ancienne des femmes à accéder au savoir. L’autre position condamne les Grecques en bloc à la fin du XVIe siècle et tend à prendre de l’ampleur et monopoliser l’espace.
Respectabilité ou création littéraire, un choix nécessaire ?

Jules Cavelier, Cornelia, Mère des Gracques, 1861 Marble, height 171 cm Musée d'Orsay, Paris (source: wga)
Il revient aux laudateurs d’insister sur la chasteté des autrices qu’ils louent. Il ne revient pas aux autrices elles-mêmes de louer leur propre chasteté. Elles peuvent cependant le faire par des choix éditoriaux, comme Laura Battiferra. Ce n’est pas elle qui vante sa chasteté mais quelqu’un d’autre qu’elle cite en tête de son recueil. La discrétion des autrices sur leur respectabilité est le fruit d’une dissociation volontaire entre respectabilité et création littéraire. La volonté de substituer un autre modèle à Sappho, pour régler la question de la respectabilité, n’est pas sans risque. Le fait de choisir Telesilla à la place de Sappho revient à imposer un modèle littéraire qui n’a pas du tout le même poids que Sappho. C’est encore pire avec les Latines. La mère des Gracques, Cornélia, n’est célèbre que par son rôle d’éducatrice et pas par les œuvres qu’elle aurait laissées. Repousser Sappho, c’est postuler que la respectabilité prime sur l’excellence littéraire, et d’une certaine façon mettre en danger la production littéraire féminine, refuser aux femmes un certain type d’écriture. Sappho permettait aux autrices d’accéder à la poésie amoureuse, érotique, pétrarquiste, très à la mode. Le processus qui mène au bannissement de Sappho puis des autres poétesses grecques fait partie du phénomène de retour de bâton dans les années 1580 qui a pour conséquence l’éviction des femmes du domaine littéraire. Dans les années 1580-1600, beaucoup moins de femmes écrivent. Par conséquent, certains auteurs, hommes ou femmes, s’élèvent contre leur ostracisme. Les poétesses grecques deviennent l’enjeu d’une âpre bataille entre ceux qui veulent édifier les femmes et ceux qui veulent les éduquer. Dans les années 1640, certains groupes rejettent très violemment l’éviction sournoise des poétesses qui gagne la France au début du XVIIe s. Elle se retrouve en Italie de façon moins flagrante. Il est intéressant de confronter les galeries de portraits de femmes célèbres dans les années 1640. Dans cette production qui avoue très ouvertement sa volonté pédagogique, se lit le plus clairement l’opposition entre ces deux camps, partisans de la respectabilité et ceux qui veulent montrer que respectabilité et littérature, même s’il s’agit de littérature amoureuse, ne sont pas incompatibles. Le débat est valable pour les femmes et ne se pose pas de façon aussi tranchée pour les hommes.
En France, au XVIIe s, les galeries de portraits de femmes illustres prolifèrent et affichent un objectif d’édification très affirmée. Ce sont souvent des hommes d’église qui écrivent ces recueils, d’où Sappho et les poétesses grecques sont ôtées. Il s’agit pour ces hommes de se servir du livre pour s’introduire dans les salons afin de polir l’esprit des moeurs de la femme par des ouvrages autrement moins dangereux et plus utiles pour sa vertu que le Roland Furieux de l’Arioste ou la Jérusalem délivrée du Tasse. Leurs ouvrages connaissent un grand succès et sont largement réimprimés. Le public ciblé est spécifiquement féminin. Dubosc, dans son adresse à la dédicataire, note que « pour bien instruire les dames, les exemples sont nécessaires ». Lemoine, dans sa copieuse préface, souligne l’intérêt des pères de l’Eglise et des saints pour l’instruction des femmes. Comme ce public est particulier, il faut adapter le discours. Chez Grenaille et Lemoine, ne se trouve aucune poétesse grecque. Chez Lemoine, dans sa Galerie des femmes fortes de 1647, une place est faite aux Juives, aux Romaines, aux Barbares (Egyptiennes par exemple, femmes d’Asie mineure) et aux Chrétiennes. Les Grecques poétesses ou autres sont exclues de ce quatuor d’exemples. Lemoine ne justifie même pas son choix de les exclure de ses exemples. On peut supposer qu’elles représentent chez lui le paradigme des femmes savantes, alors que les Romaines sont des femmes respectables moralement.
Chez Dubosc, Sappho fait une timide apparition, mais de façon très périphérique. L’objectif de Dubosc est de tracer un parallèle entre les hommes et les femmes illustres à l’image de Plutarque. Dubosc justifie son projet qui peut sembler factice par le constat que les vertus féminines et masculines diffèrent fondamentalement. Ainsi, dans le livre premier, qui se présente comme une synthèse sur l’excellence des vertus héroïques, le 1er chapitre est intitulé de l’égalité et de la diversité des vertus de l’un et l’autre sexe, en quoi chaque sexe a ses avantages et ses vertus particulières. Sappho est intégrée à ce discours de justification. Elle prouve que l’on peut comparer un homme et une femme dans un même domaine. En dehors de cette référence, les personnages féminins retenus sont les mêmes que ceux retenus par Lemoine. Les galeries de femmes illustres présentent de nouveaux canons, définis par les religieux, en vue de l’édification d’un public féminin, dont les poétesses comme toutes les autres Grecques sont soigneusement exclues, alors que Sappho est paradoxalement devenue un modèle majeur. Pourtant le courant religieux n’est pas le seul à produire des vies de femmes illustres : Madeleine de Scudéry produit Les femmes illustres ou les harangues héroïques en 1642. Les harangues des femmes illustres sont un recueil de lettres fictives, écrites par des personnages féminins. Le recueil s’achève en apothéose sur une lettre de Sappho à Erinne, où Sappho exhorte Erina à prendre la plume pour la surpasser. Catherine Pascal interprète ce recueil comme une réponse moderne aux galeries mises en place par les religieux. De fait, les femmes écrivains sont majoritaires chez Scudéry, alors qu’elles n’apparaissent pas chez Grenaille, Dubosc et Lemoine.
Là où les religieux honnissaient l’Arioste et le Tasse, Scudéry marque son attachement pour ces Italiens et convoque notamment Marphise et Armide. Catherine Pascal nuance cette dualité parce que Scudéry est très sensible à la morale de ses personnages. La question des mœurs est quand même centrale, mais cette différence existe entre les œuvres de religieux et celles de Scudéry. Sappho et Erinna closent le recueil et ont leur place, là où elles n’étaient pas présentes chez les gens d’église. Les canons peuvent se recouper, mais ce sont les figures marginales. La figure marginale de la poétesse grecque devient centrale chez Scudéry. Elle occupe la place d’honneur en fin de recueil. Les recueils de dames illustres présentent des objectifs différents. Les poétesses grecques et pas seulement Sappho se trouvent là où les lettres sont à l’honneur. Elles sont la marque d’une prise de position en faveur des femmes écrivains.
Conclusion : et l’Orient ?
Les recueils d’éloges de femmes illustres obéissent à des critères prédéfinis en France comme en Italie. Le débat est moins tranché en Italie, mais la question morale est déterminante. Si les poétesses grecques sont aujourd’hui inconnues, à partir de 1580 et au XVIIe s, les recueils d’éloges s’en tiennent à une logique du tout ou rien. Les poétesses grecques en sont exclues en bloc lorsque l’ambition de l’auteur est d’édifier.
L’ancrage oriental n’est pas pour rien dans l’opprobre généralisé et le phénomène d’exclusion progressive des poétesses grecques de la sphère grecque. Cela remonte à la période byzantine et aux yeux des Grecs eux-mêmes. A cette époque, les poétesses grecques sont déjà regroupées entre elles. Cette altérité initiale, qui remonte au IIIe-IVe siècle av. JC, se développe et conditionne in fine la perception des poétesses comme des auteurs placée à l’Orient du monde grec. Les poétesses deviennent toutes des Sappho, donc des Lesbiennes au sens géographique. Ce déplacement n’est pas tout à fait lié au préjugé sur la sexualité des orientales, mais quand même… La réception est en fait gênée par ces figures exceptionnelles de femmes qui écrivent. On les met définitivement à l’écart en créant une double altérité et en croyant la constater. Elles sont femmes et Orientales, pas tout à fait grecques, comme les Amazones, femmes et barbares à la fois. Elles se présentent parfois comme des figures masculines. Les créatrices ont souvent une apparence virile dont il faudrait mesurer le systématisme et l’importance. Athéna, déesse armée et du savoir est décrite avec des traits assez virils. On la met en parallèle avec les poétesses grecques dans l’Antiquité. Corinne chante son bouclier. Elles n’apparaissent pas sous une caractéristique féminine.
Au fil du temps, plus la réception a commencé à aller de l’avant, plus il y a eu un « estrangement progressif » des poétesses grecques, puisque les troubles du genre sont à l’Est. L’Orient procurerait l’espace nécessaire aux femmes pour être poétesses de génie. Alors qu’à une certaine époque, jusqu’au VIe siècle de notre ère, l’origine lesbienne n’est que symbolique. Les poétesses grecques étaient peut être avant tout les porte drapeaux des écrivains, de la respectabilité. Il fallait qu’elles s’imposent entre elles en deuxième lieu.
Isabelle se demande s’il y a aussi un glissement de l’Orientale au sens vraiment oriental, notamment de la Turque vers la Grèce, qui au XVIe s’éloigne de plus en plus de l’Europe car la Grèce entre dans l’Empire Ottoman et si l’on peut placer ce glissement dans le contexte de l’éloignement politique et culturel de la Grèce. Pour Hélène, ce glissement est plus ancien et s’opère dès l’époque byzantine en même temps que l’éloignement religieux.
Antoine s’interroge sur l’utilisation du terme « autrice » et si l’emploi est fréquent dans ces études de genre. Anne explique que cela dépend du cercle dans lequel on s’exprime, mais le terme se justifie car il existe dans les textes de l’époque et est issu du latin tardif “auctrix”. Elle renvoie pour plus de renseignements à l’article en ligne sur le mot “autrice” et la façon dont il est tombé en désuétude, disponible sur le site de la SIEFAR.
Antoine demande qui sont les barbares et cite le proverbe « mulierem fortem qui invenient ». L’expression “femmes fortes” vient des proverbes. Dans les versions actuelles de la Bible, le terme est traduit par “femme vertueuse”, alors que la version hébraïque de l’expression signifie plutôt “femme forte”, au sens de “courageuse”, au sens guerrier. Version hébraïque : echet ailil (aial est le soldat) : femme forte, courageuse. Anne dit que c’est effectivement un processus visible dans les figures qui sont utilisées chez les religieux : les femmes sont plus vertueuses que fortes au sens guerrier.
Antoine revient ensuite sur la représentation de la femme comme éducatrice. Cela lui rappelle en effet que c’est aux femmes qu’est déléguée la question d’instruction des langues : la référence en la matière est sainte Anne comme pédagogue, qui enseigne la lecture à la Vierge. Peut-être alors, y aurait-il un plaquage sur les femmes romaines du modèle médiéval chrétien. Anne abonde dans ce sens en avançant qu’il y a effectivement beaucoup de traités d’éducation de mères à leur fils aux XVIe – XVIIe siècles.
Compte-rendu par Marie Goupil-Lucas-Fontaine (novembre 2013)