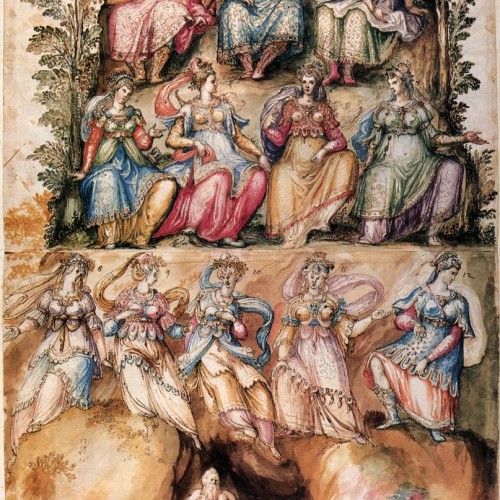Bouquet XXVIII – Comment aborder l’étude des minores ?
Numéro dirigé par Anne-Gaëlle Leterrier Gagliano et Lionel Piettre
avec la précieuse collaboration d’Adeline Lionetto
Anne-Gaëlle Leterrier Gagliano : introduction
Estelle Doudet, Lucien Dugaz et Natalia Wawrzyniak : Une littérature en mode mineur ? Relire les poètes de circonstance à l’aune des médialittératures (XVe-XVIe siècles).
Lionel Piettre : Des minores au sein d’un (plus) grand genre : le rôle des occasionnels dans quelques Mémoires du XVIe siècle.
Anthony Le Berre : Le traité de peste de la Renaissance, un objet littéraire ?
Cyril Cano Anedo : Guillaume Du Sable, poète mineur d’un genre mineur ?
Vanessa Oberliessen : La question du quatrain : un objet poétique non identifié ? Au sujet de la bibliographie de Colletet.
Compte rendu
Paul-Victor Desarbres : compte rendu de l’ouvrage d’Adeline Desbois-Ientile, Lemaire de Belges, Homère Belgeois. Le mythe troyen de la Renaissance.